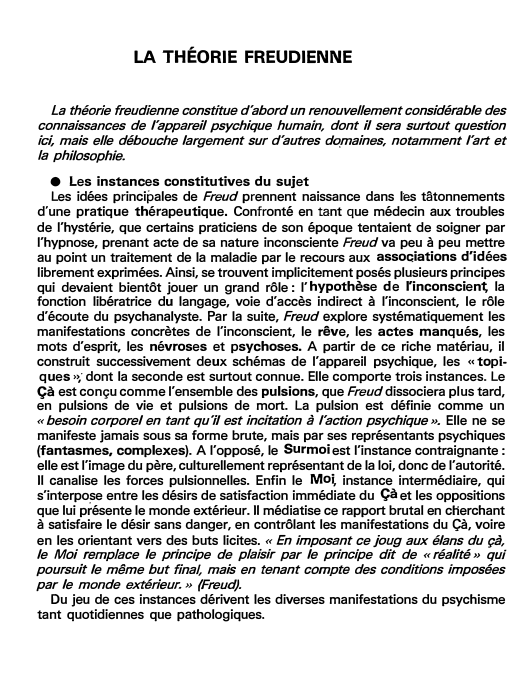LA THÉORIE FREUDIENNE La théorie freudienne constitue d'abord un renouvellement considérable des connaissances de l'appareil psychique humain, dont il sera...
Extrait du document
«
LA THÉORIE FREUDIENNE
La théorie freudienne constitue d'abord un renouvellement considérable des
connaissances de l'appareil psychique humain, dont il sera surtout question
ici, mais elle débouche largement sur d'autres do,maines, notamment l'art et
la philosophie.
• Les instances constitutives du sujet
Les idées principales de Freud prennent naissance dans les tâtonnements
d'une pratique thérapeutique.
Confronté en tant que médecin aux troubles
de l'hystérie, que certains praticiens de son époque tentaient de soigner par
l'hypnose, prenant acte de sa nature inconsciente Freud va peu à peu mettre
au point un traitement de la maladie par le recours aux associations d'idées
librement exprimées.
Ainsi, se trouvent implicitement posés plusieurs principes
qui devaient bientôt jouer un grand rôle: l' hypothèse de l'inconscient la
fonction libératrice du langage, voie d'accès indirect à l'inconscient, le rôle
d'écoute du psychanalyste.
Par la suite, Freud explore systématiquement les
manifestations concrètes de l'inconscient, le rêve, les actes manqués, les
mots d'esprit, les névroses et psychoses.
A partir de ce riche matériau, il
construit successivement deux schémas de l'appareil psychique, les « topi
ques »; dont la seconde est surtout connue.
Elle comporte trois instances.
Le
Çà est conçu comme l'ensemble des pulsions, que Freud dissociera plus tard,
en pulsions de vie et pulsions de mort.
La pulsion est définie comme un
« besoin corporel en tant qu'il est incitation à l'action psychique».
Elle ne se
manifeste jamais sous sa forme brute, mais par ses représentants psychiques
(fantasmes, complexes).
A l'opposé, le Surmoi est l'instance contraignante:
elle est l'image du père, culturellement représentant de la loi, donc de l'autorité.
Il canalise les forces pulsionnelles.
Enfin le Mot instance intermédiaire, qui
s'interpose entre les désirs de satisfaction immédiate du Çà et les oppositions
que lui présente le monde extérieur.
Il médiatise ce rapport brutal en clierchant
à satisfaire le désir sans danger, en contrôlant les manifestations du Çà, voire
en les orientant vers des buts licites.
« En imposant ce joug aux élans du çà,
le Moi remplace le principe de plaisir par le principe dit de «réalité» qui
poursuit le même but final mais en tenant compte des conditions imposées
par le monde extérieur.
» (Freud).
Du jeu de ces instances dérivent les diverses manifestations du psychisme
tant quotidiennes que pathologiques.
• Le complexe d'Œdipe
Les reche,rches de Freud lui ont permis, en outre, de mettre en évidence.
chez ses....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓