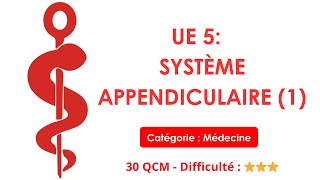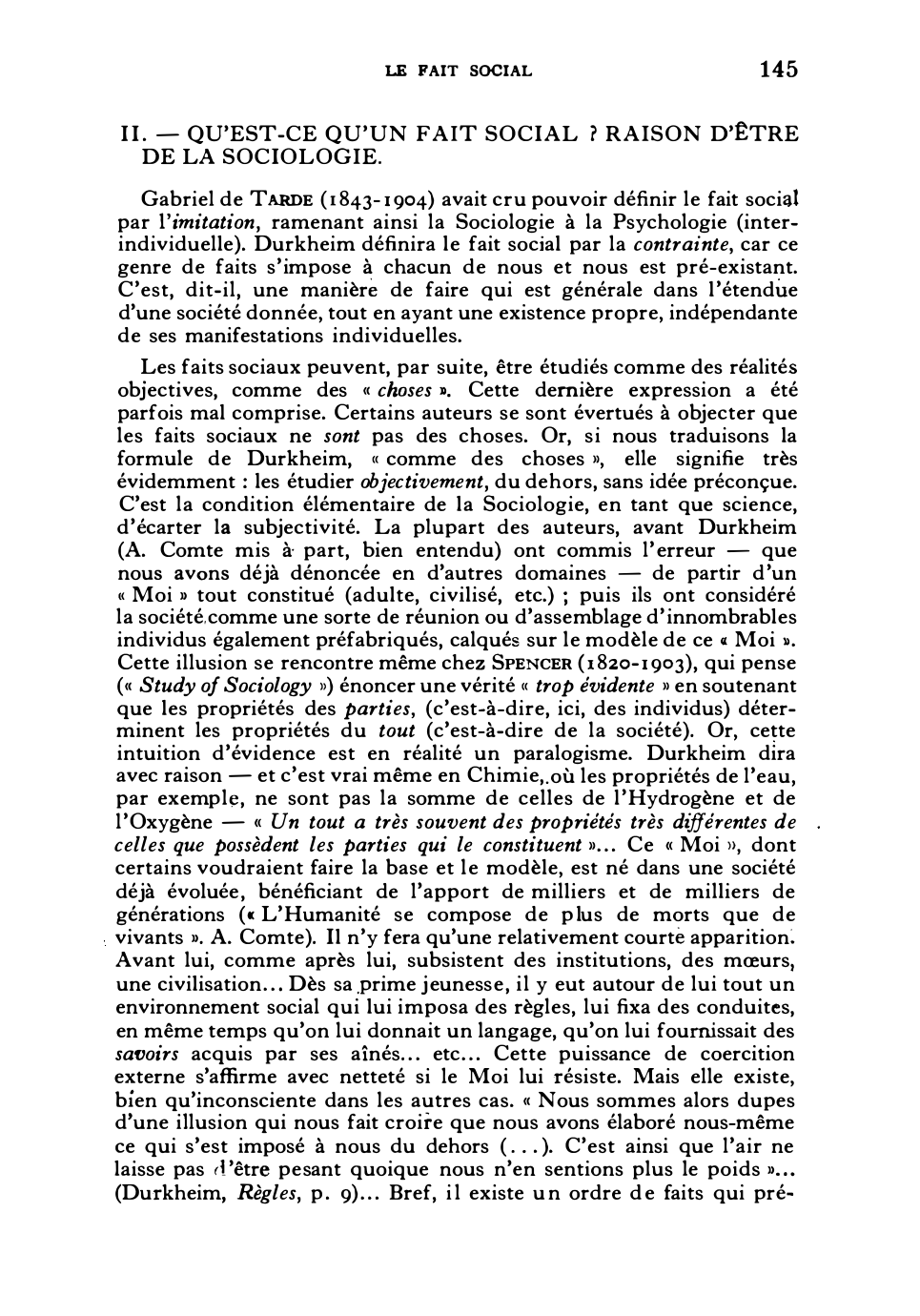La Sociologie. — Les différents types d’explication en sociologie, et leur valeur.
Publié le 12/11/2016
Extrait du document
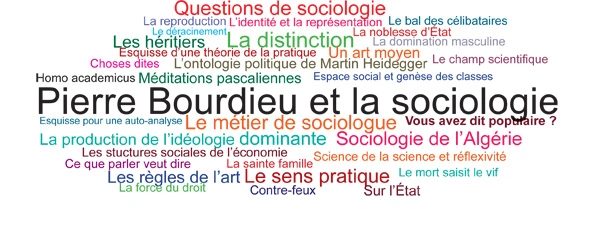
sentent des caractères très spéciaux. Ils ne sauraient se confondre avec les phénomènes organiques, ni avec les phénomènes psychiques individuels. Ils constituent donc une espèce nouvelle : c'est à eux que doit être donnée et réservée la qualification de sociaux.
La Sociologie implique, en résumé, que la société est une réalité sui generis, dont la nature et les lois ne se ramènent pas à celles qui font l’objet de la Psychologie ou de la Biologie. Les phénomènes sociaux constituent un groupe distinct, et c’est à leur observation, à leur étude que se consacre la Sociologie.
III. — OBJET ET MÉTHODES.
Rechercher de quelle manière s’est formée une institution politique, juridique, morale, économique, etc., à quelles fins cette institution paraît répondre, quelles sont ses modalités, etc., cela marque le lien qui rapproche, sans les confondre, la Sociologie et l’Histoire.
I. — NAISSANCE ET ÉVOLUTION DE LA SOCIOLOGIE.
Le mot sociologie a été créé par Auguste Comte (1798-1857) pour désigner la science positive des sociétés. A vrai dire, il eut d’abord l’intention d’appeler Physique sociale cette science nouvelle. Mais le savant belge Quételet ayant utilisé cette expression pour désigner ses propres recherches (assez différentes de celles de Comte) un autre vocable s’imposait.
A. Comte fut avant tout un réformateur social. Son vœu est de mettre un terme au conflit des opinions. Il se propose, selon une formule pittoresque, de « supprimer la liberté de conscience » : Comment cela ? Par la force ? Non. Mais par la science. Par l’évidence qui se dégagera d’une science positive. (« Il n’y a pas de liberté de conscience en Astronomie »). Tout le monde tombera d’accord sur ce que révélera l’étude objective des faits ; et, par conséquent, sur la conduite à tenir...
Qu’il y ait là une illusion, c’est bien certain. Pourtant, il demeure vrai que l’objectivité scientifique est nécessaire dans un domaine où, trop souvent dominent les passions. A. Comte souhaitait, en somme, d’appliquer à la vie- sociale l’idée baconienne célèbre : « On ne commande à la nature qu’en lui obéissant >>. Ne rien ignorer des faits. En formuler, si possible, les lois. « Savoir pour prévoir, afin de pourvoir »...
Dans le passé, les études sur la société avaient un caractère normatif. L’originalité de Comte sera donc de fonder une science positive des phénomènes sociaux, — tout en espérant (Émile Durkheim pensera de même) que, de cette science, on pourra tirer d’utiles conséquences.
Après la mort d’A. Comte, divers types de sociologie naquirent et se développèrent, mais sans méthode bien précise. Il faut arriver à Émile DuRKHEiM (1858-1917) pour trouver une sociologie véritablement scientifique. Comme l’a dit R. Aron (cf. lect.) « Seule, la sociologie durkheimienne a une théorie, une méthode précise ( . . . ). C’est son école qui a exercé le plus d’action sur les sciences sociales... ».
Les statistiques s’expriment souvent en graphiques, permettant une comparaison, permettant aussi d’établir une relation entre deux ordres de phénomènes.
L'interprétation des statistiques exige une très grande prudence. Nous retrouvons à ce propos ce que nous avons déjà remarqué à propos des « règles » de Mill. Les variations en synchronisme de deux courbes peuvent dépendre d’un troisième facteur non-aperçu. Spencer observait déjà en (1872) : « M. Bertillon nous prouve, chiffres en mains, que la mortalité est beaucoup plus forte chez les célibataires que chez les gens mariés. Il en tire la conclusion : que l’état de mariage est le plus . favorable à la santé. Soit ! Mais il faudrait penser que beaucoup d’infirmes, de malades, d’indigents (etc.) ne trouvent pas facilement à se marier, et que, chez eux, la mortalité est plus forte que chez des gens normaux, bien constitués, de situation aisée ». L’esprit critique doit être constamment en éveil et dans l’établissement même des statistiques et dans leur interprétation. En Angleterre, jusqu’à ces derniers temps, à moins que le désespéré n’eût fait connaître ses intentions, le noyé était considéré comme mort accidentellement ;
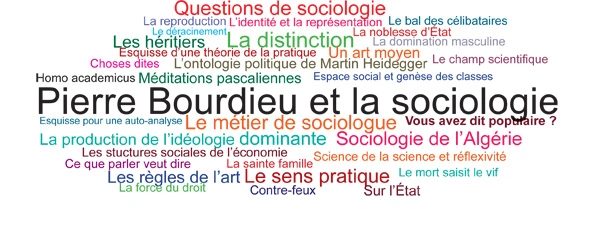
«
LE
FAIT SOCIAL
145
II.
-QU'EST-CE QU'UN FAIT SOCIAL ? RAISON D'tTRE
DE LA SOCIOLOGIE.
Gabriel de TARD E (r8 43- 1904) avait cru pouvoir définir le fait social
par l'imitation , ramenant ainsi la Sociologie à la Psychologie (inter
individuelle).
Durkheim définira le fait social par la contrainte, car ce
genre de faits s'impose à chacun de nous et nous est pré- existant.
C'est, dit-il, une manière de faire qui est générale dans l'étendue
d'une société donnée, tout en ayant une existence propre, indépendante
de ses manif estations individuelles.
Les faits sociaux peuvent, par suite, être étudiés comme des réalités
ob jectives, comme des « clwses •.
Cette dernière expression a été
parfois mal comprise.
Certains auteurs se sont évertués à ob jecter que
les faits sociaux ne sont pas des choses.
Or, si nous traduisons la
fo rmule de Durkheim, « comme des choses ,, elle signifie très
évidemment : les étudier objectivem ent, du dehors, sans idée préconçue.
C'est la condition élémentaire de la Sociologie, en tant que science,
d'é carter la sub jectivité.
La plupart des auteurs, avant Durkheim
(A.
Comte mis à· part, bien entendu) ont commis l'erreur - que
nous avons déjà dénoncée en d'autres domaines -de partir d 'un
« Moi » tout constitué (adulte, civilisé, etc.) ; puis ils ont considéré
la société.
comme une sorte de réunion ou d'assem blage d'innombrab les
individus également préfabriqués, calqués sur le modèle de ce « Moi ».
Cette illusion se rencontre même chez SPENCER (r8zo- 1903), qui pense
(« Stud y of Sociolo gy ")énoncer une vérité « trop évidente , en soutenant
que les propriétés des parties, (c'est-à-dire, ici, des individus) déter
minent les propr iétés du tout (c'est-à-dire de la société).
Or, cette
intuition d'évidence est en réalité un paralogisme.
Durkheim dira
avec raison -et c'est vrai même en Chimie,.
où les propr iétés de l'eau,
par exem ple, ne sont pas la somme de celles de l'Hydrogène et de
l' Oxygène -« Un tout a très souvent des propriétés très différentes de
celles que possèdent les parties qui le constituent » ...
Ce « Moi >>, dont
certains voudraient faire la base et le modèle, est né dans une société
déjà évoluée , bénéficiant de l'apport de milliers et de milliers de
générations («L' Humanité se compose de plus de morts que de
vivants ».
A.
Comte).
Il n'y fera qu'une relativement courte apparition�
Avant lui, comme après lui, subsistent des institutions, des mœurs,
une civilisation ...
Dès sa .Prime jeunes se, il y eut autour de lui tout un
environnement social qui lui imposa des règles, lui fixa des conduites,
en même temps qu'on lui donnait un langage, qu'on lui fournissait des
savoirs acquis par ses aînés ...
etc ...
Cette puissance de coercition
externe s'affirme avec netteté si le Moi lui résiste.
Mais elle existe,
bien qu'inconsciente dans les autres cas.
«Nous sommes alors dupes
d'une illusion qui nous fait croire que nous avons élaboré nous-même
ce qui s'est imposé à nous du dehors ( ...
).
C'est ainsi que l'air ne
laisse pas rl'être pesant quoique nous n'en sentions plus le poids » ...
(Durkheim, Règles, p.
9) ...
Bref, il existe un ordre de faits qui pré-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA MÉTHODE ET L'EXPLICATION EN SOCIOLOGIE
- Collège: Les autres types ou formes de discours au service de l'explication
- Explication linéaire "Fantaisie" Nerval
- Explication linéaire A la Musique Arthur Rimbaud, Poésies, 1870-1871
- Explication linéaire n°9 Madame Bovary: Dans quelle mesure cette rencontre amoureuse, bien que classique, est-elle magnifiée par le regard du héros ?