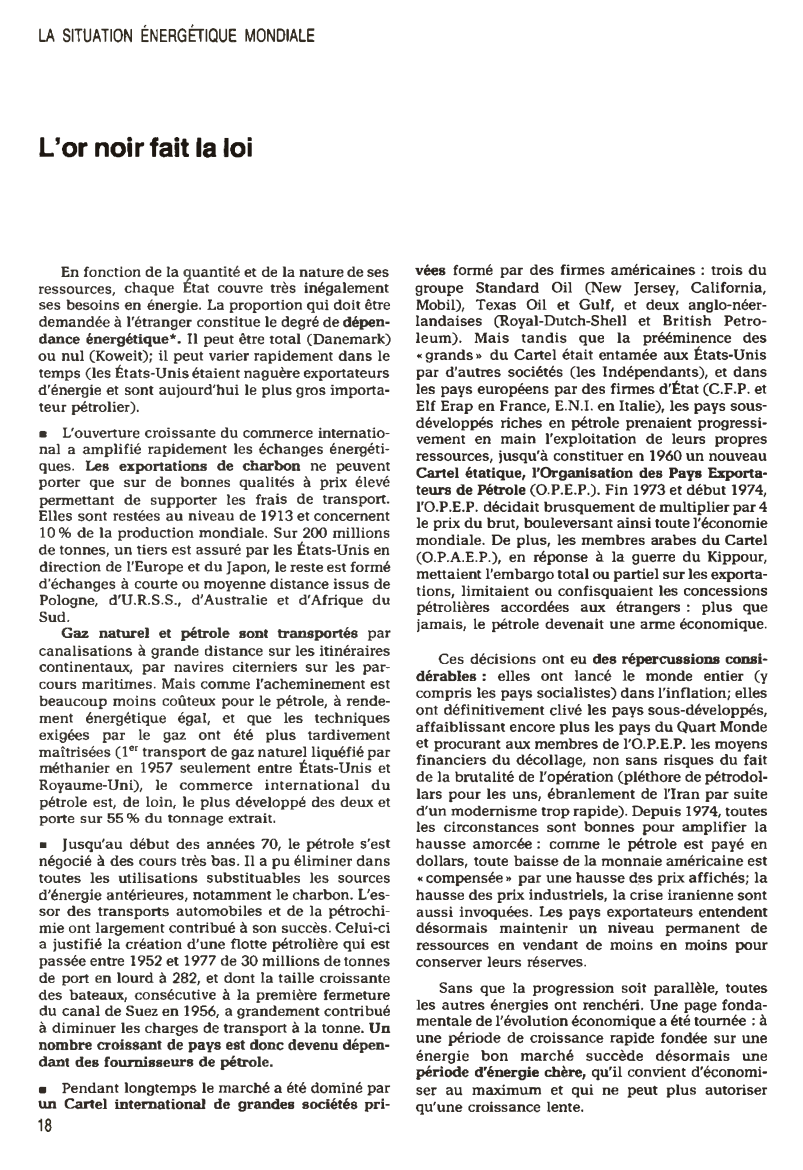LA SITUATION ÉNERGÉTIQUE MONDIALE L'or noir fait la loi En fonction de la quantité et de la nature de ses...
Extrait du document
«
LA SITUATION ÉNERGÉTIQUE MONDIALE
L'or noir fait la loi
En fonction de la quantité et de la nature de ses
ressources, chaque État couvre très inégalement
ses besoins en énergie.
La proportion qui doit être
demandée à l'étranger constitue le degré de dépen
dance énergétique*.
Il peut être total (Danemark)
ou nul (Koweït); il peut varier rapidement dans le
temps (les États-Unis étaient naguère exportateurs
d'énergie et sont aujourd'hui le plus gros importa
teur pétrolier).
■ L'ouverture croissante du commerce internatio
nal a amplifié rapidement les échanges énergéti
ques.
Les exportations de charbon ne peuvent
porter que sur de bonnes qualités à prix élevé
permettant de supporter les frais de transport.
Elles sont restées au niveau de 1913 et concernent
10 % de la production mondiale.
Sur 200 millions
de tonnes, un tiers est assuré par les États-Unis en
direction de l'Europe et du Japon, le reste est formé
d'échanges à courte ou moyenne distance issus de
Pologne, d'U.R.S.S., d'Australie et d'Afrique du
Sud.
Gaz naturel et pétrole sont transportés par
canalisations à grande distance sur les itinéraires
continentaux, par navires citemiers sur les par
cours maritimes.
Mais comme l'acheminement est
beaucoup moins coûteux pour le pétrole, à rende
ment énergétique égal, et que les techniques
exigées par le gaz ont été plus tardivement
maîtrisées (1 e, transport de gaz naturel liquéfié par
méthanier en 1957 seulement entre États-Unis et
Royaume-Uni), le commerce international du
pétrole est, de loin, le plus développé des deux et
porte sur 55 % du tonnage extrait.
• Jusqu'au début des années 70, le pétrole s'est
négocié à des cours très bas.
Il a pu éliminer dans
toutes les utilisations substituables les sources
d'énergie antérieures, notamment le charbon.
L'es
sor des transports automobiles et de la pétrochi
mie ont largement contribué à son succès.
Celui-ci
a justifié la création d'une flotte pétrolière qui est
passée entre 1952 et 1977 de 30 millions de tonnes
de port en lourd à 282, et dont la taille croissante
des bateaux, consécutive à la première fermeture
du canal de Suez en 1956, a grandement contribué
à diminuer les charges de transport à la tonne.
Un
n.ombre croissant de pays est donc devenu dépen
dant des fournisseurs de pétrole.
• Pendant longtemps le marché a été dominé par
un Cartel international de grandes sociétés pri-
18
vées formé par des firmes américaines : trois du
groupe Standard Oil (New Jersey, Califomia,
Mobil), Texas Oil et Gulf, et deux anglo-néer
landaises (Royal-Dutch-Shell et British Petro
leum).
Mai s tandis que la prééminence des
«grands» du Cartel était entamée aux États-Unis
par d'autres sociétés (les Indépendants), et dans
les pays européens par des firmes d'État (C.F.P.
et
Elf Erap en France, E.N.I.
en Italie), les pays sous
développés riches en pétrole prenaient progressi
vement en main l'exploitation de leurs propres
ressources, jusqu'à constituer en 1960 un nouveau
Cartel étatique, l'Organisation des Pays Exporta•
teurs de Pétrole (O.P.E.P.).
Fin 1973 et début 1974,
l'O.P.E.P.
décidait brusquement de multiplier par 4
le prix du brut, bouleversant ainsi toute l'économie
mondiale.
De plus, les membres arabes du Cartel
(O.P.A.E.P.), en réponse à la guerre du Kippour,
mettaient l'embargo total ou partiel sur les exporta
tions, limitaient ou confisquaient les concessions
pétrolières accordées aux étrangers : plus que
jamais, le pétrole devenait une arme économique.
Ces décisions ont....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓