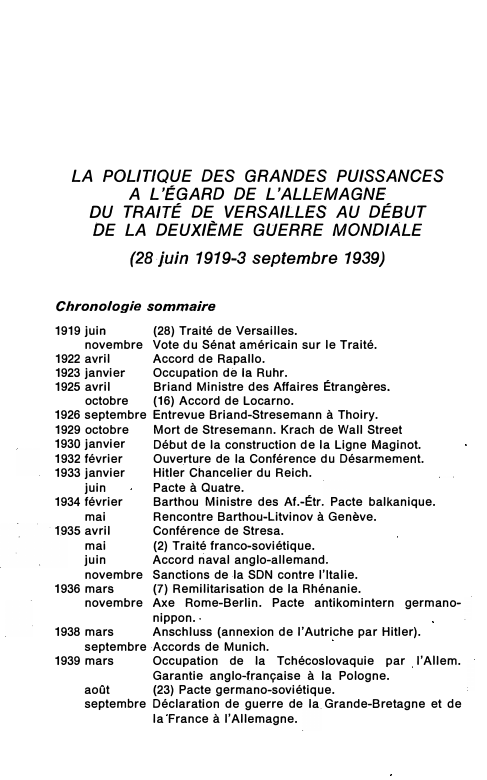LA POLITIQUE DES GRANDES PUISSANCES A L'ÉGARD DE L'ALLEMAGNE DU TRAITÉ DE VERSAILLES AU DÉBUT DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE...
Extrait du document
«
LA POLITIQUE DES GRANDES PUISSANCES
A L'ÉGARD DE L'ALLEMAGNE
DU TRAITÉ DE VERSAILLES AU DÉBUT
DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
(28juin 1919-3 septembre 1939)
Chronologie sommaire
1919 juin
novembre
1922 avril
1923 janvier
1925 avril
octobre
1926 septembre
1929 octobre
1930 janvier
1932 février
1933 janvier
juin
1934 février
mai
1935 avril
mai
juin
novembre
1936 mars
novembre
(28) Traité de Versailles.
Vote du Sénat américain sur le Traité.
Accord de Rapallo.
Occupation de la Ruhr.
Briand Ministre des Affaires Étrangères.
(16) Accord de Locarno.
Entrevue Briand-Stresemann à Thoiry.
Mort de Stresemann.
Krach de Wall Street
Début de la construction de la Ligne Maginot.
Ouverture de la Conférence du Désarmement.
Hitler Chancelier du Reich.
Pacte à Quatre.
Barthou Ministre des Af.-Étr.
Pacte balkanique.
Rencontre Barthou-Litvinov à Genève.
Conférence de Stresa.
(2) Traité franco-soviétique.
Accord naval angle-allemand.
Sanctions de la SDN contre l'Italie.
(7) Remilitarisation de la Rhénanie.
Axe Rome-Berlin.
Pacte antikomintern germano
nippon.
Anschluss (annexion de l"Autriche par Hitler).
1938 mars
septembre Accords de Munich.
1939 mars
Occupation de la Tchécoslovaquie par l'Allem.
Garantie angle-française à la Pologne.
août
(23) Pacte germano-soviétique.
septembre Déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de
la France à l'Allemagne.
Remarques préliminaires
li faut bien délimiter le sujet, ql.!i n'est ni l'Allemagne, ni la politique
allemande, encore moins les relations internationales.
de 1919
à 1939.
Il faut aussi dénombrer et classer les "grandes puissances"
de l'épog1,1e.
Deux d'entre elles ont un rôle de premier,plan inscrit
dans la.
géographie : la France et la Russie des.
Soviets; on peut
envisager dans leurs rapports diverses possibilités, compte tenu de
la position intermédiaire de l'Allemagne : entente germano-russe,
franco-russe, rapprochement franco-allemand (chaque cas traduisa.nt
la méfiance envers le partenaire exclu), ou encore de bons rapports
à trois.
En tout càs ces trois puissances sont au cœur du sujet.
Viennent ensuite la Grande-Bretagne et l'Italie; ni l'une rii l'autre
ne redoutent vraiment l'expansion allemande, la première :à cause
de son insularité, la se.conde parce que les Alpes et le territoire
autrichien la séparent .du Reich.
Plus lointains encore sont les
États-Unis et surtout le Japon.
Pour notre plan, il n'est pas question d'étudier l'une après l'autre
les politiques de ces divers pays, qui interfèrent constamment.
Un
découpage méthodique du type "rapports économiques, idéologiques,
stratégiques".
est impraticable en raison des· redites qu'il impose.
Mieux vaut un plan chronologique.
Mais ·où placer les "dates-char
nières" i On pourra retenir 1924, .gui ·voit l'ébauche de nouveaux
rapports franco-allemands - 1929, avec la Grande Crise.et le regain
des tensions gui en résulte - 1934-35, et le grand revirement de
!'U.R.S.S.
contre l'Allemagne nazie.
Ainsi nous aurons quatre parties,
dont la première servira à un exposé général des intérêts et des
motifs de chaque puissance envers l'Allemagne au lendemain des
Traités.
I.
DES POLITIQUES DIVERGENTES ENVERS
UNE ALLEMAGNE VAINCUE (1919-1923)
Face à la défaite allemande, la France est naturellement la plus
impitoyable, compte tenu de ce qu'elle a souffert; elle veut des
garanties contre une revanche des vaincus, e.t des ,réparations pour
les dommages qu'ils ont causés.
Les Traités ne lui ont pas donné
entière satisfaction, mais elle n'en exige que davantage leur tqtale
exécution.
Déçue par la mollesse et les dérobades de ses anciens
alliés (Was�ington, puis Lonclres, n'ont-ils pas dénoncé la garantie
qu'ils avaient donnée de sa frontière .du nord-est?), la France cherche
des alliances de revers chez les nouveaux états d'Europe centrale
(Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie), et s'appuie sur sa supériorité
militaire.
pour faire plier l'Allemagne rétive : c'est l'occupation de
la Ruhr en 1923.
Face à cette sévère "politique· d'exécution", qu'in
carne Poincaré, la gauche prône cependant une attitude plus com
préhensive et la recherche d'une sécurité collective.
La Grande-Bretagne n'a pas tardé à quitter son attitu.de vengeresse
à l'égard de l'Allemagne vaincue.
Protégée par son insularité, elle
veut alléger les réparations, afin que l'Allemagne reste un utile
parte,nalre économique (critiques de l'économiste Keynes contre les
Traités); elle voit d'.un mauvais œil la politique française sur le
continent et ses alliés ·d'Europe centrale.
Dans l'ensemble, elle est
devenue pour Berlin un précieux bouclier contre les exigences Iran�
çaises.
Les États-Unis ont désavoué Wilson et refusé la ratification du Traité
· de Versailles et du Pacte de la SDN, dont leur président était l'inspira
teur.
Leur politique envers l'Europe est tout simplement celle de
l'absence et du désaveu.
En retirant, par la non-ratification des Trai0
tés, leur garantie à la frontière 'franco-allemande, ils ont.
permis à
la Grande-Bretagne de se dérober à son tour.
Us partagent (de loin)
les vues de Londres à l'égard de l'Allemagne, et blâment les rigueurs
de Poincaré.
L'Italie, déçue par les Traités de paix, et soumise d·epuis 1922 au
pouvoir fasciste, à une, politique plus complexe.
Sur les Alpes, elle
veille à empêcher toute réunion de l'Autriche et de l'Allemagne, et,
défend le statu quo étallll par les Traités.
En revanche, sur l'Adriatique
et dans la région danubienne, elle soutient des visées révisionnistes
qui alarment les alliés de la France.
Dans l'ensemble,.
face à l'Alle
magne, elle réserve sa politique avec opportunisme, soutenant toute
fois l'occupation de la Ruhr par les Français.
Mais c'est la Russie des Soviets (devenue en décembre 1922
!'U.R.S.S.) qui a la politique la plus originale.
Épuisée par la guerre
civile (et ulcérée par les interventions des puissances occidentales
en faveur des armées blanches), amputée d'immenses territoires (au
profit notamment d.e la Pologne et de la Roumanie), la Russie sovié
tique choisit l'entente avec l'Allemagne vaincue : c'est l'accord de
Rapallo du 16 avril 1922.
Pas question de sympathie idéologique
les interlocuteurs allemands ne sont pas même des socialistes, mais
des hommes du centre-droit (populistes) et des militaires.
En
revanche, on voit tout ce qui unit les partenaires sur le plan diploma
tique (la nouvelle Russie, y gagne sa première reconnaissance offi
cielle), économique (abandon réciproque des dettes et réparations,
renonciation allemande·aux biens nationalisés en Russie, à condition
qu'aucun autre pays ne sôit indemnisé!) et militaire (la Russie prati
quement couverte contre une riouvelle intervention sur ses frontières
ouest).
Le choix des Soviets est de grande portée pour l'avenir
- Il donne la priorité à la défense de l'État soviétique sur la propa
gation révolutionnaire à l'Ouest,
- il prépare la reconquête des territoires perdus dans une Europe
centrale où l'Allemagne garde elle aussi sa nostalgie révisionniste.
Ainsi, à la fin de 1923, la France voit sa politique de fermeté envers
l'Allemagne désavouée par toutes les puissaoces, mis à part l'appui
très passager et précaire de Mussolini.
Par des voies bien différentes,
Londres et Moscou font échec à la fois aux réparations et aux amitiés
françaises en Europe centrale.
Il.
BIENVEILLANCE GÉNÉRALE POUR
UNE ALLEMAGNE RÉHABILITÉE (1924-1929)
L'U.R.S.S.
poursuit donc énergiquement la politique de Rapallo.
Le Traité de Berlin en 1926 est un pacte de non-agression conclu pour
cinq ans entre Moscou et Berlin.
En 1928, un important accord écono
mique et financier, précieux pour l'équipement soviétique et la
consomrnation des Allemands.
Pllis graves par leurs conséquences
les accords militaires à partir de 1924 : ils permettent au Reich
d'expérimenter en Ukraine les armes interdites, notamment les blin
dés.
En France, le Cartel des .Gauches renonce à la politique dure de
Poincaré.
Briand inaugure avec !'Allemand Stresemann une politique
de détente et de contacts personnels, qui semble pleine d'espoirs.
En 1925, les Accords de Locarno voient la libre reconnaissance par
Berlin de ta frontière franco-allemande; l'année suivante, Briand
patronne l'entrée de l'Allemagne à la S.D.N.
La France montre sa
bonne volonté en acceptant (non sans hésiter) l'aménagement des
réparations et l'évacuation anticipée de la.
Rhénanie (été 1929).
Malgré l'esprit nouveau qui préside aux rapports franco-allemands,
Briand ne néglige pas les alliances en Europe centrale, mais ne peut
dissiper l'inquiétude de certains de ces pays (la Pologne notamment,
fâcheusement placée entre le Reich et !'U.R.S.S.).
La Grande-Bretagne et l'Italie, qui n'ont pas les mêmes engagements
que Ja France, se joignent volontiers à la détente franco-allemande;
à Locarno, elles donnent leur propre garantie à la frontière franco
allemande, sans prendre naturellement le moindre engagement sur
les frontières orientales du Reich, et laissent à la Fiance la respon
sabilité de couvrir ses alliés tchécoslovaques et polonais.
Notons enfin la rentrée prudente des États-Unis dans la politique
européenne : le secrétaire d'État américain Kellogg accepte, non
sans l'édulcorer, la proposition de Briand de mettre la guerre hors
la loi.
Ce Pacte· Briançl-Kellogg, aussi sympathique qu'inefficace, a le
mérite de rassembler, parmi les 57 signataires, l'Allemagne et les
six grandes puissances du temps dans une déclaration commune
exceptionnelle marque d'optimisme! (août 1928).
Ill.
DE NOUVELLES DIVERGENCES FACE A UNE
ALLEMAGNE A NOUVEAU INQUIÉTANTE (1929-1935)
La Grande Crise trouble la sérénité de la fin des "années 20".
L'Alle
magne, ravagée par le désastre économique et le chômage, est en
proie à la montée dramatique du nazisme, puis à la prise du pouvoir
par Hitler en janvier 1933; dès octobre de la même année, l'Alle
magne....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓