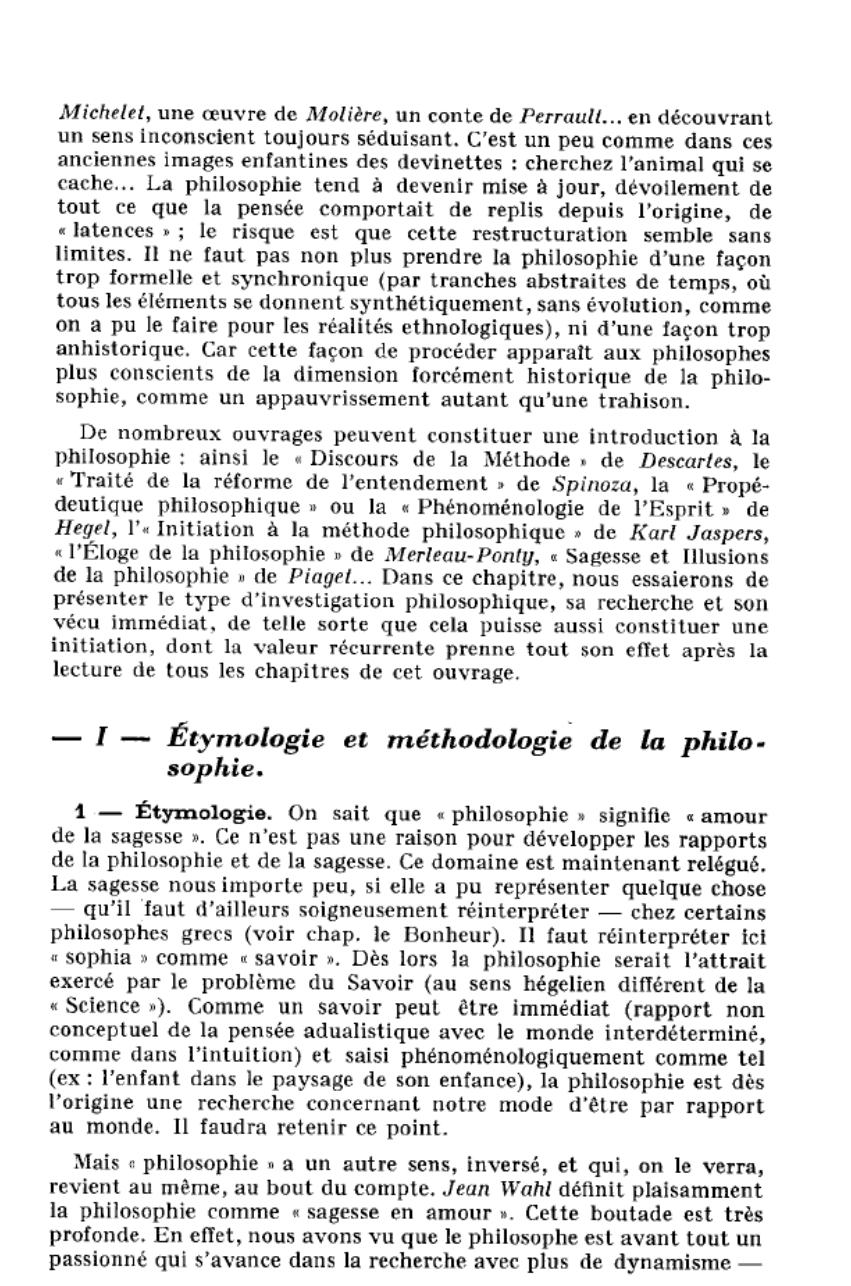LA PHILOSOPHIE
Publié le 02/11/2016
Extrait du document

on le dira naïf peut-être — que le savant. C’est par essence un intrépide, sous ses airs de bonhomme un peu distrait, calme et désintéressé, loin de la foule mugissante. Il faut en fait faire justice au philosophe, et le débarrasser de ce mythe qu’il traîne après lui depuis la « servante de Thrace » (qui riait, dit-on, de voir Thalès tomber dans un puits parce qu’il observait le ciel). Le philosophe est un amoureux qui « s'y connaît » en amour. Cela veut dire que l’amour comme compréhension et comme décentration vers autrui, est pour lui comme une méthode. Ne négligeons donc pas cette seconde interprétation, étymologiquement possible, bien qu’elle résulte d’une relecture. Faisons confiance à « la surabondance de philosophie inconsciente contenue dans les replis du langage » (Unamuno), surtout lorsqu’il s’agit de la philosophie même, comme Heidegger l’a fait tout au long de son oeuvre, avec succès.
LA PHILOSOPHIE
La philosophie, comme les civilisations dans la phrase de Valéry, sait maintenant qu’elle est mortelle. Il faut entendre par là que les systèmes philosophiques n’ont plus la pérennité qu’on leur supposait autrefois, qu'ils naissent, vieillissent et meurent, comme des organismes vivants. Cependant, il convient évidemment de nuancer cette affirmation de trois remarques :
a — Les systèmes philosophiques ne « meurent » pas plus que les civilisations. Ainsi Engels note qu’en général les civilisations vaincues, mais qui possèdent un plus haut niveau de développement économique, assimilent les vainqueurs (à l’exception par exemple des Chrétiens envahissant le territoire savamment irrigué des Maures d’Espagne et détruisant cette forme avancée de technique). On peut donc dire, en suivant Hegel que les civilisations (les Peuples ou « esprits des peuples ») se perpétuent en se dialectisant les uns dans les autres par la récupération (aufhebung — suppression ou dépassement ou récupération). Ainsi l’esprit romain subsiste dans le monde roman.
b — Ce qui reste surtout vivant (et qui fait parler d’une « philosophie éternelle »), c’est un esprit, une ambiance, un être à... proprement philosophiques. On peut dire schématiquement que cet esprit se caractérise par le décalage (l’étonnement) et par la légèreté, qui n’exclut pas le sérieux : selon Nietzsche, le philosophe ne doit pas être lourd et pesant, « le philosophe doit être dansant » ; selon Valéry, il doit pouvoir toujours être là où il n’est pas... L’esprit philosophique se caractérise aussi par la foi sans limites et le dynamisme constant (« avec toute son âme »).
c — Mais d’une outre part, la matière philosophique — et c’est une tendance de plus en plus nette dans la philosophie actuelle — non seulement se « dialeclise » selon l’expression de Bachelard, mais encore se réinterprète, se relit. La psychanalyse, les modèles linguistiques, anthropologiques, économiques, proposent autant de « grilles » à travers lesquelles une relecture de toute œuvre philosophique est possible. Ce « palimpseste » (ou grattage des manuscrits à plusieurs couches d’inscriptions) est le fait d’une archéologie philosophique ( Foucault, J. Derrida, M. Serres, G. Deleuze, et les marxistes). Il s’agit de considérer le texte comme parlant sans le vouloir consciemment (mais bien de façon inconsciente) de tout autre chose, et plus important, que ce qu’il dit à une lecture superficielle. Ainsi Serres dans Hermès I (« La Communication ») relit-il un texte de
on le dira naïf peut-être — que le savant. C’est par essence un intrépide, sous ses airs de bonhomme un peu distrait, calme et désintéressé, loin de la foule mugissante. Il faut en fait faire justice au philosophe, et le débarrasser de ce mythe qu’il traîne après lui depuis la « servante de Thrace » (qui riait, dit-on, de voir Thalès tomber dans un puits parce qu’il observait le ciel). Le philosophe est un amoureux qui « s'y connaît » en amour. Cela veut dire que l’amour comme compréhension et comme décentration vers autrui, est pour lui comme une méthode. Ne négligeons donc pas cette seconde interprétation, étymologiquement possible, bien qu’elle résulte d’une relecture. Faisons confiance à « la surabondance de philosophie inconsciente contenue dans les replis du langage » (Unamuno), surtout lorsqu’il s’agit de la philosophie même, comme Heidegger l’a fait tout au long de son oeuvre, avec succès.
2 — Méthodologie.
A — La méthode de l’Amour. L’Amour est présenté chez Platon comme une méthode. Il est en effet un des « intermédiaires » (ou médiation) qui permet au même titre que le dialogue ou le mythe, d’approcher des réalités transcendantes. Il est un pont entre le sensible et l’intelligible. Platon donne un exemple suggestif de cette médiation. Il prétend (dans « Le Banquet ») que l’Amour est fils de Poros et de Penia. Poros, son père, est la richesse ; Pénia, sa mère, est la pauvreté.
Cela signifierait que de son père il tient le désir de posséder et les moyens pour y parvenir, cependant que par sa mère, il est démuni. Interprétons ce mythe en lui donnant une valeur heuristique de paradigme.
Poros, c’est en fait le passage (voir port, porte), l’ouverture vers, la solution du problème, les moyens pour le résoudre, l’agilité intellectuelle, la « débrouillardise ». Pénia, c’est la pauvreté de biens mais également de moyens, le dénûment d’une intelligence qui se laisse envahir par les blocages des appréhensions ou des complexes ; ou aussi bien l’enfermement. Ainsi la notion d’aporie est fondamentale en philosophie : elle signifie que la question ne trouve pas de solution, que l’esprit est pris au piège. Nous avons dès maintenant conscience que poros et pénia désignent des réalités très importantes philosophiquement. Et en effet, si l’illusion et sa dénonciation sont centrales en philosophie, c’est justement que l’illusion est pénia, par rapport à la liberté du poros. Prenons un exemple chez Rousseau (« Discours sur l’inégalité »). L’homme naturel est un être libre, et n’ayant aucun instinct inné, il a la faculté de les imiter chez les animaux, de les posséder tous. Cela c’est poros: la liberté et la possibilité du cumul propre à la culture. Au contraire, pénia c’est le contentement (animal) qui provient de l’acceptation immédiate de l’enfermement dans une situation donnée (les animaux enfermés dans les limites de leur instinct, de leur code génétique).
L’homme se laisse enfermer, on l’a vu, dans des Illusions successives. Son seul mérite est de sortir de ces illusions, pour plonger dans

«
Michtltl, une œuvre de Moli~re, un conte de Ptrraull ...
e n déco uvran t un sens Inconscient toujours séduisant.
C'est un peu comme dans ces anciennes images enfantines des devinettes : cherchez l'anima l qui se
cache ...
La philosophie lend à devenir mise à jour, devoilement de tout ce que la pensée comportait de replis dep u is l 'origine , de • latences • ; le ri sque est que cette res tru cturation semble sans
l imites.
Il ne faut pas non t>lus pre n dre la philosophie d'une façon
t rop formelle et synchronique (par tranches abst raites de temps, où
tou s les élé ments se donn ent synt hétiquement, sans évol ution, comme
on a pu le Caire pour les réa lité!> ethnolog iques ), ni d'une faço n trop
a n historiquc .
Car cette raç on de procéder apparalt aux philosophes
p lus conscients de la dimension forcé men t historique de la philo sophie, comme un appauvri ssement autant qu'un e trahison.
De nombreux ouvrages peuvent cons ti tuer une Introduct ion à la
p h ilosophie : ainsi le • Di sco urs de la Méthode • de Desca rtes, le • T raité de la ré f orme de l'entende m en t ' de Spino za, la • Propé· d eutlquc philosophique " ou la • P hénoménologie de l 'Esp rit • de Hegel, l' • Initiation à la méth ode philosophique • de [(ar/ Jaspers, • l'Éloge de la philosophie • de lvlerleau-Ponty, • Sagesse et Illusions de la philosophie • de Piaget ..
.
Dans ce ch apitre, nous essaier ons de présenter te type d'investigatio n philosophique, ~a rec her c h e et so n vécu Immédiat.
de telle sorte que cela puisse aussi c onstituer une initiation , don t la valeur récur rente prenne tout so n effet après la lecture de tous les ch apitres de cet o uvrage.
- l- Ét ymologie et méthodologie de la philo· sophie.
1 - Étyu> ologie .
On sait que • philosophie • sig nifie • amour de la sagess e •· Ce n'est pas une raison pour déve l opper les rappo rts de la philosop hie et de la sagesse.
Ce domaine est maintenant relégué.
La sagesse nous i mporte peu, si elle a pu représenter quel que chose
- qu'il ·raut d'aill eurs soigneusemen t réin terp ré t er - chez cer tains
p h ilosop h es grecs (voir chap.
le Bonhe ur).
Il faut réin t erp ré te r ici "sophia • comme «savoir •· Dès lors la philosop h ie serait l'attra it
exercé par le problème du Savoir (au sens hégclicn différent de la • Science •).
Comme un savoir peut être immédiat (rapport non concept uel de la pensée adu alis llque avec le monde i ntcrdéterm iné,
comme dans l 'intuition ) et saisi phénoménologiquement comme t el (ex: l'enf ant dans le paysage de son enfance), ta philosophie est dès l'origine une recherche concernan t not re mode d"étre par rapport au monde.
Il fau dra reten ir ce poin t.
:\·l uis n p hilos ophie • a un autre sens, inve rsé, et qui, on le verr a ,
r evient au même, au bou t du compte.
Jean Wah l définit plaisa mm ent la philosophie comme • sagesse en am our •.
Cette boutade est très
prof onde.
En effet, nous avons vu que le ph ilo~ophe est avant tou t un
passionn é qui s'avance dan s la recherche avec plus de dynamisme -.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'oisiveté est la mère de la philosophie (Hobbes)
- Philosophie marc aurele
- M Vergeade Philosophie : Explication du texte janv.21 Les idées et les âges (1927)P 102 -Manuel Delagrave -P 427-
- À propos de l'histoire de la philosophie (I).
- Philosophie Post-moderne