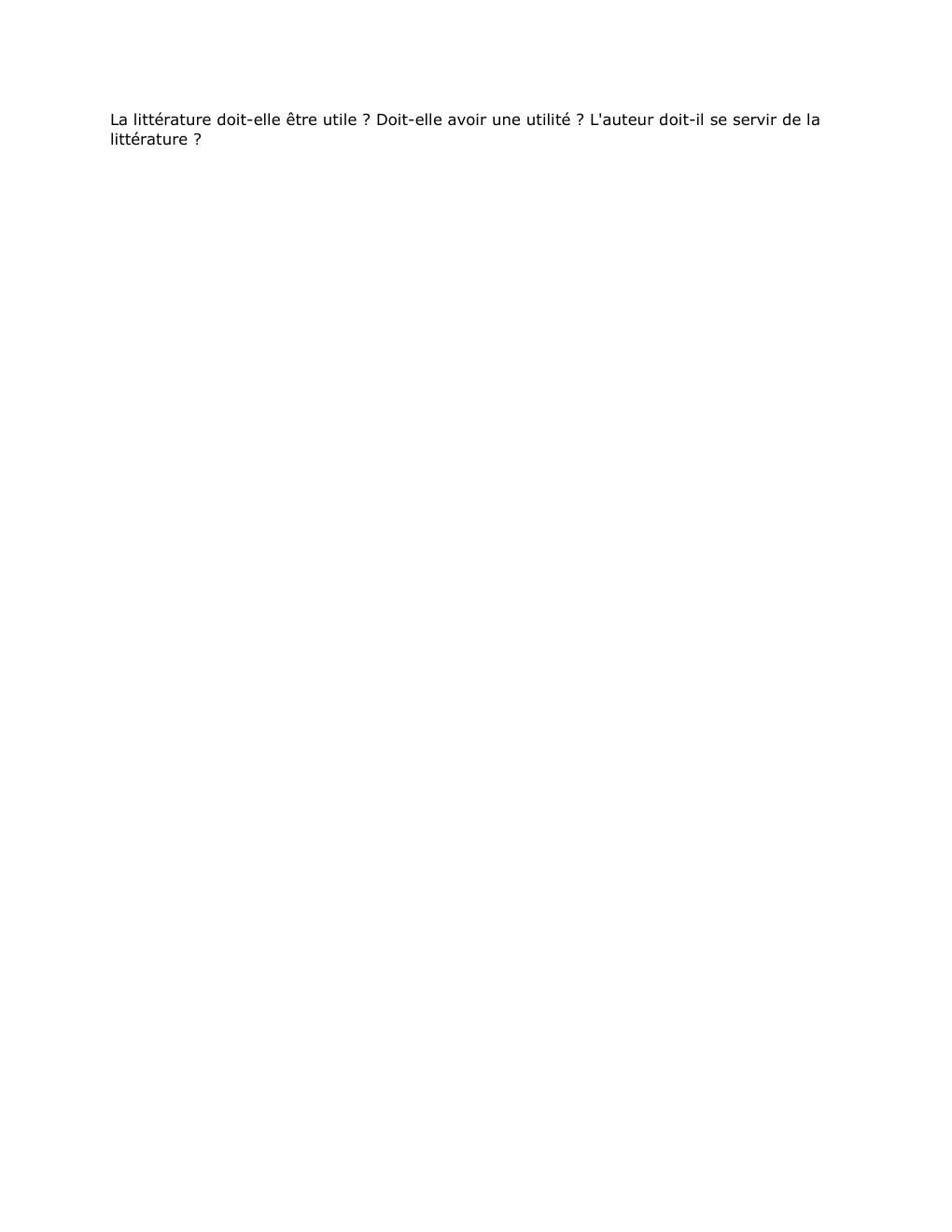La littérature doit-elle être utile ? Doit-elle avoir une utilité ? L'auteur doit-il se servir de la littérature ? La...
Extrait du document
«
La littérature doit-elle être utile ? Doit-elle avoir une utilité ? L'auteur doit-il se servir de la
littérature ?
La littérature doit-elle être utile ? Doit-elle avoir une utilité ? L'auteur doit-il se servir de la
littérature ?
I- Rôle de la littérature, l'écriture engagée
Pour Voltaire => littérature doit être efficace, elle doit avoir un rôle dans la société.
Depuis très longtemps, les romanciers (Dickens, Rousseau, Zola...) mais aussi des
poètes, des dramaturges utilisent leurs oeuvres à des fins « sociales », en intervenant
et/ou dénonçant certains abus de la société dans leurs écrits.
A- Les essayistes et les moralistes
Le lieu privilégié de l'expression et du développement des idées abstraites => l'essai.
• Domaine : histoire, économie, politique, science, pédagogie...=> forme d'un article
étoffé, d'un traité, d'un livre d'histoire, de mémoires, d'une étude, d'une discussion
philosophique, d'une lettre ouverte, d'un pamphlet...
=>discours délibératif où l'auteur
affiche souvent son point de vue
=> registre didactique puisqu'il propose un enseignement ou un partage de connaissances
en un discours structuré – plan rigoureux, thématique, analytique, logique sur un sujet
précis.
B- La poésie
• Par ses jeux sur les mots, le travail de la forme...
la poésie est un bon vecteur pour
dénoncer.
=> Engagement politique.
Hugo : Les Châtiments, lutte contre Napoléon III (se moque de
lui « petit, petit, petit », « le singe » et le montre comme un ogre sanguinaire).
Hugo a
usé de toutes les formes de la poésie de la plus noble (épopée) à la plus familière
(chansons).
Châtiments : beaucoup de chansons pour que les textes se retiennent mieux.
Ex : « Souvenir de la nuit du 4 » => poème très touchant, le lecteur est influencé (talent
de conteur, de poète, images de la vie quotidienne, du désespoir de la vieille femme, de
l'injustice...=> arme rhétorique).
C- La littérature « miroir » de la société
Au XIXE siècle, le roman voulait être un miroir de la société => dénonciation des injustices
sociales.
• Cf.
Hugo qui dénonce la « misère » (Les Misérables) mais aussi la peine de mort (Claude
Gueux ; La Dernier jour d'un condamné).
Cf.
naturalisme de Zola : montre toutes les
corruptions, pauvreté, mauvaises conditions de travail...
sous le Second Empire.
∆) La littérature a souvent été utilisée par les auteurs afin d'exprimer leurs avis et souvent
de dénoncer les injustices, les problèmes...
Voltaire « Un livre n'est excusable qu'autant
qu'il apprend quelque chose ».
II- Une littérature plaisante et qui fait réfléchir...
Certains auteurs sont même parvenus à dénoncer tout en distrayant.
A- Plaire et instruire
« Il obtient tous les suffrages celui qui unit l'utile à l'agréable, et plaît et instruit en
même temps.»
(Horace, Art poétique, III, 342-343).
• Parlez par exemple de Molière, moraliste => Dénonce les moeurs...
Désir de « corriger
les vices des hommes » Castigat ridendo mores.
Par le rire, il veut dénoncer les vices des
hommes, leur en faire prendre conscience mais il critique aussi des faits de société (ex :
Les Précieuses ridicules).
Prendre l'exemple d'une pièce et développer le dans ce sens (L'Avare, L'École des femmes,
Le Misanthrope...).
• Les idées s'incarnent dans des personnages.
Le texte théâtral : principalement constitué
de dialogues ; un personnage parle aux autres personnages mais aussi et surtout aux
spectateurs (très visible dans les apartés mais ne pas oublier que c'est tout le temps le
cas).
• Le public est sollicité, sommé de juger les situations, les discours et les comportements.
Ex : par le discours de Marcelline, la mère de Figaro, Beaumarchais interpelle ses
contemporains.
(Marcelline[1] évoque la détresse des femmes de condition sociale modeste,
maintenues dans l'ignorance et la pauvreté, le comportement des hommes...).
B- L'ironie et le conte voltairiens
L'ironie a été très utilisée par Voltaire car elle permet de réveiller le lecteur =>
doit être attentif à sa lecture et en même temps, s'amuse avec l'auteur : complicité.
• L'ironie est omniprésente dans Candide.
Voltaire qualifie la guerre de « boucherie
héroïque ».
Lorsqu'il écrit « Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les
deux armées », chapitre VI : Candide et Pangloss, pour des raisons dérisoires, sont
conduits « séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on
n'était jamais incommodé du soleil ».
Comprenons que Voltaire désigne ici le cachot !
• Candide : Histoire plaisante ou dans un monde où le héros se fait fesser en cadence et
où ceux qui meurent peuvent revenir.
À travers cet univers si simple, où les personnages
sont tous bons ou mauvais =>réflexion et dénonciation.
Voltaire fait appel à la réflexion
du lecteur, à son intelligence.
Ex : Candide au pays de l'Eldorado : critique sous-jacente de la société française et injuste.
Or, c'est justement par l'utopie que Voltaire nous fait prendre conscience de cette injustice
et il évite ainsi tout censure.
Voltaire dénonce, dans ses petits contes, les abus de la
société, comme l'esclavage.
Force de l'apologue : pique la curiosité, l'intérêt du lecteur =>amené à réfléchir
sur des sujets importants.
Ainsi, sans lire de phrases longues, de développements
compliqués, le lecteur s'instruit et réfléchit.
∆) L'ironie et les petits contes philosophiques invitent donc le lecteur à être....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓