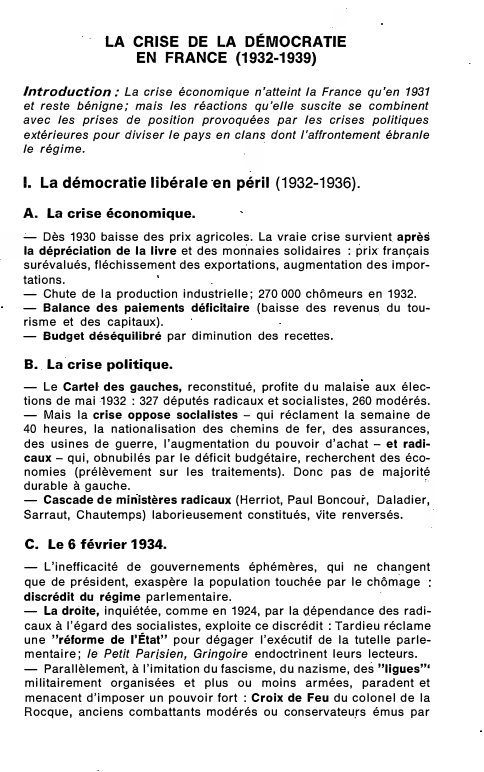LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE EN FRANCE (1932-1939) Introduction: La crise économique n'atteint la France qu'en 1931 et reste bénigne;...
Extrait du document
«
LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE
EN FRANCE (1932-1939)
Introduction: La crise économique n'atteint la France qu'en 1931
et reste bénigne; mais les réactions qu'elle suscite se combinent
avec les prises de position provoquées par les crises politiques
extérieures pour diviser le pays en clans dont l'affrontement ébranle
le régime.
1.
La démocratie libérale en péri l (1932-1936).
A.
La crise économique.
- Dès 1930 baisse des prix agricoles, La vraie crise survient après
la dépréciation de la livre et des monnaies solidaires : prix français
surévalués, fléchissement des exportations, augmentation des impor
tations.
- Chute de la production industrielle; 270 000 chômeurs en 1932.
- Balance des paiements déficitaire (baisse des revenus.
du tourisme et des capitaux).
- Budget déséquilibré par diminution des recettes.
B.
La crise politique.
- Le Cartel des gauches, reconstitué, profite du malaise aux élec
tions de mai 1932 : 327 députés radicaux et socialistes, 260 modérés.
- Mais la crise oppose soclallstes - qui réclament la semaine de
40 heures, la nationalisation des chemins de fer, des assurances,
des usines de guerre, l'augmentation du pouvoir d'achat - et radi
caux - qui, obnubilés par le déficit budgétaire, recherchent des éco
nomies (prélèvement sur les traitements).
Donc pas de majorité
durable à gauche.
- Cascade de ministères radicaux (Herriot, Paul Boncour, Daladier,
Sarraut, Chautemps) laborieusement constitués, vite renversés.
C.
Le 6 février 1934.
- L'inefficacité de gouvernements éphémères, qui ne changent
que de président, exaspère la population touchée par le chômage
discrédit du régime parlementaire.
- La droite, inquiétée, comme en 1924, par la dépendance des radi
caux à l'égard des socialistes, exploite ce discrédit : Tardieu réclame
une "réforme de l'État" pour dégager l'exécutif de la tutelle parle
mentaire; le Petit Parisien, Gringoire endoctrinent leurs lecteurs.
- Parallèlement, à l'imitation du fascisme, du nazisme, des "ligues'"
militairement organisées et plus ou moins armées, paradent et
menacent d'imposer un pouvoir fort : Croix de Feu du colonel de la
Rocque, anciens combattants modérés ou conservateurs émus par
l'inaction gouvernementale, les ravages de la crise, l'affaiblissement
de la France, les progrès du communisme; Jeunesses Patriotes,
Solidarité française, Camelots du roi, plus directement inspirés de
Mussolini et de Hitler.
Cependant le "fascisme" français n'est, en
général, qu'une forme d'action, rajeunie, virilisée, et soutenue par
les milieux financiers, de la droite traditionneUe (jadis boulangists
ou antidreyfusarde} antiparlementaire, antilibérale par tempérament
et par intérêt plus que par doctrine, maintenant anticommuniste.
- Prétexte de l'offensive contre l.
e régime : le scandale Stavisky,
qui entraîne la démission de Chautemps, remplacé par Daladier.
6 février 1934 : marche des ligues sur la Chambre, brisée par les
gardes mobiles (20 morts, 200 blessés).
Impressionné, Daladier
démissionne, malgré le soutien du Parlement.
.
D.
L'amortissement du choc (1934-1936).
Mais le régime tient : grève générale "antifasciste" organisée par la
C.G,T.
le 12 février; regroupement des modérés et des radicaux
autour de Doumergue en un gouvernement d"'Union nationale" sans
socialistes (Herriot, Tardieu, maréchal Pétain), qui enterre la réforme
de l'État annoncée à grand fracas pour apaiser les ligues.
- Doumergue, abandonné par .les radicaux qui le suspectent d'a\,lto
ritarisme, se retire (8 nov.).
Après un cabinet Flandin, Laval (mai 1935)
revient au vrai problème, la crise, qui empire, et tente une déflation
(baisse autoritaire des prix, des revenus et des salaires de 10 %,
qui diminue les.
prix à l'exportation sans .modifier les rapports de
valeur à l'intérieur; économies, lutte contre le chômage), qui réussi
rait peut-être si les radicaux, préoccupés des élections, ne refu
saient de le suivre.
Son successeur, Sarraut (janv.
1936), attend les élections.
Il.
Le Front populaire (1936-1937).
A.
Sa formation.
- Fait neuf : pour "barrer la route au fascisme", les communistes
offrent leur alliance aux partis de gauche "embourgeoisés", socia
listes et radicaux, sur les instructions de Staline (M.
Thorez à Moscou,
mai 1934), qui tire la leçon de l'aventure allemande (le parti commu
niste, qui a affaibli la république de Weimar .par son opposition sys
tématique, a été la première victime de Hitler).
- Daladier, malgré Herriot, et Blum acceptent : formation du Front
populaire (défilé du 14 julllet·1935, fusion C.G.T./C.G.T.U.
au Congrès
de Touloüse, mars 1936).
- Campagne électorale contre l'impopulaire déflation ("décrets
lois de misère"), le fascisme (qui "ne passera pas").
l'oligarchie
(des "200 familles"), pour "le pain, la paix, la liberté".
- Victoire assurée par la discipline de vote : 386 sièges (72 comm.,
149 S.F.I.O., 109 rad., 56 divers); modérés : 222.
B.
Les réalisations du ministère Léon Blum (4 juin 193620 juin 1937).
Blum forme un cabinet radical et socialiste; refus des communistes
de participer.
Double programme :
- reconstruction sociale, amélioration de la condition ouvrière;
- lutte contre la crise par l'augmentation du pouvoir d'achat et le
rajustement de la production à la consommation (t:f.
New Deal).
■ Accords Matignon (7 juin) entre représentants patronaux et ouvriers
réunis à la présidence du conseil (Hôtel Matignon) : élaboration de
conventions collectives fixant par secteurs professionnels les condi
tions du travail (salaires....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓