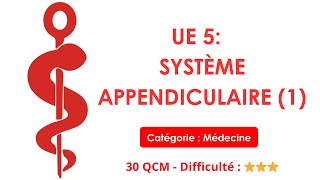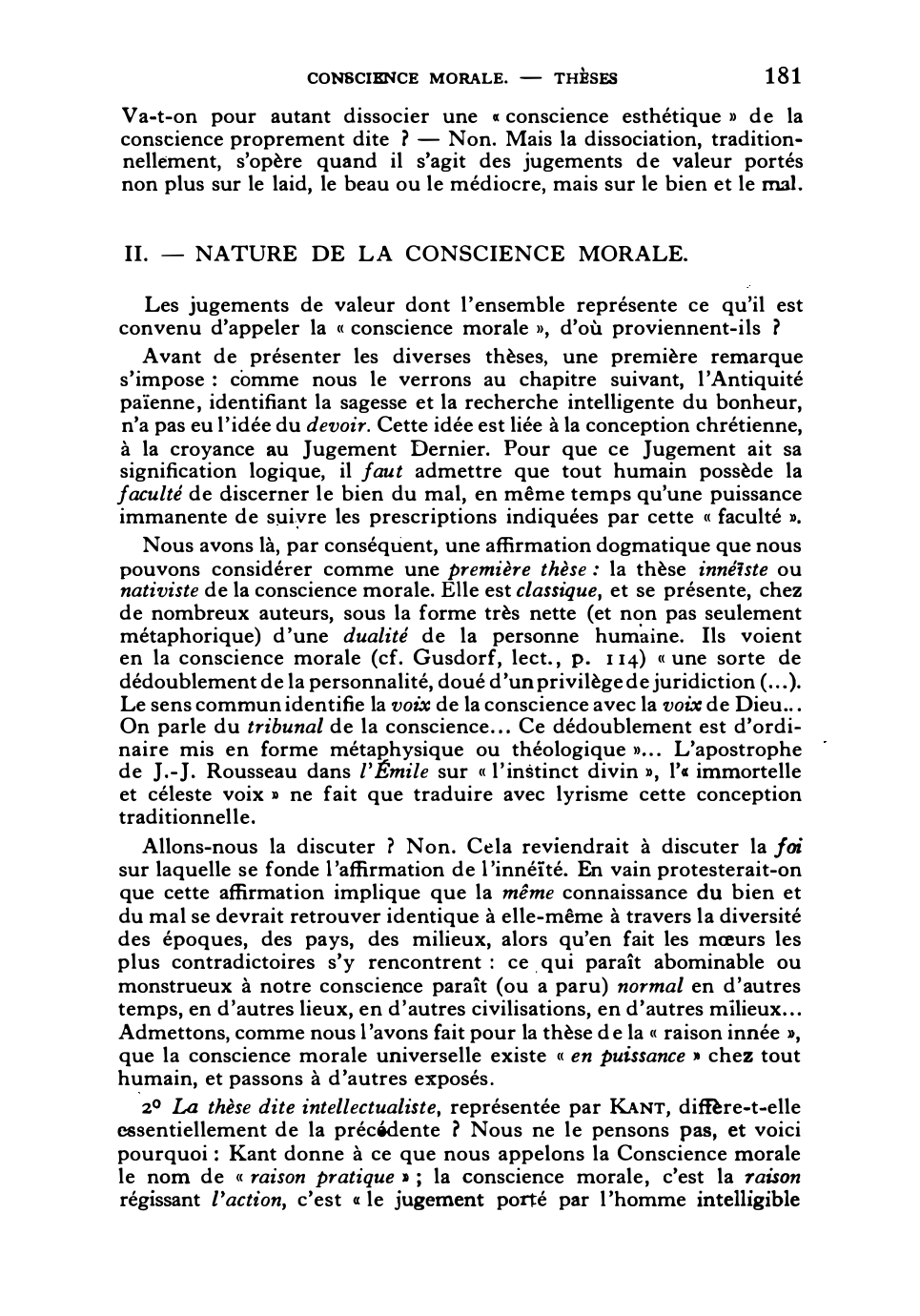La conscience morale.
Publié le 12/11/2016
Extrait du document

sur l’homme sensible » (Traduisons : le jugement que porte notre raison sur les actes où nous conduit notre sensibilité : nos émotions, nos passions, etc.)... Mais d’où vient cette « raison » ? Kant affirme qu’elle est a priori, c’est-à-dire qu’elle ne doit rien à l’expérience. Au fond, Kant, chrétien fervent, suppose bien que la « raison pratique » trouve en Dieu son fondement. Et nous sommes ramenés, implicitement, à la thèse. de l’innéïté.
3° L’empirisme utilitariste de John Stuart Mill explique par l’expérience et par l’association des idées la formation de la conscience morale individuelle. Association de l’idée des conséquences mauvaises ou bonnes de telles actions (conséquences visant l’individu et la société). Aimant d’abord ou détestant les actions en fonction de leurs conséquences, le sujet finit par aimer le bien pour le bien : phénomène de transfert analogue à celui de l’avare, aimant d’abord l’argent pour ce qu’il pourra se procurer, puis finissant par aimer l’argent pour l’argent...
La thèse est faible, et mérite à peine une réfutation. L’expérience individuelle est trop limitée. Quel âge faudrait-il atteindre pour avoir pu constater les conséquences des diverses conduites ?...
Au sens psychologique, la conscience, c'est l’intuition, plus ou moins complète, plus ou moins claire, que nous prenons de nos sensations, perceptions, souvenirs, états affectifs, etc. Toute définition de la conscience ne peut être qu'approximative, puisqu'il s'agit d'un fait de synthèse, qui nous apparaît comme une donnée première. Il serait hors de propos d'étudier ici (nous l’avons fait dans un autre ouvrage) les éléments biologiques, sociaux et différentiels qui entrent dans cette synthèse. Contentons-nous de rappeler que la conscience psychologique a des degrés, et que nul auteur contemporain ne refuse plus d ’admettre ce qui, primitivement, faisait figure de paradoxe, à savoir que tout fait psychique n'est pas nécessairement conscient. La conscience est d’autant plus vive que la résistance éprouvée est plus grande, (C’est ce que l'on appelle parfois la « loi de l'obstacle »)...
Les actes ou les impressions qui n’exigent pas une « adaptation » nouvelle ou renouvelée tendent vers l’automatisme, vers l’inconscience.
Moitié par métaphore, moitié par anthropomorphisme, la conscience psychologique est volontiers imaginée comme un second Moi (un second homme, à l’intérieur du premier), un « spectateur attaché au rivage » (Dugald Stewart).

«
CONSCIENCE
MORALE.
-THÈSES
181
Va-t-on pour autant dissocier une • conscience esthétique » de la
conscience proprement dite ? - Non.
Mais la dissociation, tradition
nellement, s'opère quand il s'agit des jugements de valeur portés
non plus sur le laid, le beau ou le médiocre, mais sur le bien et le mal.
Il.
-NATURE DE LA CONSCIENCE MORALE.
Les jugements de valeur dont l'ensemble représente ce qu'il est
convenu d'appeler la «conscience morale », d'où proviennent -ils ?
Avant de présenter les diverses thèses, une première remarque
s'i mpose : comme nous le verrons au chapitre suivant, l'Antiquité
païenne , identifiant la sagesse et la recherche intelligente du bonheur,
n'a pas eu l'idée du devoir.
Cette idée est liée à la conception chrétienne,
à la croyance au Jugement Dernier.
Pour que ce Jugement ait sa
signification logique, il faut admettre que tout humain possède la
facu lté de discerner le bien du mal, en même temps qu'une puissance
immanente de suivre les prescriptions indiquées par cette « fa culté ».
Nous avons là, par conséquent, une affirmation dogmatique que nous
pouvons considérer comme une première thèse : la thèse innéiste ou
nativiste de la conscience morale.
Elle est class ique, et se présente, chez
de nombreux auteurs, sous la forme très nette (et non pas seulement
métaphorique) d'une dualité de la personne humaine.
Ils voient
en la conscience morale (cf.
Gusdorf, lect., p.
114) «une sorte de
dédoublement de la personnalité, doué d'un privilège de juridiction ( ...
).
Le sens commun identifie la voix de la conscience avec la voix de Dieu ..
.
On parle du tribunal de la conscience ...
Ce dédoublement est d'ordi
naire mis en forme métaphysique ou théologique "··.
L'apostrophe
de J.-J.
Rousseau dans l'Émile sur «l'instinct divin», l'• immort elle
et céleste voix • ne fait que traduire avec lyrisme cette conception
traditionnel le.
Allons-nous la discuter ? Non.
Cela reviendrait à discuter la foi
sur laquelle se fonde 1 'affirmation de 1 'innéité.
En vain protesterait-on
que cette affirmat ion implique que la même connaissance du bien et
du mal se devrait retrouver identique à elle-m ême à travers la diversité
des époques, des pays, des milieux, alors qu'en fait les mœurs les
plus contradictoires s'y rencontrent : ce , qui paraît abominable ou
monstrueux à notre conscien ce paraît (ou a paru) normal en d'autres
temps, en d'autres lieux, en d'a utres civilisations, en d'a utres milieux ...
Admettons, comme nous 1 'avons fait pour la thèse de la « raison innée »,
que la conscience morale universelle existe « en puissance • chez tout
humain, et passons à d' autres exposés .
zo La thèse dite intellectuali ste, représentée par KANT, diffère-t-elle
essentiellement de la précédente ? Nous ne le pensons pas, et voici
pourquoi : Kant donne à ce que nous appelons la Conscience morale
le nom de «raison pratique • ; la conscience morale, c'est la raison
régissant l'action, c'est «le jugement porté par l'homme intelligible.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on s'affranchir DE LA CONSCIENCE MORALE ?
- Kant: la conscience morale est innée
- Nature de la conscience morale. PLAN.
- KANT: Peut-on s'affranchir de la conscience morale ?
- Kant et la conscience morale