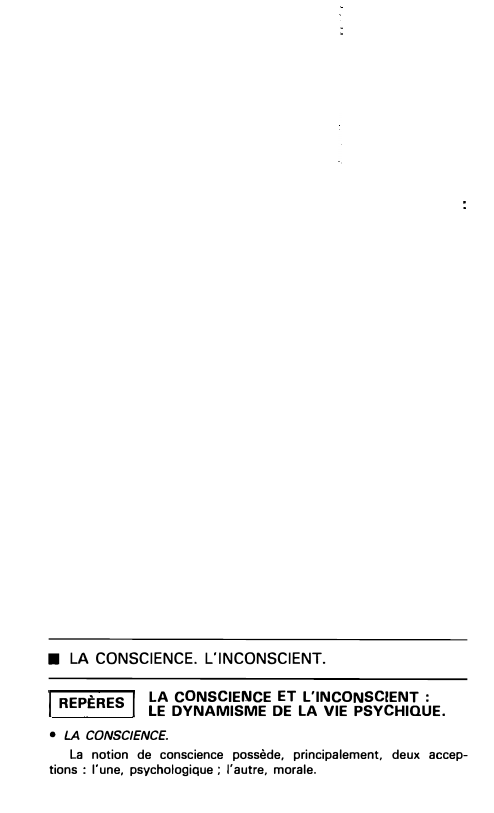■ LA CONSCIENCE. L'INCONSCIENT. 1 REPÈRES 1 . . E ET L'INCONSCIENT : IE A � CONSC NC LE DYNAMISME...
Extrait du document
«
■ LA CONSCIENCE.
L'INCONSCIENT.
1 REPÈRES 1
.
.
E ET L'INCONSCIENT :
IE
A
� CONSC NC
LE DYNAMISME DE LA VIE PSYCHIQUE.
• LA CONSCIENCE.
La notion de conscience possède, principalement, deux accep
tions : l'une, psychologique; l'autre, morale.
s'éprouve une première certitude : l'existence d'une activité originaire
de réflexion qui implique en elle l'existence tout court (la fameuse
« chose pensante » dont le cogito est à la fois la révélation et la
manifestation).
Une telle « expérience » signale la dissociation possi
ble des multiples actes psychiques et du pouvoir spontané de « mise
à distance » et de réflexion qui se manifeste en eux et reste, en
droit, irréductible à telle ou telle opinion, telle ou telle représentation.
Dans une autre perspective et un autre contexte, Sartre décrit la
découverte singulière de la conscience d'exister.
« en deçà » de toute
détermination concrète et de tout donné (cf.
les célèbres descriptions
de La Nausée).
Paradoxalement, le cheminement de la pensée
conduit à une « remontée•>> vers le fait perçu comme premier et
indérivable : le caractère contingent (non nécessaire) de l'existence,
qui s· appréhende désormais à travers une conscience épurée, où l'in
tuition première du fait même d'exister relativise toute détermination
du donné (Sartre parle, à propos d'une telle intuition, de « cogito
préréflexif 11).
- En fait, les différents aspects de la conscience qui viennent
d'être évoqués ne peuvent rendre compte de la totalité du psychisme
saisi dans son fonctionnement.
La conscience, plus ou moins claire,
plus ou moins complète, n'implique pas forcément connaissance ex
plicite de toutes les données psychiques.
Sociologie et psychologie
ont depuis longtemps souligné que la conscience humaine peut être
saisie comme un produit autant que comme une donnée originaire.
Il
suffit pour cela de préciser l'acception que l'on donne au mot lui
même ; si, en tant que faculté virtuelle de représentation et de dis
tanciation, la conscience semble c< indérivable », en fait, concrète
ment, dans la mise en œuvre d'un tel pouvoir, elle suppose un
certain nombre de conditions et de processus de formation sans les
quels elle ne pourrait se constituer.
La psychologie génétique de Pia
get (cf.
La Psychologie de l'intelligence, Èditîons A.
Colin) ; la théorie
psychogénétique de Freud (cf.
Trois Essais sur la théorie de la sexua
lité, Èditions Gallimard, collection « Idées ))) ; le point de vue sociogé
nétique et historique de Marx et Engels (cf.
L 'Idéologie allemande,
Éditions Sociales, pages 59 et 60) ou de Durkheim : autant de
conceptions qui incitent à relativiser l'idée d'une conscience précons
tituée et l'illusion idéaliste d'une conscience définie une bonne fois
pour toutes.
► Point de vue moral.
Sur le plan moral, le terme « conscience » désigne généralement
une faculté de discerner le bien du mal, et de fixer à l'action des
normes correspondant à une certaine conception du bien et du mal.
Qu'une telle faculté soit innée (Rousseau : « conscience, instinct di
vin 1 »l ou acquise, cela dépend de la représentation que l'on se fait
du statut des valeurs morales mais aussi de l'origine des « évalua
tions » qui conduisent à valoriser tel acte et à condamner tel autre.
Sur ce point, Pascal, Nietzsche.
Spinoza, Rousseau, Freud, Marx,
Reich ont développé des thèses très différentes.
renvoyant à des
problématiques distinctes.
Des questions devenues classiques pour
raient alimenter efficacement la réflexion : quelles raisons avons-nous
de penser qu'il existe une conscience morale innée 7 Faut-il admet
tre, avec l'historicité et la relativité culturelle des normes morales, le
caractère illusoire de l'idée de conscience morale innée 7 etc.
{corré
lations : nature et culture, le droit.
la justice).
• APPROCHE DU CONCEPT D'INCONSCIENT.
Pour alimenter la réflexion sur une notion souvent floue, mal
définie, et utilisée sans rigueur, nous nous contenterons de rappeler
la théorie freudienne à travers trois points fondamentaux :
a) la nécessité de l'hypothèse freudienne;
b) la définition de la réalité de l'inconscient ;
c) les principaux aspects théoriques du concept d'inconscient.
Précisons, avant d'analyser chacun de ces points, que l'inconscient ne peut être défini que différentiellement, c· est-à-dire au sein
d'un corpus théorique mettant d'autres concepts en jeu.
L'étiologie
(étude génétique) des névroses, la technique des associations libres,
la configuration du psychisme, la psychogenèse de la personnalité
constituent autant de cadres dans lesquels une telle définition prend
sens et valeur.
Ainsi, l'inconscient n'est constitué comme réalité
scientifique que par une théorie systématique que nous ne pouvons
exposer ici de façon exhaustive, mais dont nous signalons les princi
paux éléments (pour développer cette approche, on pourra se repor
ter essentiellement à l'article «Inconscient», dans la Métapsycholo
gie de Freud, Éditions Gallimard, collection « Idées»).
a) la nécessité de l'hypothèse freudienne.
Récusant la réduction du sens à l'intention consciente (introspec
tion).
Freud relève un certain nombre de phénomènes qui ne reçoi
vent aucun statut dans la psychologie traditionnelle : symptômes,
rêves, lapsus, etc.
Il caractérise la conscience comme une > {cf.
Anthropologie).
Première approche : la volonté comme faculté spécifique, dont
l'efficace propre signale d'emblée /'originalité de l'être humain.
Aristote : « Avoir en soi-même le principe de ses actes, c'est
· avoir aussi en soi la possibilité de les exécuter ou non ll (Éthique à
Nicomaque, 111, 1, § 6).
Faculté spécifique d'être à l'origine d'actions
définies, la volonté ne se distinguerait pas du désir ou de l'instinct si
elle ne comportait pas cette dimension de conscience réfléchie qui en
fait une donnée proprement humaine.
Aristote écrit un peu plus
loin : « Ce qui est volontaire semble être ce dont le principe se
trouve dans l'agent qui connaît toutes les circonstances particulières
de l'action >> {idem, 111, 1, § 20).
Une telle définition du volontaire interdit toute conception méca
niste de la volonté, dont les décisions seraient nécessairement déter
minées, comme par exemple les mouvements d'une balance en fonc
tion des poids posés sur les plateaux.
On peut donc dire, à la limite,
qu'une action est plus ou moins volontaire selon qu'elle est plus....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓