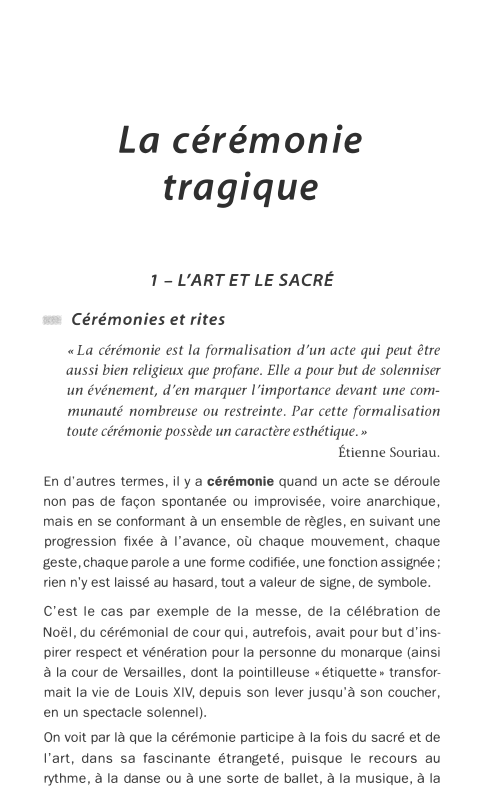La cérémonie tragique 7 - L'ART ET LE SACRÉ - Cérémonies et rites « La cérémonie est la formalisation d'un...
Extrait du document
«
La cérémonie
tragique
7 - L'ART ET LE SACRÉ
- Cérémonies et rites
« La cérémonie est la formalisation d'un acte qui peut être
aussi bien religieux que profane.
Elle a pour but de solenniser
un événement, d'en marquer l'importance devant une com
munauté nombreuse ou restreinte.
Par cette formalisation
toute cérémonie possède un caractère esthétique.
»
Étienne Souriau.
En d'autres termes, il y a cérémonie quand un acte se déroule
non pas de façon spontanée ou improvisée, voire anarchique,
mais en se conformant à un ensemble de règles, en suivant une
progression fixée à l'avance, où chaque mouvement, chaque
geste, chaque parole a une forme codifiée, une fonction assignée;
rien n'y est laissé au hasard, tout a valeur de signe, de symbole.
C'est le cas par exemple de la messe, de la célébration de
Noël, du cérémonial de cour qui, autrefois, avait pour but d'ins
pirer respect et vénération pour la personne du monarque (ainsi
à la cour de Versailles, dont la pointilleuse «étiquette» transfor
mait la vie de Louis XIV, depuis son lever jusqu'à son coucher,
en un spectacle solennel).
On voit par là que la cérémonie participe à la fois du sacré et de
l'art, dans sa fascinante étrangeté, puisque le recours au
rythme, à la danse ou à une sorte de ballet, à la musique, à la
parure, à des paroles stylisées, engendre un rituel propre à
mettre ceux qui officient et ceux qui regardent dans un état
presque second, à susciter comme un frisson intérieur, et même
un ravissement ou une exaltation.
Ce n'est pas sans raison que l'on confond parfois la cérémonie
avec un rituel: le "rite• est également la formalisation d'un
acte, d'un geste, d'un langage; lui aussi possède un caractère
répétitif et communautaire; religieux, il n'est pas une simple
représentation, il est considéré comme efficace par lui-même;
sa valeur est quasi magique et on ne peut ni le supprimer ni le
déformer sans nuire à la validité de la cérémonie: le prêtre doit
prononcer, à tel ou tel moment, telle ou telle parole, le fidèle
s'agenouiller ou se lever...
Comme la cérémonie, le rite sacra
lise, solennise, imprégné de beauté tout autant que de piété.
Dans le même domaine on emploie le mot de liturgie pour dési
gner l'ensemble des rites qui constituent un culte public - litur
gies de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe - et relèvent
d'un art total, qui, avec ses prières, ses chants, ses encense
ments, ses gestes solennels, s'adresse à tous les sens (la vue,
l'ouïe, l'odorat, voire le goût, le toucher}, en une mystérieuse
alchimie.
« Cérémonie, rite, liturgie", il y a là comme une constel
lation de mots qui rendent on ne peut mieux compte de la repré
sentation théâtrale en général, de la tragédie en particulier.
• Les fastes tragiques
Voilà donc qu'une communauté, plus ou moins importante, se
réunit en un lieu donné, un bâtiment réservé à cet usage, pour
assister ou plutôt participer à une représentation dramatique!
On a vu (voir• La dramaturgie antique", p.
16) que, chez les
Grecs, la tragédie se situait au carrefour du sacré et du profane,
que c'était une cérémonie dans les deux sens du terme: un
rituel religieux, civique, et une manifestation artistique.
Ce n'est
pas un hasard si le mot grec de « liturgie• signifie en premier
lieu "service public»; désignés d'office, les citoyens les plus
riches équipaient à leurs frais les choristes et les acteurs.
Les
représentations se déroulaient au cours de certaines fêtes reli
gieuses, dans l'enceinte consacrée au dieu Dionysos.
« Tous les Athéniens assistaient à ces solennités; les poèmes
tragiques étant une forme de culte, aucun citoyen ne devait en
être tenu à l'écart; les femmes même, que la vie antique
confinait habituellement dans le gynécée, y étaient admises.
Dans le cours du V' siècle, on institua des allocations qui per
mettaient aux citoyens pauvres de payer les deux oboles exi
gées à l'entrée.
»
J.
Humbert et H.
Berguin.
Et la différence ne devait guère être sensible entre une cérémo
nie religieuse proprement dite et le savant rituel tragique, avec
ses danses et ses déclamations, ses personnages hiératiques
et ses paroles versifiées, sa progression dramatique codifiée et
sa constante harmonie, son étrange beauté.
Que se passera-t-il au XV118 siècle, quand la tragédie deviendra
un spectacle purement profane, destiné à une élite, ou tout sim
plement une œuvre littéraire? Une cérémonie encore se dérou
lera, à divers titres.
Puisque les drames hantent les palais
royaux, puisque les héros tragiques n'appartiennent pas au com
mun des mortels, puisque ce ne sont que rois, reines, princes et
princesses ou grands de ce monde- et les acteurs du temps
portent le costume de cour; ils ont panaches de plumes, cui
rasses dorées, lourdes robes à traînes-, c'est l'étiquette qui
régit, sur le théâtre, leurs rapports, leurs paroles et leurs gestes.
Le vouvoiement est de rigueur (sauf lorsque, chez Racine, la pas
sion explose et fait tomber les masques), on échange des titres
cérémonieux: «Sire...
Prince ...
Seigneur ...
Madame...»; et les
protagonistes ne vont jamais ou rarement sans leurs ombres
obligées, ces «confidents" ou «confidentes»; ces suivants qui
ne sont pas là seulement pour écouter ou conseiller mais aussi
pour marquer avec éclat le rang considérable de leurs maîtres.
Une société monarchique et aristocratique- celle qui occupe les
loges et qui donne le ton - se contemple, fascinée, dans le
miroir flatteur de la tragédie: de part et d'autre de la rampe, le
microcosme social et le microcosme théâtral, le «monde» et le
noble «genre•, sont comme les reflets l'un de l'autre.
Et l'esthé
tique est la même, à la ville (ou à la cour) et à la scène, qui privi-
légie le grand et le majestueux, le solennel et le pompeux, le lan
gage poétique ou délicat, les belles tirades et les passions extra
ordinaires, les ornements de la rhétorique et les sentiments hors
du commun.
La tragédie racinienne est, de ce point de vue, par
ticulièrement significative: nourrie du modèle antique, toute bai
gnée par la lumière du Roi-Soleil, elle ne cesse de tendre vers
une ordonnance liturgique, jusqu'à restaurer les chœurs et la
musique dans Esther et Athalie, les deux dernières....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓