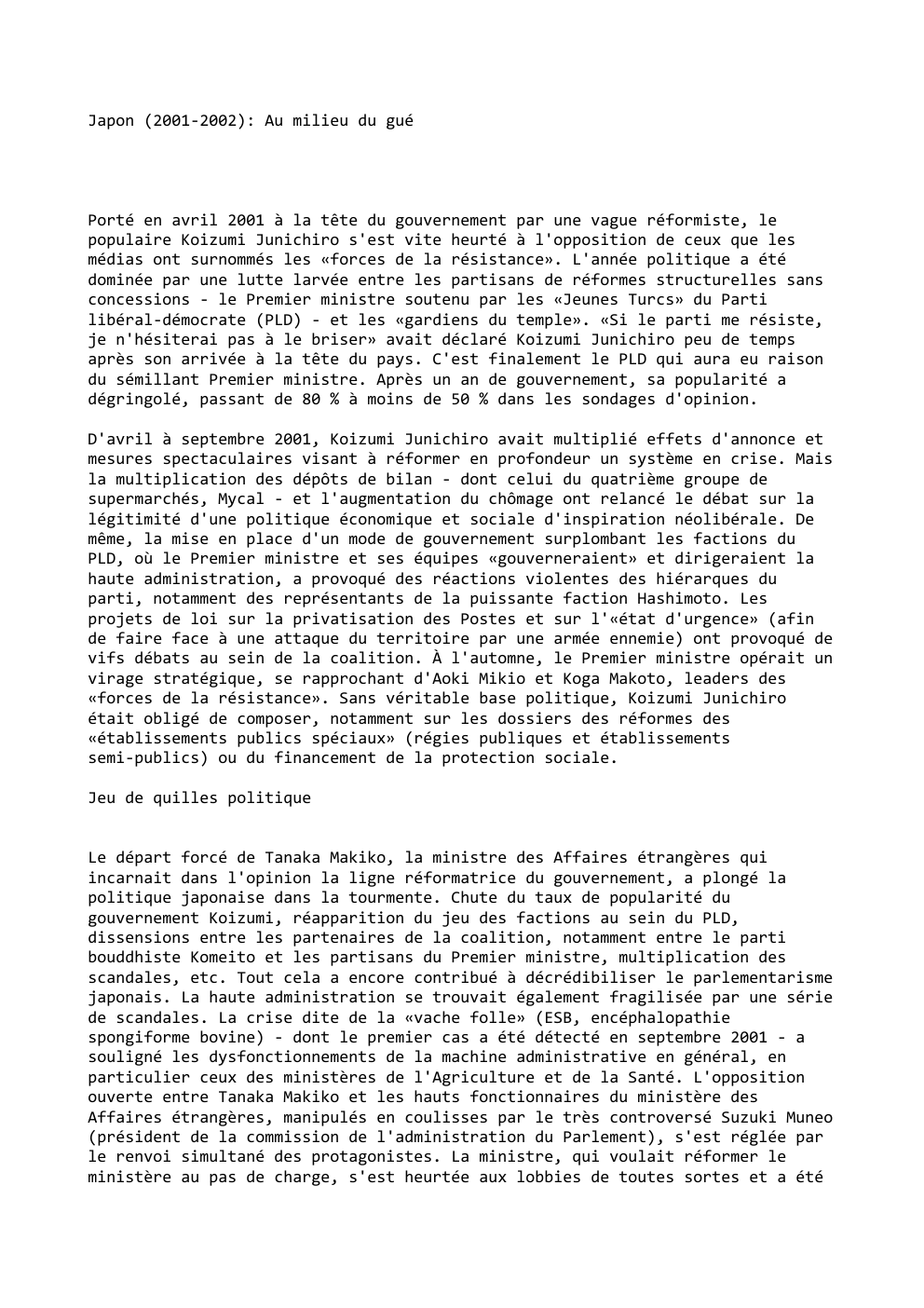Japon (2001-2002): Au milieu du gué Porté en avril 2001 à la tête du gouvernement par une vague réformiste, le...
Extrait du document
«
Japon (2001-2002): Au milieu du gué
Porté en avril 2001 à la tête du gouvernement par une vague réformiste, le
populaire Koizumi Junichiro s'est vite heurté à l'opposition de ceux que les
médias ont surnommés les «forces de la résistance».
L'année politique a été
dominée par une lutte larvée entre les partisans de réformes structurelles sans
concessions - le Premier ministre soutenu par les «Jeunes Turcs» du Parti
libéral-démocrate (PLD) - et les «gardiens du temple».
«Si le parti me résiste,
je n'hésiterai pas à le briser» avait déclaré Koizumi Junichiro peu de temps
après son arrivée à la tête du pays.
C'est finalement le PLD qui aura eu raison
du sémillant Premier ministre.
Après un an de gouvernement, sa popularité a
dégringolé, passant de 80 % à moins de 50 % dans les sondages d'opinion.
D'avril à septembre 2001, Koizumi Junichiro avait multiplié effets d'annonce et
mesures spectaculaires visant à réformer en profondeur un système en crise.
Mais
la multiplication des dépôts de bilan - dont celui du quatrième groupe de
supermarchés, Mycal - et l'augmentation du chômage ont relancé le débat sur la
légitimité d'une politique économique et sociale d'inspiration néolibérale.
De
même, la mise en place d'un mode de gouvernement surplombant les factions du
PLD, où le Premier ministre et ses équipes «gouverneraient» et dirigeraient la
haute administration, a provoqué des réactions violentes des hiérarques du
parti, notamment des représentants de la puissante faction Hashimoto.
Les
projets de loi sur la privatisation des Postes et sur l'«état d'urgence» (afin
de faire face à une attaque du territoire par une armée ennemie) ont provoqué de
vifs débats au sein de la coalition.
À l'automne, le Premier ministre opérait un
virage stratégique, se rapprochant d'Aoki Mikio et Koga Makoto, leaders des
«forces de la résistance».
Sans véritable base politique, Koizumi Junichiro
était obligé de composer, notamment sur les dossiers des réformes des
«établissements publics spéciaux» (régies publiques et établissements
semi-publics) ou du financement de la protection sociale.
Jeu de quilles politique
Le départ forcé de Tanaka Makiko, la ministre des Affaires étrangères qui
incarnait dans l'opinion la ligne réformatrice du gouvernement, a plongé la
politique japonaise dans la tourmente.
Chute du taux de popularité du
gouvernement Koizumi, réapparition du jeu des factions au sein du PLD,
dissensions entre les partenaires de la coalition, notamment entre le parti
bouddhiste Komeito et les partisans du Premier ministre, multiplication des
scandales, etc.
Tout cela a encore contribué à décrédibiliser le parlementarisme
japonais.
La haute administration se trouvait également fragilisée par une série
de scandales.
La crise dite de la «vache folle» (ESB, encéphalopathie
spongiforme bovine) - dont le premier cas a été détecté en septembre 2001 - a
souligné les dysfonctionnements de la machine administrative en général, en
particulier ceux des ministères de l'Agriculture et de la Santé.
L'opposition
ouverte entre Tanaka Makiko et les hauts fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères, manipulés en coulisses par le très controversé Suzuki Muneo
(président de la commission de l'administration du Parlement), s'est réglée par
le renvoi simultané des protagonistes.
La ministre, qui voulait réformer le
ministère au pas de charge, s'est heurtée aux lobbies de toutes sortes et a été
«démissionnée» en même temps que son vice-ministre (haut fonctionnaire).
Le
parlementaire Suzuki Muneo, très influent dans la distribution de l'aide
publique à l'Afrique et à la Russie, a finalement été arrêté pour ses
malversations.
Cette affaire a ouvert la boîte de Pandore.
Soupçonné de corruption, Endo
Toshio, le gouverneur de la préfecture de Tokushima, a été arrêté en mars 2002.
Sato Saburo, l'ancien bras droit du politicien Kato Koichi, a été interpellé le
même mois dans une affaire de fraude fiscale à grande échelle.
Son ancien chef,
l'un des ténors de la politique japonaise et allié du Premier ministre, a ainsi
été contraint de démissionner du PLD.
La députée socialiste Tsujimoto Kiyomi,
qui incarnait le renouveau de la politique et était souvent présentée comme la
voix des réseaux militants et citoyens, est également tombée, victime d'une
affaire de détournement des salaires d'assistants parlementaires.
(Plusieurs
parlementaires, dont Tanaka Makiko, ont fait l'objet de la même accusation.)
Outre les scandales politico-financiers de Kato Koichi et de Suzuki Muneo, la
révélation de la liaison adultérine du secrétaire général du PLD, Yamasaki Taku,
avec une jeune femme de 29 ans proche de la secte Moon a renforcé les sentiments
hostiles à l'égard du PLD.
En avril-mai 2002, deux élections partielles sur
trois (sénatoriale de Niigata, élection du gouverneur de Tokushima et
législative de Wakayama) ont vu la défaite des candidats de ce parti.
Chômage : le phénomène nippon
Cette crise du politique est intervenue dans un environnement économique et
social de plus en plus dégradé.
Le PIB japonais a baissé de 1,2 % lors du
dernier trimestre de 2001 - le troisième trimestre consécutif de baisse pour la
première fois depuis neuf ans - et a enregistré une chute de 0,4 % sur toute
l'année.
Le chômage est devenu une véritable préoccupation nationale.
Même si
les chiffres s'étaient améliorés en 2002 (5,4 % de la population active), les
prévisions fixaient à court terme une remontée à hauteur de 6 %.
La situation
est particulièrement difficile pour les jeunes diplômés et les salariés de 40-50
ans.
Le nombre des chômeurs (3,44 millions selon les catégories officielles en
janvier 2002) s'élèverait, de fait, plutôt à six millions.
Selon les estimations
du ministère du Travail, un diplômé d'université sur quatre aurait renoncé à
chercher un emploi.
Depuis les années 1980, le nombre de freeters (ces jeunes
qui vivent de petits boulots, changent souvent d'emploi et ne sont pas
comptabilisés comme chômeurs) a été multiplié par trois, dépassant désormais les
deux millions.
Les régions, en particulier Osaka et Okinawa, sont plus touchées par le chômage
que Tokyo.
Les secteurs qui représentaient la force des économies régionales,
BTP, distribution, crédit mutuel, etc., souffrent des restructurations.
La
politique gouvernementale de soutien à l'emploi et l'injection de 350 milliards
de yens (près de 3 milliards €) de fonds publics se sont révélées bien
inefficaces.
Les milieux syndicaux et patronaux se sont faits les avocats d'une
politique nationale de partage du temps de travail (work-sharing).
Mais celle-ci
restait conçue uniquement comme un outil de rationalisation économique au profit
des grands groupes industriels.
Ce sont notamment les entreprises de
l'électronique grand public qui ont introduit le «partage» du temps de travail,
diminuant les heures travaillées pour réduire les coûts salariaux.
Les conséquences sociales, encore difficiles à évaluer, semblaient graves.
Depuis le milieu des années 1990, le nombre des suicides a dépassé les 30 000,
la part de la génération des 50-59 ans ayant fortement augmenté.
Au sein des
pays développés, le Japon détient le triste record du plus fort taux de suicides
chez les moins de 20 ans et les plus de 50 ans.
La politique de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓