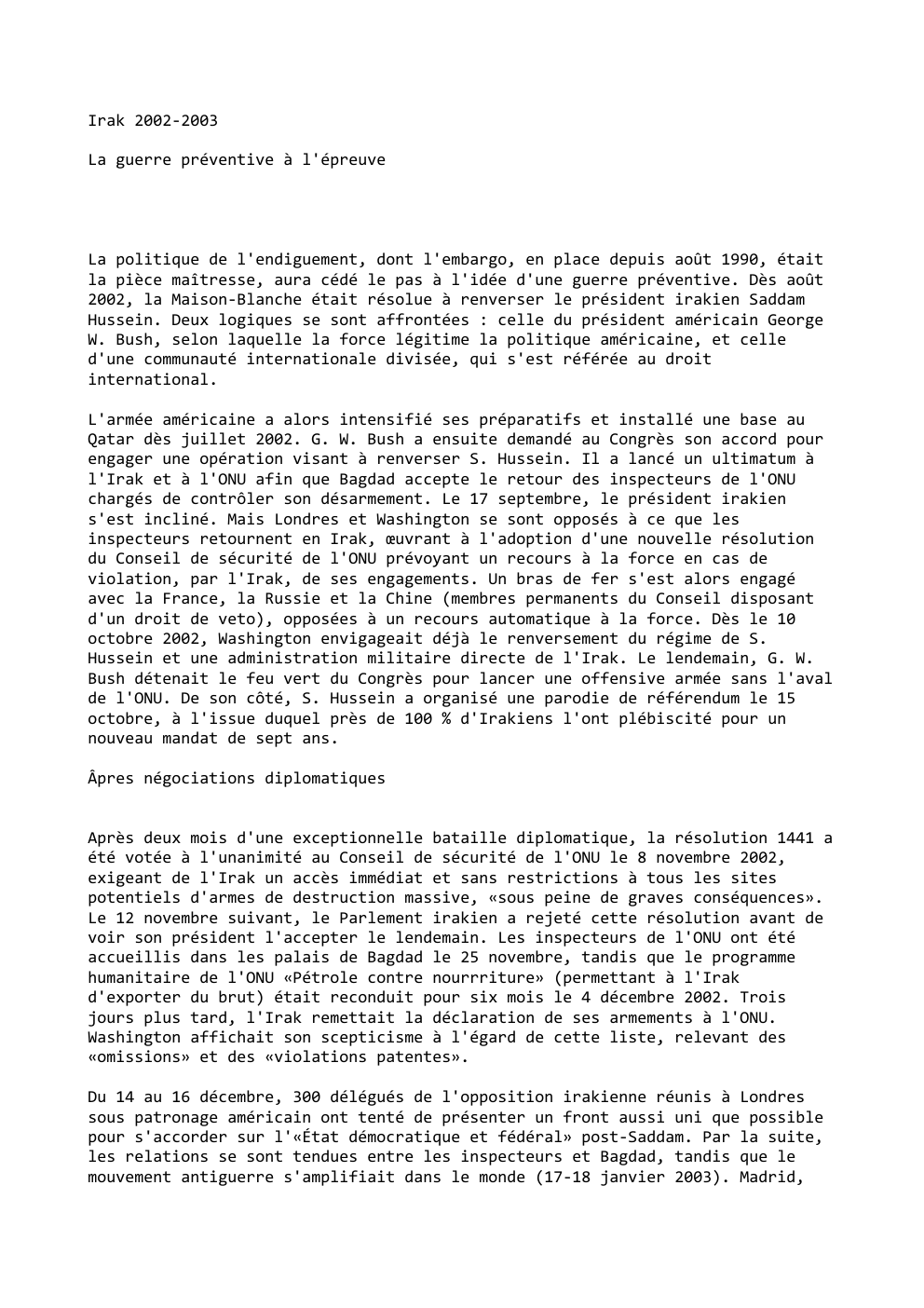Irak 2002-2003 La guerre préventive à l'épreuve La politique de l'endiguement, dont l'embargo, en place depuis août 1990, était la...
Extrait du document
«
Irak 2002-2003
La guerre préventive à l'épreuve
La politique de l'endiguement, dont l'embargo, en place depuis août 1990, était
la pièce maîtresse, aura cédé le pas à l'idée d'une guerre préventive.
Dès août
2002, la Maison-Blanche était résolue à renverser le président irakien Saddam
Hussein.
Deux logiques se sont affrontées : celle du président américain George
W.
Bush, selon laquelle la force légitime la politique américaine, et celle
d'une communauté internationale divisée, qui s'est référée au droit
international.
L'armée américaine a alors intensifié ses préparatifs et installé une base au
Qatar dès juillet 2002.
G.
W.
Bush a ensuite demandé au Congrès son accord pour
engager une opération visant à renverser S.
Hussein.
Il a lancé un ultimatum à
l'Irak et à l'ONU afin que Bagdad accepte le retour des inspecteurs de l'ONU
chargés de contrôler son désarmement.
Le 17 septembre, le président irakien
s'est incliné.
Mais Londres et Washington se sont opposés à ce que les
inspecteurs retournent en Irak, œuvrant à l'adoption d'une nouvelle résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU prévoyant un recours à la force en cas de
violation, par l'Irak, de ses engagements.
Un bras de fer s'est alors engagé
avec la France, la Russie et la Chine (membres permanents du Conseil disposant
d'un droit de veto), opposées à un recours automatique à la force.
Dès le 10
octobre 2002, Washington envigageait déjà le renversement du régime de S.
Hussein et une administration militaire directe de l'Irak.
Le lendemain, G.
W.
Bush détenait le feu vert du Congrès pour lancer une offensive armée sans l'aval
de l'ONU.
De son côté, S.
Hussein a organisé une parodie de référendum le 15
octobre, à l'issue duquel près de 100 % d'Irakiens l'ont plébiscité pour un
nouveau mandat de sept ans.
Âpres négociations diplomatiques
Après deux mois d'une exceptionnelle bataille diplomatique, la résolution 1441 a
été votée à l'unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU le 8 novembre 2002,
exigeant de l'Irak un accès immédiat et sans restrictions à tous les sites
potentiels d'armes de destruction massive, «sous peine de graves conséquences».
Le 12 novembre suivant, le Parlement irakien a rejeté cette résolution avant de
voir son président l'accepter le lendemain.
Les inspecteurs de l'ONU ont été
accueillis dans les palais de Bagdad le 25 novembre, tandis que le programme
humanitaire de l'ONU «Pétrole contre nourrriture» (permettant à l'Irak
d'exporter du brut) était reconduit pour six mois le 4 décembre 2002.
Trois
jours plus tard, l'Irak remettait la déclaration de ses armements à l'ONU.
Washington affichait son scepticisme à l'égard de cette liste, relevant des
«omissions» et des «violations patentes».
Du 14 au 16 décembre, 300 délégués de l'opposition irakienne réunis à Londres
sous patronage américain ont tenté de présenter un front aussi uni que possible
pour s'accorder sur l'«État démocratique et fédéral» post-Saddam.
Par la suite,
les relations se sont tendues entre les inspecteurs et Bagdad, tandis que le
mouvement antiguerre s'amplifiait dans le monde (17-18 janvier 2003).
Madrid,
Rome et Londres, mais aussi Rabat, Sanaa et Djakarta notamment, ont vu des
centaines de milliers de manifestants défiler contre la menace de guerre.
Hans Blix, chef des inspecteurs de l'ONU, et Mohamed El Baradei, directeur
général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ont remis leur
rapport à l'ONU le 27 janvier 2003, concluant qu'aucune arme de destruction
massive n'avait été trouvée.
Dès fin janvier, le déploiement des forces
américaines, britanniques et australiennes autour de l'Irak (près de cent mille
hommes) était achevé, tandis que des commandos américains opéraient dans le nord
et le sud du pays.
Le réquisitoire du secrétaire d'État américain Colin Powell
devant le Conseil de sécurité le 5 février n'a pas convaincu.
«Game is over !»
«La partie est terminée» a déclaré G.
W.
Bush le lendemain.
Washington et
Londres ont tenté en vain d'obtenir une majorité au Conseil de sécurité pour une
seconde résolution autorisant l'entrée en guerre.
Le 27 février, deux textes,
l'un américano-anglo-espagnol favorable à la guerre, l'autre
franco-russo-allemand, réclamant la poursuite des inspections, s'y sont
affrontés.
Le 13 mars, faute de majorité, G.
Bush était prêt à renoncer à un
mandat de l'ONU pour entrer en guerre.
Un ultimatum de quarante-huit heures
était fixé à S.
Hussein le 18 mars, l'ONU ayant vingt-quatre heures pour
approuver la guerre.
Les 300 inspecteurs de l'ONU quittaient l'Irak le 18 mars.
La coalition américaine disposait alors de 300 000 hommes dans le Golfe.
La chute du régime de Saddam Hussein
Baptisée Liberté pour l'Irak, la guerre a été lancée le 20 mars 2003 par des
bombardements sélectifs sur Bagdad visant la tête du pouvoir irakien sans
l'atteindre (opération Choc et stupeur).
Le général américain Tommy Franks a
dirigé les opérations auxquelles ont participé officiellement trente pays.
À
l'exeption du Royaume-Uni, l'apport de ces pays à une guerre largement
américaine fut surtout symbolique.
L'opération Choc et stupeur a ensuite pris
l'aspect d'un déluge de bombes sur Bagdad le 22 mars.
Les troupes
anglo-américaines ont envahi l'Irak à partir du Koweït.
Les GI sont rapidement
parvenus aux abords de Bagdad – autour de laquelle les unités d'élite du régime
irakien, notamment la Garde républicaine, se sont déployées – en contournant les
villes où la résistance irakienne est apparue acharnée (notamment à Bassorah,
Oum Qasr, Nasiriyya, Samawa et Karbala).
Les premiers morts et prisonniers
américains ont été montrés sur les chaînes de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓