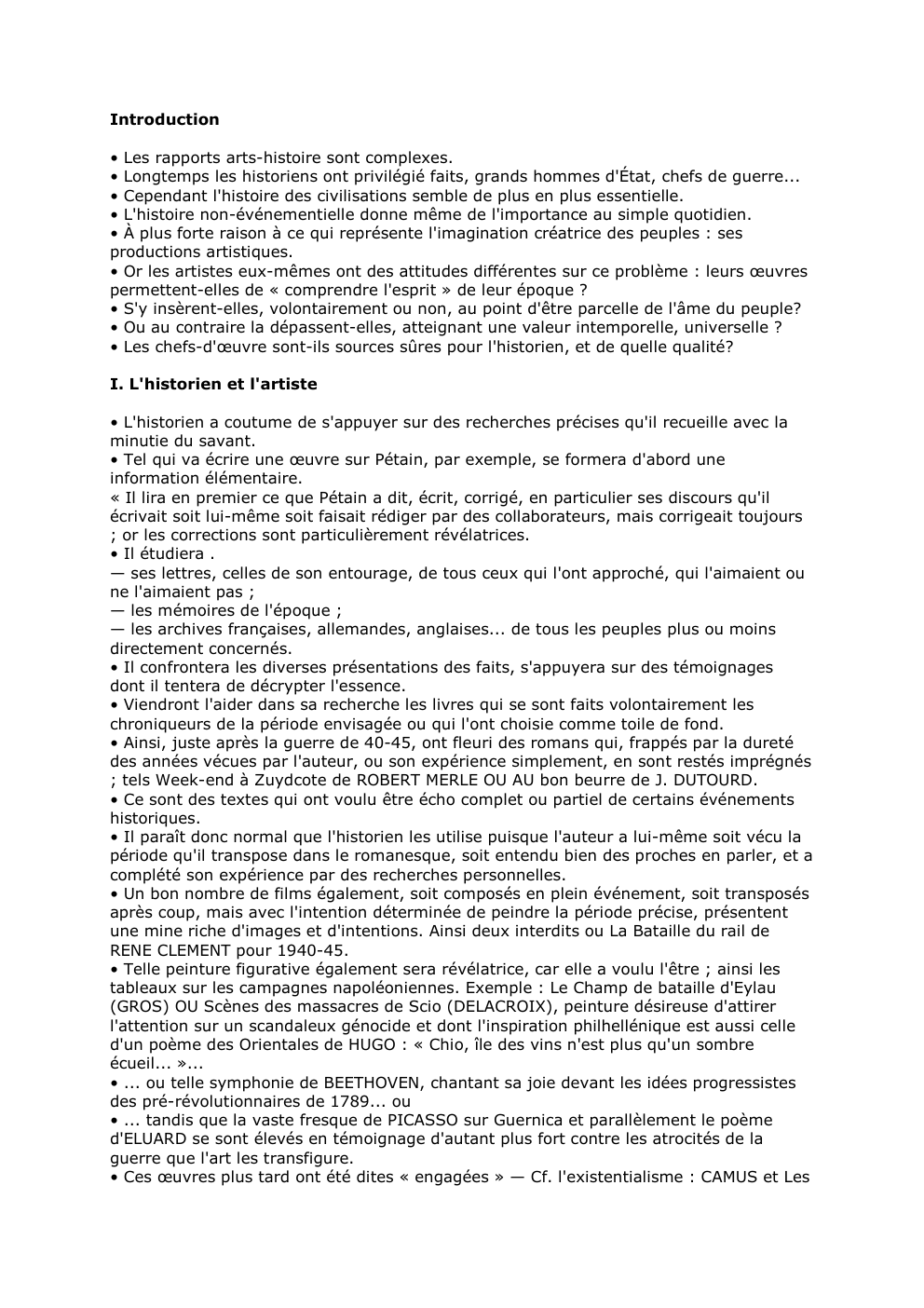Introduction • Les rapports arts-histoire sont complexes. • Longtemps les historiens ont privilégié faits, grands hommes d'État, chefs de guerre......
Extrait du document
«
Introduction
• Les rapports arts-histoire sont complexes.
• Longtemps les historiens ont privilégié faits, grands hommes d'État, chefs de guerre...
• Cependant l'histoire des civilisations semble de plus en plus essentielle.
• L'histoire non-événementielle donne même de l'importance au simple quotidien.
• À plus forte raison à ce qui représente l'imagination créatrice des peuples : ses
productions artistiques.
• Or les artistes eux-mêmes ont des attitudes différentes sur ce problème : leurs œuvres
permettent-elles de « comprendre l'esprit » de leur époque ?
• S'y insèrent-elles, volontairement ou non, au point d'être parcelle de l'âme du peuple?
• Ou au contraire la dépassent-elles, atteignant une valeur intemporelle, universelle ?
• Les chefs-d'œuvre sont-ils sources sûres pour l'historien, et de quelle qualité?
I.
L'historien et l'artiste
• L'historien a coutume de s'appuyer sur des recherches précises qu'il recueille avec la
minutie du savant.
• Tel qui va écrire une œuvre sur Pétain, par exemple, se formera d'abord une
information élémentaire.
« Il lira en premier ce que Pétain a dit, écrit, corrigé, en particulier ses discours qu'il
écrivait soit lui-même soit faisait rédiger par des collaborateurs, mais corrigeait toujours
; or les corrections sont particulièrement révélatrices.
• Il étudiera .
— ses lettres, celles de son entourage, de tous ceux qui l'ont approché, qui l'aimaient ou
ne l'aimaient pas ;
— les mémoires de l'époque ;
— les archives françaises, allemandes, anglaises...
de tous les peuples plus ou moins
directement concernés.
• Il confrontera les diverses présentations des faits, s'appuyera sur des témoignages
dont il tentera de décrypter l'essence.
• Viendront l'aider dans sa recherche les livres qui se sont faits volontairement les
chroniqueurs de la période envisagée ou qui l'ont choisie comme toile de fond.
• Ainsi, juste après la guerre de 40-45, ont fleuri des romans qui, frappés par la dureté
des années vécues par l'auteur, ou son expérience simplement, en sont restés imprégnés
; tels Week-end à Zuydcote de ROBERT MERLE OU AU bon beurre de J.
DUTOURD.
• Ce sont des textes qui ont voulu être écho complet ou partiel de certains événements
historiques.
• Il paraît donc normal que l'historien les utilise puisque l'auteur a lui-même soit vécu la
période qu'il transpose dans le romanesque, soit entendu bien des proches en parler, et a
complété son expérience par des recherches personnelles.
• Un bon nombre de films également, soit composés en plein événement, soit transposés
après coup, mais avec l'intention déterminée de peindre la période précise, présentent
une mine riche d'images et d'intentions.
Ainsi deux interdits ou La Bataille du rail de
RENE CLEMENT pour 1940-45.
• Telle peinture figurative également sera révélatrice, car elle a voulu l'être ; ainsi les
tableaux sur les campagnes napoléoniennes.
Exemple : Le Champ de bataille d'Eylau
(GROS) OU Scènes des massacres de Scio (DELACROIX), peinture désireuse d'attirer
l'attention sur un scandaleux génocide et dont l'inspiration philhellénique est aussi celle
d'un poème des Orientales de HUGO : « Chio, île des vins n'est plus qu'un sombre
écueil...
»...
• ...
ou telle symphonie de BEETHOVEN, chantant sa joie devant les idées progressistes
des pré-révolutionnaires de 1789...
ou
• ...
tandis que la vaste fresque de PICASSO sur Guernica et parallèlement le poème
d'ELUARD se sont élevés en témoignage d'autant plus fort contre les atrocités de la
guerre que l'art les transfigure.
• Ces œuvres plus tard ont été dites « engagées » — Cf.
l'existentialisme : CAMUS et Les
Justes, où se montre la volonté d'entraîner ses contemporains dans une action ; ou bien
SARTRE et Les Mains sales, pièce considérée à la création comme une possible attaque
des Staliniens —.
Voilà de nets échos d'époque.
• Mais combien d'autres artistes refusent d'être « dans » leur siècle...
• Véritable prise de position « au-dessus de la mêlée », et sens particulier donné à
l'attitude et à la place de l'artiste.
• Exemple : FLAUBERT qui veut, en ciselant son œuvre d'art, atteindre les vérités de
l'écriture loin des agitations du siècle.
Désir d'un art pur.
• Théorie de Y « art pour l'art », qui se passerait d'une inspiration prenant racine dans
l'immédiat, ne lui permettant pas le détachement nécessaire.
• Ainsi FLAUBERT s'appuiera sur le passé lointain des luttes intestines dans la Carthage
d'Hamilcar, père d'Hannibal, pour écrire Salammbô, ou HEREDIA évoquera les faits
héroïques du passé dans Les Trophées.
• On affirmera l'inutilité immédiate du chef-d'œuvre, l'art ne devant avoir d'autre but que
lui-même sans aucun souci de ce que ces auteurs nomment « l'utilité sordide ».
Ils visent
à l'impassibilité — Cf.
TH.
GAUTIER.
• Culte de la forme, de la beauté.
Écoles qui recherchent la beauté éternelle, plastique :
Alexandrins, Parnassiens, Symbolistes dont l'esthétique élaborée ne doit être souillée
d'aucune anecdote, d'aucun « reflet des désordres humains » (VALERY) et qui hait « tout
mouvement qui déplace les lignes ».
Exemple : le film Le Sourire vertical de LAPOUJADE.
• Sans être aussi systématiques, d'autres artistes semblent à première vue peindre tout
autre chose que leur époque.
Les tragédies Britannicus, Andromaque, Phèdre...
sont
situées dans des siècles révolus dont RACINE connaît si bien l'atmosphère que tel vers :
« Quand pourrai-je au travers d'une noble poussière Suivre de l'œil un char fuyant dans
la carrière ? » (Phèdre) fait ressurgir en rapide tableau à nos yeux la Grèce antique et
ses courses de char.
Belle reconstitution du passé et pas le moindre rapport apparent
avec le siècle de Louis XIV !
• Mais surtout le classicisme, intéressé par les bases générales de la nature humaine, par
sa psychologie, en recherche les pulsions essentielles, peignant à travers NERON par
exemple, ou AGRIPPINE, PYRRHUS, HERMIONE..., les passions qui sont les ressorts
humains ; faisant œuvre de moralistes.
• Ainsi veut-il atteindre une vérité générale qui échappe au Temps.
• L'historien a-t-il à faire avec de telles œuvres ?
— ou avec les pures recherches esthétiques d'une poésie qui s'évade dans les Chimères
(NERVAL) :
« Je suis le ténébreux - le veuf - l'inconsolé, Le prince d'Aquitaine à la tour abolie [...] »
Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron ;
— ou dans l'Azur (MALLARME) :
« Où fuir? Et quelle nuit hagarde
Jeter, lambeaux, jeter sur ce mépris navrant ?
— ou l'Après-midi d'un faune, qu'il soit poème ou morceau de musique ?
L'immédiate compréhension de l'époque de ces poètes par l'intermédiaire de leurs textes
n'est guère apparente !
II.
Les révélations latentes des œuvres artistiques
• À ces constatations dues souvent à des prises de position de l'artiste, il faut opposer de
nettes limites.
• D'abord — contrairement aux affirmations de ceux qui pensent, à la suite de Flaubert,
que « l'artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature...
Il
doit s'arranger de façon à faire croire à la postérité qu'il n'a pas vécu...
» — l'écrivain
n'est jamais totalement absent de son œuvre, non plus donc de son époque.
• L'Éducation sentimentale (FLAUBERT) est l'histoire d'une génération ; bien que l'on ait
reproché à FLAUBERT de n'avoir pas voulu prendre parti pour les événements de son
temps, il en est marqué et ils ressortent à travers les lignes.
• Le fait même de se refuser à être « écho » de son siècle est déjà une révélation, car il
est des époques qui réclament cette distance de la part du créateur.
Ce sont des modes
artistiques correspondant à des besoins et elles sont en rapport soit avec des
gouvernements, soit avec....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓