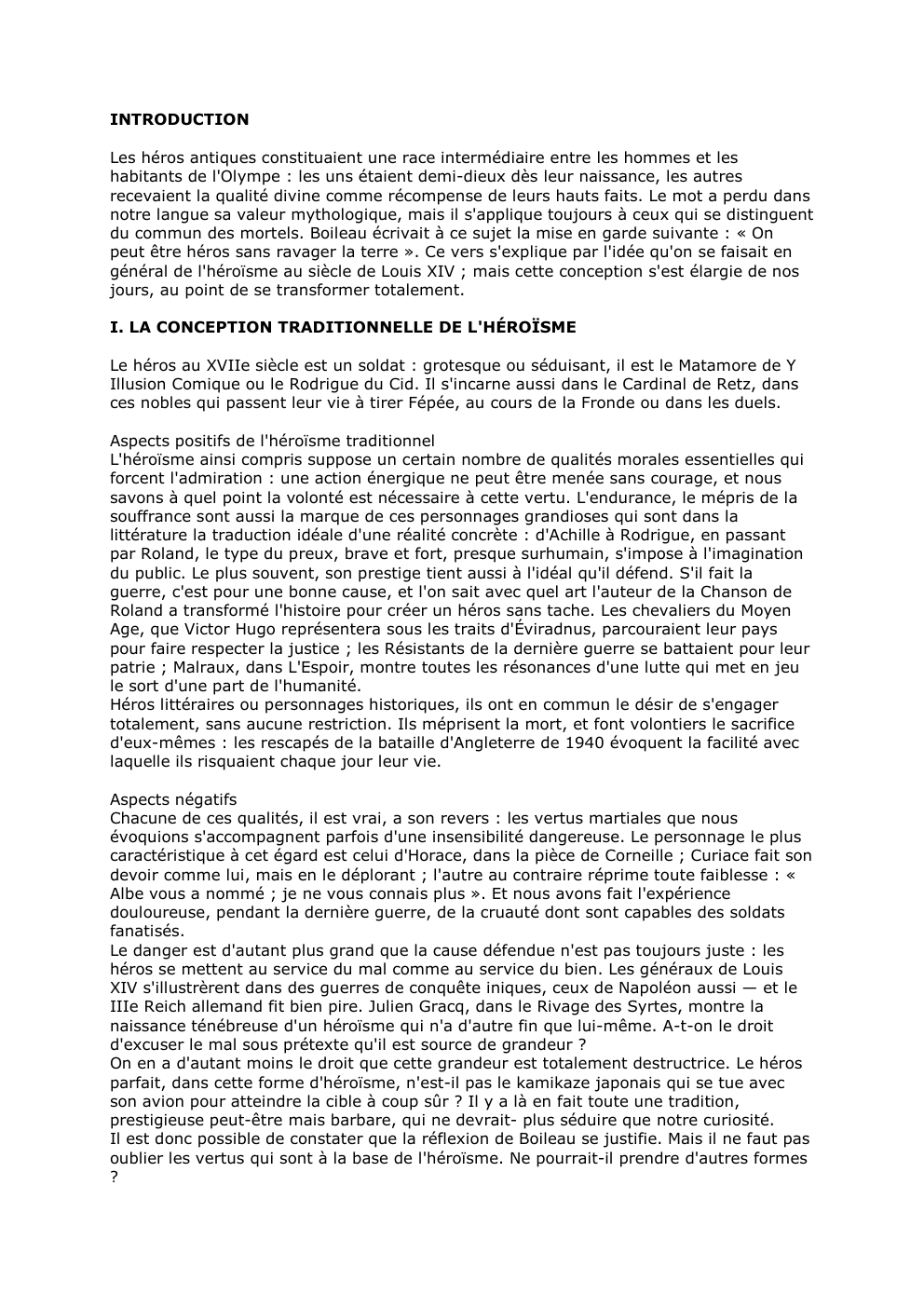INTRODUCTION Les héros antiques constituaient une race intermédiaire entre les hommes et les habitants de l'Olympe : les uns étaient...
Extrait du document
«
INTRODUCTION
Les héros antiques constituaient une race intermédiaire entre les hommes et les
habitants de l'Olympe : les uns étaient demi-dieux dès leur naissance, les autres
recevaient la qualité divine comme récompense de leurs hauts faits.
Le mot a perdu dans
notre langue sa valeur mythologique, mais il s'applique toujours à ceux qui se distinguent
du commun des mortels.
Boileau écrivait à ce sujet la mise en garde suivante : « On
peut être héros sans ravager la terre ».
Ce vers s'explique par l'idée qu'on se faisait en
général de l'héroïsme au siècle de Louis XIV ; mais cette conception s'est élargie de nos
jours, au point de se transformer totalement.
I.
LA CONCEPTION TRADITIONNELLE DE L'HÉROÏSME
Le héros au XVIIe siècle est un soldat : grotesque ou séduisant, il est le Matamore de Y
Illusion Comique ou le Rodrigue du Cid.
Il s'incarne aussi dans le Cardinal de Retz, dans
ces nobles qui passent leur vie à tirer Fépée, au cours de la Fronde ou dans les duels.
Aspects positifs de l'héroïsme traditionnel
L'héroïsme ainsi compris suppose un certain nombre de qualités morales essentielles qui
forcent l'admiration : une action énergique ne peut être menée sans courage, et nous
savons à quel point la volonté est nécessaire à cette vertu.
L'endurance, le mépris de la
souffrance sont aussi la marque de ces personnages grandioses qui sont dans la
littérature la traduction idéale d'une réalité concrète : d'Achille à Rodrigue, en passant
par Roland, le type du preux, brave et fort, presque surhumain, s'impose à l'imagination
du public.
Le plus souvent, son prestige tient aussi à l'idéal qu'il défend.
S'il fait la
guerre, c'est pour une bonne cause, et l'on sait avec quel art l'auteur de la Chanson de
Roland a transformé l'histoire pour créer un héros sans tache.
Les chevaliers du Moyen
Age, que Victor Hugo représentera sous les traits d'Éviradnus, parcouraient leur pays
pour faire respecter la justice ; les Résistants de la dernière guerre se battaient pour leur
patrie ; Malraux, dans L'Espoir, montre toutes les résonances d'une lutte qui met en jeu
le sort d'une part de l'humanité.
Héros littéraires ou personnages historiques, ils ont en commun le désir de s'engager
totalement, sans aucune restriction.
Ils méprisent la mort, et font volontiers le sacrifice
d'eux-mêmes : les rescapés de la bataille d'Angleterre de 1940 évoquent la facilité avec
laquelle ils risquaient chaque jour leur vie.
Aspects négatifs
Chacune de ces qualités, il est vrai, a son revers : les vertus martiales que nous
évoquions s'accompagnent parfois d'une insensibilité dangereuse.
Le personnage le plus
caractéristique à cet égard est celui d'Horace, dans la pièce de Corneille ; Curiace fait son
devoir comme lui, mais en le déplorant ; l'autre au contraire réprime toute faiblesse : «
Albe vous a nommé ; je ne vous connais plus ».
Et nous avons fait l'expérience
douloureuse, pendant la dernière guerre, de la cruauté dont sont capables des soldats
fanatisés.
Le danger est d'autant plus grand que la cause défendue n'est pas toujours juste : les
héros se mettent au service du mal comme au service du bien.
Les généraux de Louis
XIV s'illustrèrent dans des guerres de conquête iniques, ceux de Napoléon aussi — et le
IIIe Reich allemand fit bien pire.
Julien Gracq, dans le Rivage des Syrtes, montre la
naissance ténébreuse d'un héroïsme qui n'a d'autre fin que lui-même.
A-t-on le droit
d'excuser le mal sous prétexte qu'il est source de grandeur ?
On en a d'autant moins le droit que cette grandeur est totalement destructrice.
Le héros
parfait, dans cette forme d'héroïsme, n'est-il pas le kamikaze japonais qui se tue avec
son avion pour atteindre la cible à coup sûr ? Il y a là en fait toute une tradition,
prestigieuse peut-être mais barbare, qui ne devrait- plus séduire que notre curiosité.
Il est donc possible de constater que la réflexion de Boileau se justifie.
Mais il ne faut pas
oublier les vertus qui sont à la base de l'héroïsme.
Ne pourrait-il prendre d'autres formes
?
II.
L'HEROÏSME PACIFIQUE
On conteste aujourd'hui de plus en plus que les temps de guerre soient seuls riches en
héros : la paix aussi leur permet d'apparaître.
Leurs domaines Certains pays donnent ce titre à des hommes très divers : cosmonautes
ou savants, les héros sont d'abord ceux qui font progresser l'humanité par leur action
exceptionnelle.
Sully Prud'homme à la fin du XIXe siècle glorifiait, en vers généreux, le
dévouement de deux aéronautes, morts dans l'espace au cours d'expériences
scientifiques :
« Moi, je salue en vous le genre humain qui monte,
Indomptable vaincu des cimes qu'il affronte,
Roi d'un astre, et pourtant jaloux des cieux entiers ! »
On pourrait dédier des apostrophes semblables à tous ceux qui consacrent leur vie à la
recherche ; des noms universellement connus viennent à l'esprit — Pasteur, Marie Curie.
D'autres ont cherché ainsi le dépassement d'eux-mêmes par des voies différentes.
L'histoire et la littérature nous fournissent de multiples exemples de ces figures
prestigieuses : l'empereur Auguste maîtrisant son désir de vengeance, la Princesse de
Clèves fidèle au souvenir d'un homme qu'elle n'a pas aimé, Charles de Foucauld passant
d'une vie mondaine à un ascétisme généreux.
On peut parler aussi d'héroïsme véritable à propos du stoïcisme de Vauvenargues, de
Vigny.
Cette sagesse austère et exigeante a ses saints, qui sont parfois des médiocres
comme....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓