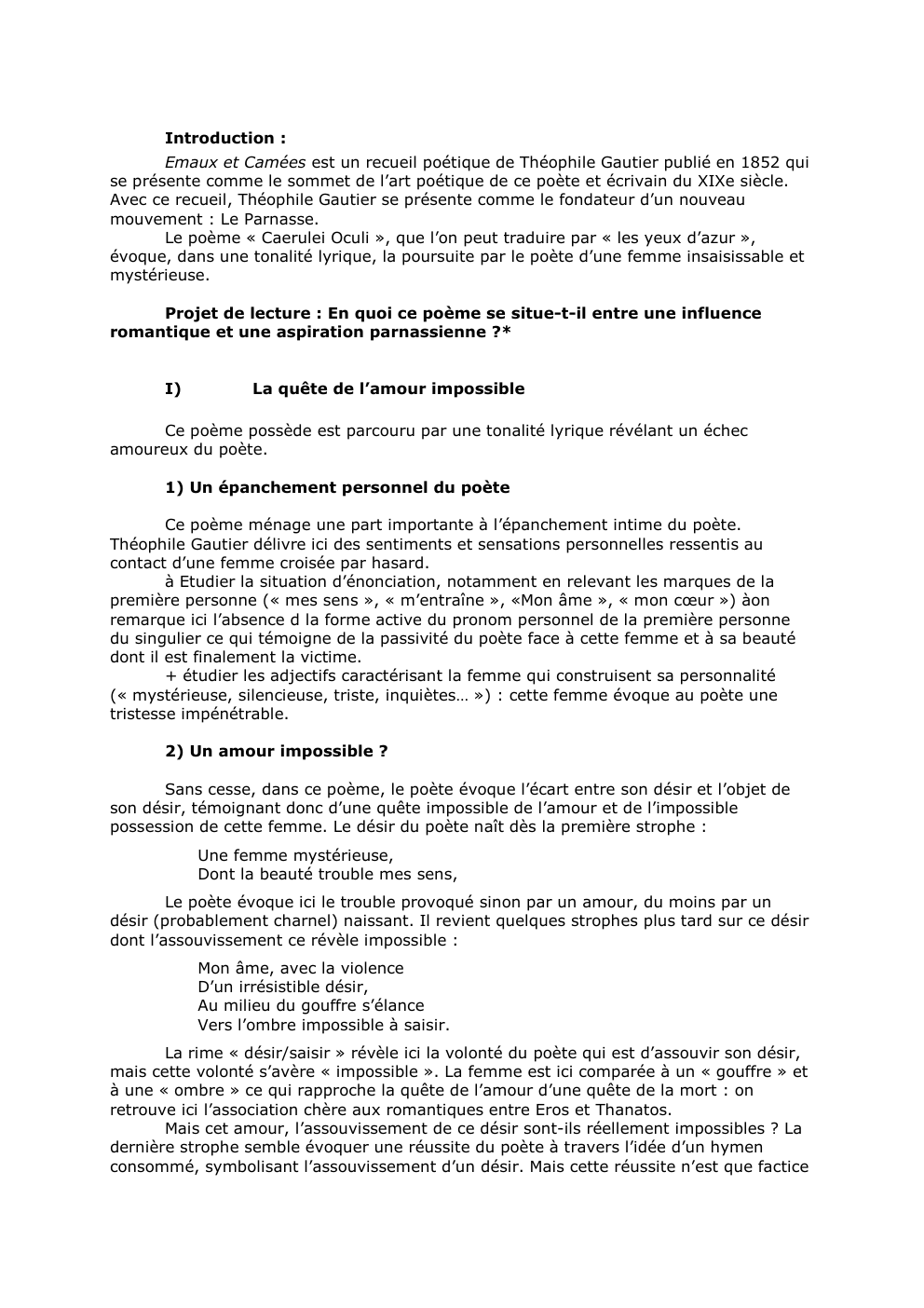Introduction : Emaux et Camées est un recueil poétique de Théophile Gautier publié en 1852 qui se présente comme le...
Extrait du document
«
Introduction :
Emaux et Camées est un recueil poétique de Théophile Gautier publié en 1852 qui
se présente comme le sommet de l’art poétique de ce poète et écrivain du XIXe siècle.
Avec ce recueil, Théophile Gautier se présente comme le fondateur d’un nouveau
mouvement : Le Parnasse.
Le poème « Caerulei Oculi », que l’on peut traduire par « les yeux d’azur »,
évoque, dans une tonalité lyrique, la poursuite par le poète d’une femme insaisissable et
mystérieuse.
Projet de lecture : En quoi ce poème se situe-t-il entre une influence
romantique et une aspiration parnassienne ?*
I)
La quête de l’amour impossible
Ce poème possède est parcouru par une tonalité lyrique révélant un échec
amoureux du poète.
1) Un épanchement personnel du poète
Ce poème ménage une part importante à l’épanchement intime du poète.
Théophile Gautier délivre ici des sentiments et sensations personnelles ressentis au
contact d’une femme croisée par hasard.
à Etudier la situation d’énonciation, notamment en relevant les marques de la
première personne (« mes sens », « m’entraîne », «Mon âme », « mon cœur ») àon
remarque ici l’absence d la forme active du pronom personnel de la première personne
du singulier ce qui témoigne de la passivité du poète face à cette femme et à sa beauté
dont il est finalement la victime.
+ étudier les adjectifs caractérisant la femme qui construisent sa personnalité
(« mystérieuse, silencieuse, triste, inquiètes… ») : cette femme évoque au poète une
tristesse impénétrable.
2) Un amour impossible ?
Sans cesse, dans ce poème, le poète évoque l’écart entre son désir et l’objet de
son désir, témoignant donc d’une quête impossible de l’amour et de l’impossible
possession de cette femme.
Le désir du poète naît dès la première strophe :
Une femme mystérieuse,
Dont la beauté trouble mes sens,
Le poète évoque ici le trouble provoqué sinon par un amour, du moins par un
désir (probablement charnel) naissant.
Il revient quelques strophes plus tard sur ce désir
dont l’assouvissement ce révèle impossible :
Mon âme, avec la violence
D’un irrésistible désir,
Au milieu du gouffre s’élance
Vers l’ombre impossible à saisir.
La rime « désir/saisir » révèle ici la volonté du poète qui est d’assouvir son désir,
mais cette volonté s’avère « impossible ».
La femme est ici comparée à un « gouffre » et
à une « ombre » ce qui rapproche la quête de l’amour d’une quête de la mort : on
retrouve ici l’association chère aux romantiques entre Eros et Thanatos.
Mais cet amour, l’assouvissement de ce désir sont-ils réellement impossibles ? La
dernière strophe semble évoquer une réussite du poète à travers l’idée d’un hymen
consommé, symbolisant l’assouvissement d’un désir.
Mais cette réussite n’est que factice
puisque la satisfaction du désir amoureux n’est pas réelle mais trouve un palliatif dans la
noyade oculaire : « Et mon cœur sous l’onde perfide / Se noie ».
Transition : Si ce poème comporte une note lyrique, il est cependant
essentiellement composé d’une description esthétique des yeux de la femme.
II)
Le culte des yeux féminins
Dans ce poème, Théophile Gautier, s’attache surtout à décrire une partie bien
précise de la femme qu’il rencontre : ses yeux .
Comme l’indique le titre du poème, les
yeux de la femme en sont l’objet principal.
1)
La métaphore aquatique
Les yeux de la femme sont comparés, tout au long du poème, à un paysage
aquatique.
Le poète se fait ici peintre maritime en réalisant une véritable description
picturale de ces yeux.
Ils recèlent « les teintes glauques de la mer » avec tout ce que
ceux-ci comportent de mystère.
Quelques exemples de cette métaphore aquatique :
l’association des cils aux mouettes : association entre
dimension aquatique et dimension céleste des yeux.
De ces yeux le poète
fait surgir l’ensemble d’un paysage, leur donnant une véritable dimension
esthétique.
Comparaison des yeux à une sirène qui semble, plus
précisément figurer la pupille :
Montrant son sein, cachant sa queue,
La sirène amoureusement
Fait ondoyer sa blancheur bleue
Sous l’émail vert du flot dormant
à la description revêt ici une dimension érotique.
Le yeux finissent par perdre leur
nature visuelle pour se muer en chant aquatique ( évocation de la « voix humide » du
« regard céruléen » dans la dernière strophe)
2)
La métaphore céleste
Une métaphore céleste est constamment associée à la métaphore aquatique : les
yeux outre des reflets des « teintes glauques de la mer », sont aussi des reflets du ciel.
Le titre « Caerulei oculi » évoque cette dimension céleste des yeux qui sont comparés à
un azur idéal.
On note deux mentions de l’« azur » dans ce poème : « azur amer » et « azur
indéfini ».
L’idée d’amertume peut-être véhiculée par la métaphore aquatique : l’azur
évoqué par le poète est celui du ciel maritime, iodé donc amer.
L’adjectif « indéfini »
tend à évoquer le caractère infini et homogène du ciel dans lequel évoluent les cilsmouettes.
3)
Les yeux : un support d’œuvres d’art
Les yeux féminins deviennent, dans ce poème, les....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓