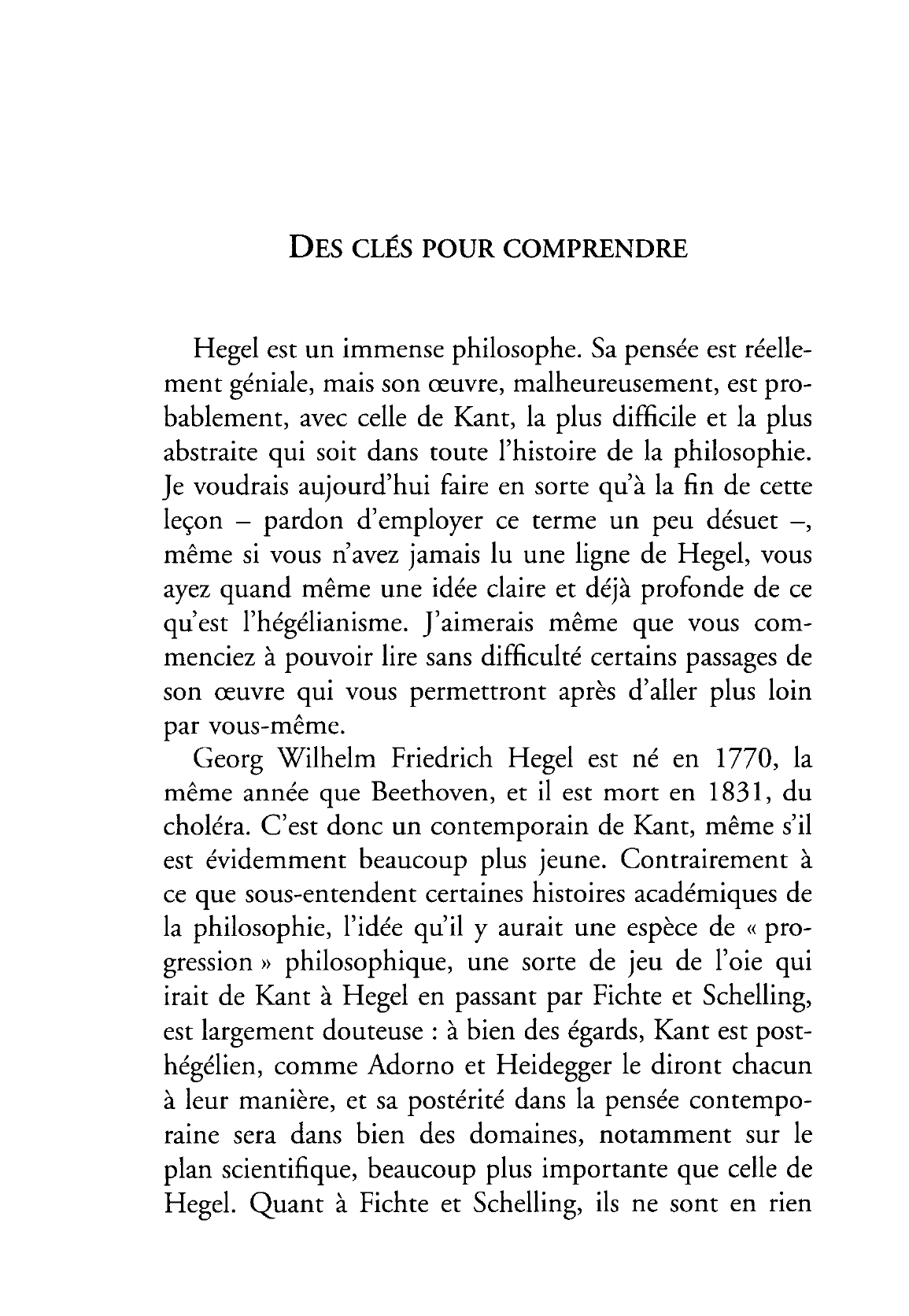Hegel et l'histoire
Publié le 26/03/2015
Extrait du document
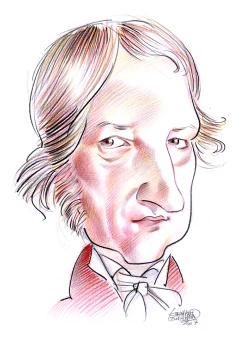
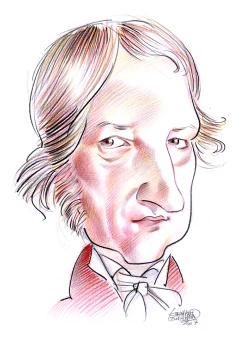
«
DES CLÉS POUR COMPRENDRE
Hegel est un immense philosophe.
Sa pensée est réelle
ment géniale, mais son œuvre, malheureusement, est pro
bablement, avec celle de Kant, la plus difficile et la plus
abstraite qui soit dans toute l'histoire de la philosophie.
Je voudrais aujourd'hui faire en sorte qu'à la fin de cette
leçon -
pardon d'employer ce terme un peu désuet -,
même si vous n'avez jamais lu une ligne de Hegel, vous
ayez
quand même une idée claire et déjà profonde de ce
qu'est l'hégélianisme.
J'aimerais même que vous com
menciez à pouvoir lire sans difficulté certains passages de
son œuvre qui vous
permettront après d'aller plus loin
par vous-même.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel est né en
1770, la
même année que Beethoven, et
il est mort en 1831, du
choléra.
C'est donc un contemporain de Kant, même s'il
est évidemment beaucoup plus jeune.
Contrairement à
ce que sous-entendent certaines histoires académiques de
la philosophie, l'idée qu'il y aurait une espèce de
« pro
gression
» philosophique, une sorte de jeu de l'oie qui
irait de Kant à Hegel en passant par Fichte et Schelling,
est largement douteuse : à bien des égards, Kant est post
hégélien,
comme Adorno et Heidegger le diront chacun
à leur manière, et sa postérité dans la pensée contempo
raine sera dans bien des domaines,
notamment sur le
plan scientifique, beaucoup plus importante que celle de
Hegel.
Quant à Fichte et Schelling, ils ne sont en rien.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre
- LEÇONS SUR LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE, Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre
- LEÇONS SUR LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE de Hegel (résumé)
- LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE de Hegel
- [L’histoire est la réalisation de l’idée de liberté.] Hegel