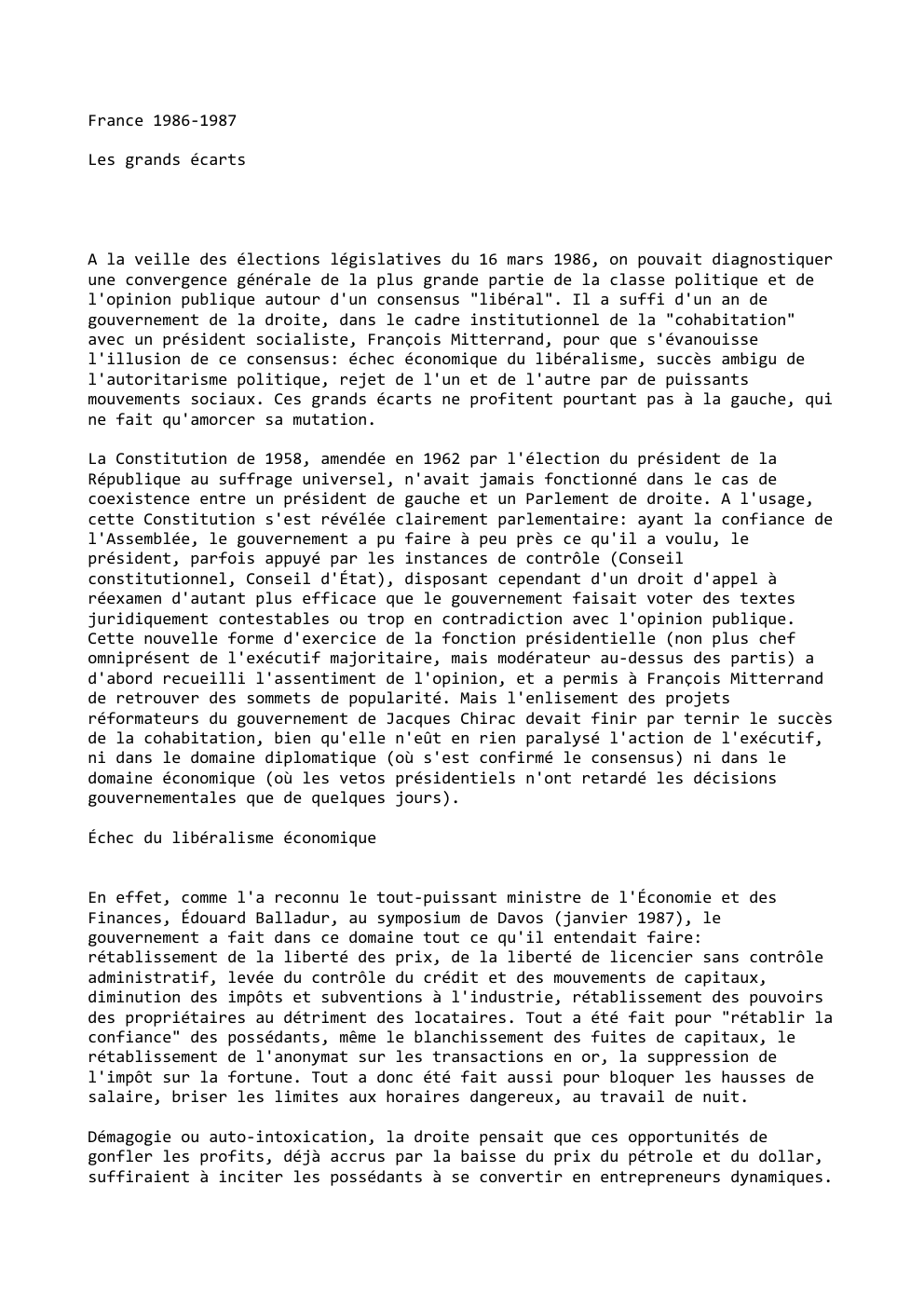France 1986-1987 Les grands écarts A la veille des élections législatives du 16 mars 1986, on pouvait diagnostiquer une convergence...
Extrait du document
«
France 1986-1987
Les grands écarts
A la veille des élections législatives du 16 mars 1986, on pouvait diagnostiquer
une convergence générale de la plus grande partie de la classe politique et de
l'opinion publique autour d'un consensus "libéral".
Il a suffi d'un an de
gouvernement de la droite, dans le cadre institutionnel de la "cohabitation"
avec un président socialiste, François Mitterrand, pour que s'évanouisse
l'illusion de ce consensus: échec économique du libéralisme, succès ambigu de
l'autoritarisme politique, rejet de l'un et de l'autre par de puissants
mouvements sociaux.
Ces grands écarts ne profitent pourtant pas à la gauche, qui
ne fait qu'amorcer sa mutation.
La Constitution de 1958, amendée en 1962 par l'élection du président de la
République au suffrage universel, n'avait jamais fonctionné dans le cas de
coexistence entre un président de gauche et un Parlement de droite.
A l'usage,
cette Constitution s'est révélée clairement parlementaire: ayant la confiance de
l'Assemblée, le gouvernement a pu faire à peu près ce qu'il a voulu, le
président, parfois appuyé par les instances de contrôle (Conseil
constitutionnel, Conseil d'État), disposant cependant d'un droit d'appel à
réexamen d'autant plus efficace que le gouvernement faisait voter des textes
juridiquement contestables ou trop en contradiction avec l'opinion publique.
Cette nouvelle forme d'exercice de la fonction présidentielle (non plus chef
omniprésent de l'exécutif majoritaire, mais modérateur au-dessus des partis) a
d'abord recueilli l'assentiment de l'opinion, et a permis à François Mitterrand
de retrouver des sommets de popularité.
Mais l'enlisement des projets
réformateurs du gouvernement de Jacques Chirac devait finir par ternir le succès
de la cohabitation, bien qu'elle n'eût en rien paralysé l'action de l'exécutif,
ni dans le domaine diplomatique (où s'est confirmé le consensus) ni dans le
domaine économique (où les vetos présidentiels n'ont retardé les décisions
gouvernementales que de quelques jours).
Échec du libéralisme économique
En effet, comme l'a reconnu le tout-puissant ministre de l'Économie et des
Finances, Édouard Balladur, au symposium de Davos (janvier 1987), le
gouvernement a fait dans ce domaine tout ce qu'il entendait faire:
rétablissement de la liberté des prix, de la liberté de licencier sans contrôle
administratif, levée du contrôle du crédit et des mouvements de capitaux,
diminution des impôts et subventions à l'industrie, rétablissement des pouvoirs
des propriétaires au détriment des locataires.
Tout a été fait pour "rétablir la
confiance" des possédants, même le blanchissement des fuites de capitaux, le
rétablissement de l'anonymat sur les transactions en or, la suppression de
l'impôt sur la fortune.
Tout a donc été fait aussi pour bloquer les hausses de
salaire, briser les limites aux horaires dangereux, au travail de nuit.
Démagogie ou auto-intoxication, la droite pensait que ces opportunités de
gonfler les profits, déjà accrus par la baisse du prix du pétrole et du dollar,
suffiraient à inciter les possédants à se convertir en entrepreneurs dynamiques.
C'était compter sans les lois de la macro-économie et la pusillanimité du
capitalisme français: dans une économie nationale et mondiale plus déprimée et
plus compétitive, les occasions d'investir profitablement se raréfiaient.
Le
revenu national ainsi déplacé vers les profits s'est mué en jeux spéculatifs
(rachat des entreprises privatisées par exemple), et l'appareil productif
français, auparavant soutenu à bout de bras par l'interventionnisme du
gouvernement socialiste, a retrouvé la pente du déclin.
L'investissement s'est
ralenti.
Malgré deux dévaluations, la balance commerciale a tout juste été
équilibrée en 1986 (en progrès de 5 milliards de francs, malgré 90 milliards
d'économies sur la facture pétrolière!), puis elle est devenue négative au
premier trimestre 1987 ; surtout, l'excédent du solde manufacturier a disparu
rapidement, caractéristique d'un pays en voie de sous-développement.
L'abandon
de toute aide à l'industrie, y compris le démantèlement de la recherche, n'y a
pas été pour rien, et la liberté de licencier les travailleurs expérimentés pour
les remplacer par des "stagiaires d'initiation à la vie professionnelle", quatre
fois moins payés, n'a rien arrangé, si ce n'est les statistiques du chômage des
jeunes...
au détriment de l'emploi de leurs aînés.
L'autoritarisme: ça plaît
Courant avril 1987, les sondages d'opinion plaçaient pour la première fois
(depuis toujours?) la gauche au-dessus de la droite en ce qui concerne la
capacité à gérer l'économie et (plus naturellement) à défendre les libertés
publiques.
Mais la droite l'emportait par sa capacité à défendre l'ordre et la
sécurité.
De fait, le déchaînement xénophobe et sécuritaire qui avait préparé la victoire
de la droite s'est concrétisé dès les premiers mois du gouvernement Chirac.
Le
Premier ministre annonçait à l'avance qu'il couvrirait les "bavures policières"
(qui se multiplièrent durant l'été 1986) ; il faisait promulguer, le 9
septembre, une "loi scélérate" sur l'accueil des étrangers (qui allait déchirer
des milliers de couples mixtes), annonçait une loi d'internement des
toxicomanes, la privatisation des prisons, et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓