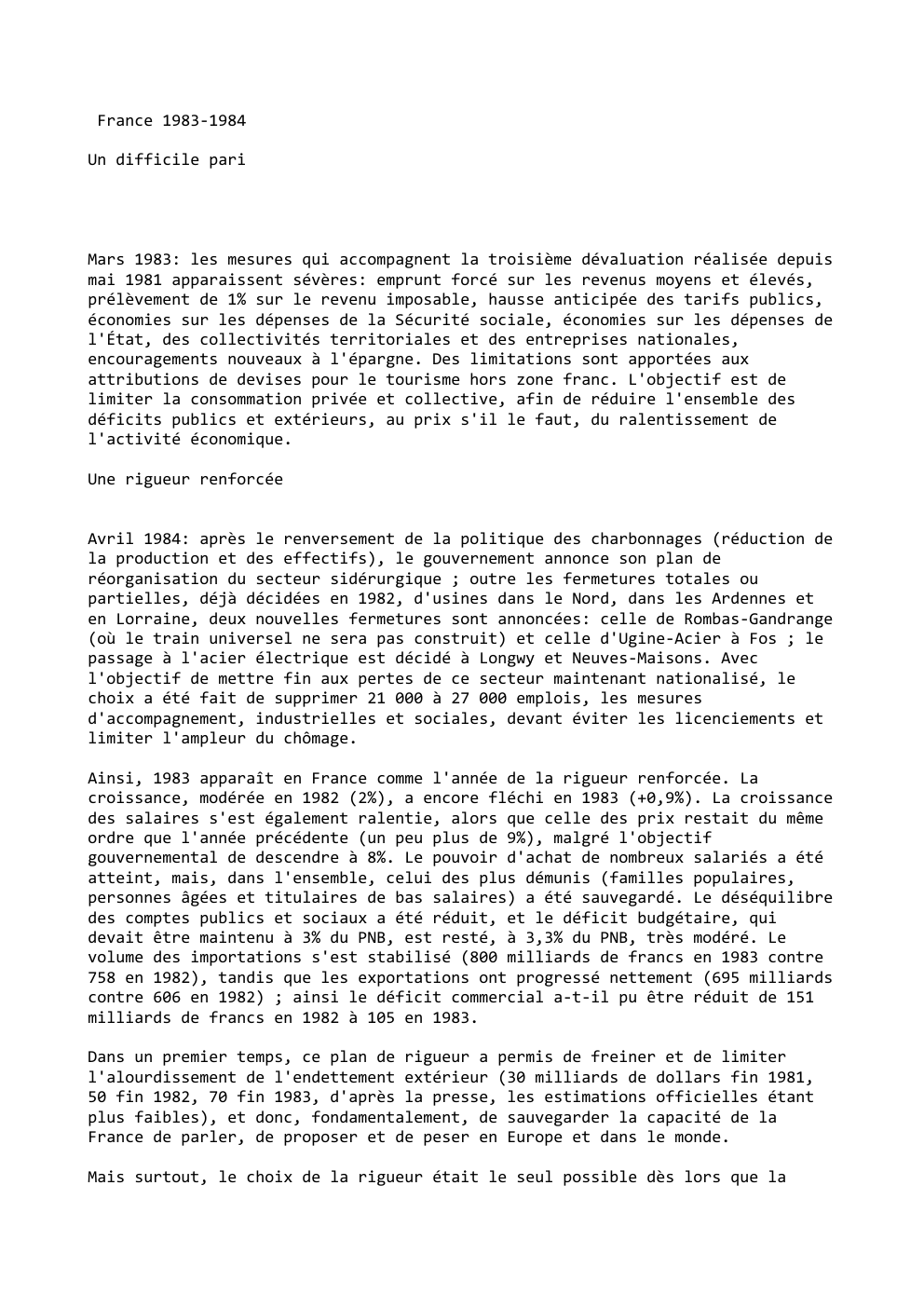France 1983-1984 Un difficile pari Mars 1983: les mesures qui accompagnent la troisième dévaluation réalisée depuis mai 1981 apparaissent sévères:...
Extrait du document
«
France 1983-1984
Un difficile pari
Mars 1983: les mesures qui accompagnent la troisième dévaluation réalisée depuis
mai 1981 apparaissent sévères: emprunt forcé sur les revenus moyens et élevés,
prélèvement de 1% sur le revenu imposable, hausse anticipée des tarifs publics,
économies sur les dépenses de la Sécurité sociale, économies sur les dépenses de
l'État, des collectivités territoriales et des entreprises nationales,
encouragements nouveaux à l'épargne.
Des limitations sont apportées aux
attributions de devises pour le tourisme hors zone franc.
L'objectif est de
limiter la consommation privée et collective, afin de réduire l'ensemble des
déficits publics et extérieurs, au prix s'il le faut, du ralentissement de
l'activité économique.
Une rigueur renforcée
Avril 1984: après le renversement de la politique des charbonnages (réduction de
la production et des effectifs), le gouvernement annonce son plan de
réorganisation du secteur sidérurgique ; outre les fermetures totales ou
partielles, déjà décidées en 1982, d'usines dans le Nord, dans les Ardennes et
en Lorraine, deux nouvelles fermetures sont annoncées: celle de Rombas-Gandrange
(où le train universel ne sera pas construit) et celle d'Ugine-Acier à Fos ; le
passage à l'acier électrique est décidé à Longwy et Neuves-Maisons.
Avec
l'objectif de mettre fin aux pertes de ce secteur maintenant nationalisé, le
choix a été fait de supprimer 21 000 à 27 000 emplois, les mesures
d'accompagnement, industrielles et sociales, devant éviter les licenciements et
limiter l'ampleur du chômage.
Ainsi, 1983 apparaît en France comme l'année de la rigueur renforcée.
La
croissance, modérée en 1982 (2%), a encore fléchi en 1983 (+0,9%).
La croissance
des salaires s'est également ralentie, alors que celle des prix restait du même
ordre que l'année précédente (un peu plus de 9%), malgré l'objectif
gouvernemental de descendre à 8%.
Le pouvoir d'achat de nombreux salariés a été
atteint, mais, dans l'ensemble, celui des plus démunis (familles populaires,
personnes âgées et titulaires de bas salaires) a été sauvegardé.
Le déséquilibre
des comptes publics et sociaux a été réduit, et le déficit budgétaire, qui
devait être maintenu à 3% du PNB, est resté, à 3,3% du PNB, très modéré.
Le
volume des importations s'est stabilisé (800 milliards de francs en 1983 contre
758 en 1982), tandis que les exportations ont progressé nettement (695 milliards
contre 606 en 1982) ; ainsi le déficit commercial a-t-il pu être réduit de 151
milliards de francs en 1982 à 105 en 1983.
Dans un premier temps, ce plan de rigueur a permis de freiner et de limiter
l'alourdissement de l'endettement extérieur (30 milliards de dollars fin 1981,
50 fin 1982, 70 fin 1983, d'après la presse, les estimations officielles étant
plus faibles), et donc, fondamentalement, de sauvegarder la capacité de la
France de parler, de proposer et de peser en Europe et dans le monde.
Mais surtout, le choix de la rigueur était le seul possible dès lors que la
tentative de relance keynésienne et sociale de l'activité économique avait dès
la fin 1981 et le début de 1982 montré ses limites et ses dangers ; et, dès lors
que le gouvernement avait rejeté les deux voies de la facilité: celle de
l'enfermement protectionniste (qui aurait nourri les penchants français au
malthusianisme et aux corporatismes et entraîné la France dans l'engrenage du
déclin), et celle de la fuite en avant inflationniste, avec acceptation d'un
déficit extérieur important, qui aurait préparé des retours de bâton très
brutaux, tant sociaux que politiques.
Ce choix était le seul possible, malgré
les bonnes paroles de quelques économistes de gauche ou d'extrême gauche,
partisans d'une dévaluation forte.
Cette thérapie, qui aurait probablement eu un
sens à l'été 1981, était en 1983 totalement inadaptée, avec un franc qui avait
déjà perdu deux cinquièmes de sa valeur par rapport au dollar, avec des
importations très rigides, avec une inflation qu'il faut contenir, et avec une
Allemagne dont le gouvernement aurait vigoureusement réagi, par des "mesures de
sauvegarde", à une dévaluation forte et non concertée.
Le choix de la rigueur, amorcé au printemps 1982 et confirmé en 1983, est donc
marqué à la fois par la raison et le courage.
Certains, à gauche, l'ont condamné
comme un changement de cap par rapport à ce qui avait été engagé - et il est
vrai qu'on est loin du mythique "cercle vertueux" de la croissance retrouvée de
1981.
Mais l'ensemble de la gauche l'a accepté ou admis - même si c'est avec de
plus en plus de réticences et de critique au PCF et à la CGT: car ce peut être
la chance pour la gauche française de ne pas être chassée du pouvoir pour cause
d'échec économique, et donc de mener, dans la durée, sa politique de
transformations économiques et sociales.
Ce choix de la rigueur apparaît en filigrane dans le texte du IXe Plan, adopté
en juillet 1983, avec la double logique de l'ouverture sur le monde extérieur
(avec l'ancrage dans l'Europe) et de la modernisation.
Avec, en contrepoint, un
coup de frein sur le niveau de vie et un risque de progression du chômage, dont
la ligne des "deux millions", tenue pendant deux ans par la multiplication
d'actions spécifiques, est effectivement enfoncée en fin d'année.
Douze
programmes prioritaires adoptés dans la seconde loi de Plan, en décembre 1983,
ont engagé pour cinq ans l'effort du pays: ils concernent d'abord l'éducation et
la formation des jeunes, la recherche et l'innovation, l'emploi, la
modernisation du système de santé, la capacité de vente notamment à
l'étranger...
Mais la modernisation signifie aussi, qu'au-delà des secteurs pour lesquels des
choix ont déjà dû être faits (sidérurgie, charbonnages, construction navale),
d'autres secteurs vont être touchés: construction et travaux publics,
automobile, construction mécanique, papeterie et imprimerie, électronique,
machine-outil...
De premiers regroupements ont été engagés par des groupes
publics: autour d'Elf pour la chimie, de la CGE pour les télécommunications et
l'électricité, de Thomson pour les composants, l'électronique grand public et
les systèmes d'armes.
Mais les "plans" pour les secteurs d'avenir, souvent
annoncés avec fracas, ne se concrétisent que lentement ; le niveau de
l'investissement reste bas et le tissu industriel français semble lent à se
régénérer.
Et pourtant un gros effort a été entrepris pour réorienter l'épargne
vers l'industrie et il y a longtemps que la bourse de Paris n'avait été si
active ni si florissante: elle a connu une hausse des cours de 60% en 1983, mais
aussi une forte progression des transactions (330 milliards de francs contre 216
en 1982 et 148 en 1981) et une nette augmentation des émissions (204 milliards
de francs en 1983, contre 157 en 1982 et 109 en 1981).
Le corps social français a été pris à contre-pied par cette politique de
rigueur.
Les partis de gauche et les syndicats étaient accoutumés à combattre
l'austérité chaque fois que la droite voulait la mettre en oeuvre ; et il ne
leur est facile ni d'accepter ni de combattre trop durement cette politique mise
en oeuvre par "leur" gouvernement.
Ainsi le parti communiste: certes les....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓