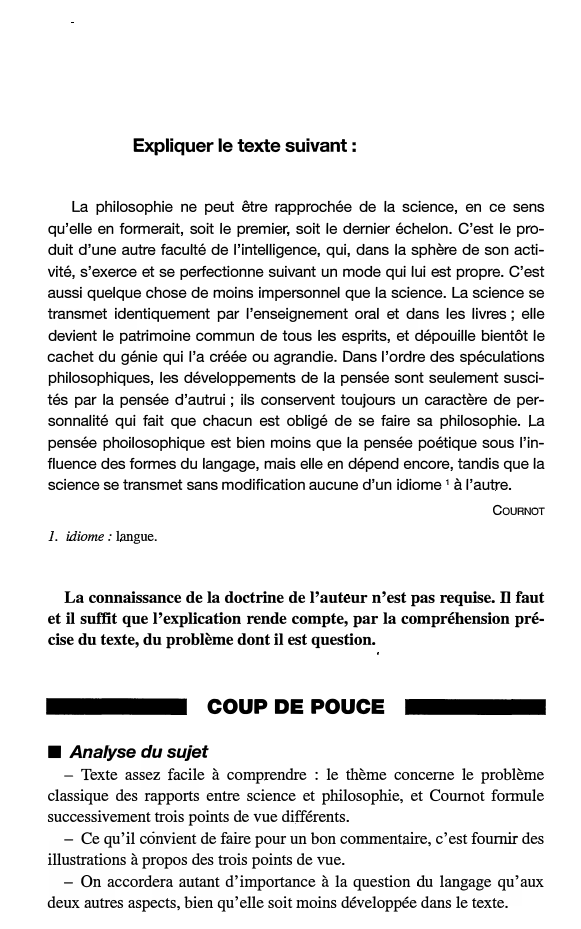Expliquer le texte suivant : La philosophie ne peut être rapprochée de la science, en ce sens qu'elle en formerait,...
Extrait du document
«
Expliquer le texte suivant :
La philosophie ne peut être rapprochée de la science, en ce sens
qu'elle en formerait, soit le premier, soit le dernier échelon.
C'est le pro
duit d'une autre faculté de l'intelligence, qui, dans la sphère de son acti
vité, s'exerce et se perfectionne suivant un mode qui lui est propre.
C'est
aussi quelque chose de moins impersonnel que la science.
La science se
transmet identiquement par l'enseignement oral et dans les livres ; elle
devient le patrimoine commun de tous les esprits, et dépouille bientôt le
cachet du génie qui l'a créée ou agrandie.
Dans l'ordre des spéculations
philosophiques, les développements de la pensée sont seulement susci
tés par la pensée d'autrui ; ils conservent toujours un caractère de per
sonnalité qui fait que chacun est obligé de se faire sa philosophie.
La
pensée phoilosophique est bien moins que la pensée poétique sous l'in
fluence des formes du langage, mais elle en dépend encore, tandis que la
science se transmet sans modification aucune d'un idiome 1 à l'autre.
COURNOT
1.
idiome : langue.
La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise.
Il faut
et il suffit que l'explication rende compte, par la compréhension pré
cise du texte, du problème dont il est question.
COUP DE POUCE
■
Analyse du sujet
- Texte assez facile à comprendre : le thème concerne le problème
classique des rapports entre science et philosophie, et Cournot formule
successivement trois points de vue différents.
- Ce qu'il cônvient de faire pour un bon commentaire, c'est fournir des
illustrations à propos des trois points de vue.
- On accordera autant d'importance à la question du langage qu'aux
deux autres aspects, bien qu'elle soit moins développée dans le texte.
■
Pièges à éviter
- Inutile de recenser toutes les conceptions possibles à propos des rela
tions science-philosophie: on s'en tiendra au texte seul.
- Ne pas donner un sens outrancier à la formule«chacun est obligé de
sa faire sa philosophie» : «chacun» désigne d'abord chaque philo
sophe...
- Ne pas réduire, dans le dernier point, l'influence des «formes du
langage» au seul problème de la traduction: ce serait négliger l'influence
qes mêmes formes dans ce que Cournot nomme la«pensée poétique».
CORRIGÉ
[Introduction]
Parce que la philosophie est antérieure à la science au sens moderne, la
question de leur relation a souvent été évoquée, par des philosophes aussi
bien que par des scientifiques.
L'originalité de Cournot est ici d'affirmer
que leurs démarches sont en réalité différentes, ce qui garantit la spécifi
cité et aussi la nécessité de chacune.
Il n'y a donc pas lieu de tenter de les
classer l'une par rapport à l'autre ou de les hiérarchiser; chacune possède
sa dignité propre, même si leurs modes d'élaboration, de transmission et
de discours sont nettement distincts.
[I.
Deux activités intellectuelles différentes]
Avant l'apparition de la science moderne, soit avant le XVII" siècle, on
pouvait concevoir une relation hiérarchique entre la philosophie et les
«savoirs».
C'est bien ce que fait Platon, lorsqu'il affirme que la connais
sance dialectique constitue le dernier niveau de la connaissance, supérieur
aux savoirs qui concernent le monde (qu'il s'agisse de la médecine ou de
l'astronomie).
C'est aussi le point de vue d'Aristote, lorsqu'il distingue
les philosophies «secondes» (tous les savoirs sur le monde, jusqu'à la
«physique») de la philosophie «première» (que l'on nomme ensuite
métaphysique, et à laquelle on accède chronologiquement en dernier,
parce qu'elle est la science des premiers principes et de l'être).
Après Galilée et avec le développement des sciences expérimentales, la
relation peut en quelque sorte s'inverser.
Non que les sciences soient
conçues comme«dépassant» la philosophie (thèse qui n'apparaît qu'avec
le scientisme).
C'est plutôt que cette dernière doit alors les fonder :
ainsi, pour Descartes et ses successeurs, la métaphysique constitue les
« racines» de l'arbre de la c onnaissanc e, dont les mathématiques sont le
tronc, et les branches maîtresses la mécanique, la médecine et la morale.
Pour Cournot, de telles conceptions ne sont plus tenables, et il préfère
considérer que philosophie et science se distinguent à la fois par la
« faculté de l'intelligence» qui s'y trouve à l'œuvre, par une « sphère
d'activité»·propre et par une manière de se perfectionner historiquement
également spécifique.
On peut en effet admettre que la raison ne s'exerce
pas de la même façon dans les deux domaines, mais surtout que les pro
blèmes à résoudre n'ont pas grand-chose en commun, ce qui garantit la
« sphère d'activité» propre à chaque attitude (on peut rappeler à ce pro
pos que la mentalité scientifique renonce à examiner les causes premières
ou finales, tandis que la philosophie peut continuer à s'en préoccuper).
[Il.
Universalité et personnalité]
Sans doute est-ce en raison de la différence des objectifs et des pro
blèmes abordés, autant que des méthodes, que science et philosophie
s'opposent comme l'universel au singulier.
La science est « imperson
nelle», ce qui indique aussi bien l'universalité de ses affirmations que la
façon dont elle concerne potentiellement tous les esprits de la même
manière.
Son enseignement, qu'il soit oral ou textuel, ne peut donc pas en
modifier les contenus, car l'enseignant ne peut que répéter ce qui a été
établi sans y introduire de modification.
Ainsi s'affirme-t-elle comme
« patrimoine commun» pour tous les esprits, ce qui a pour conséquence
que les affirmations scientifiques sont rapidement indépendantes de leurs
inventeurs.
Évoquer un théorème d'Euclide ou une loin de Newton, ce
n'est pas signifier que ce théorème ou cette loi appartiendraient person
nellement à ces deux personnages célèbres, c'est simplement rappeler
qu'ils furent les premiers à les établir.
Une fois acquis, ces savoirs devien
nent un bien commun, éventuellement anonyme car on ne se donne pas la
peine de signaler pour toute loi le nom de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓