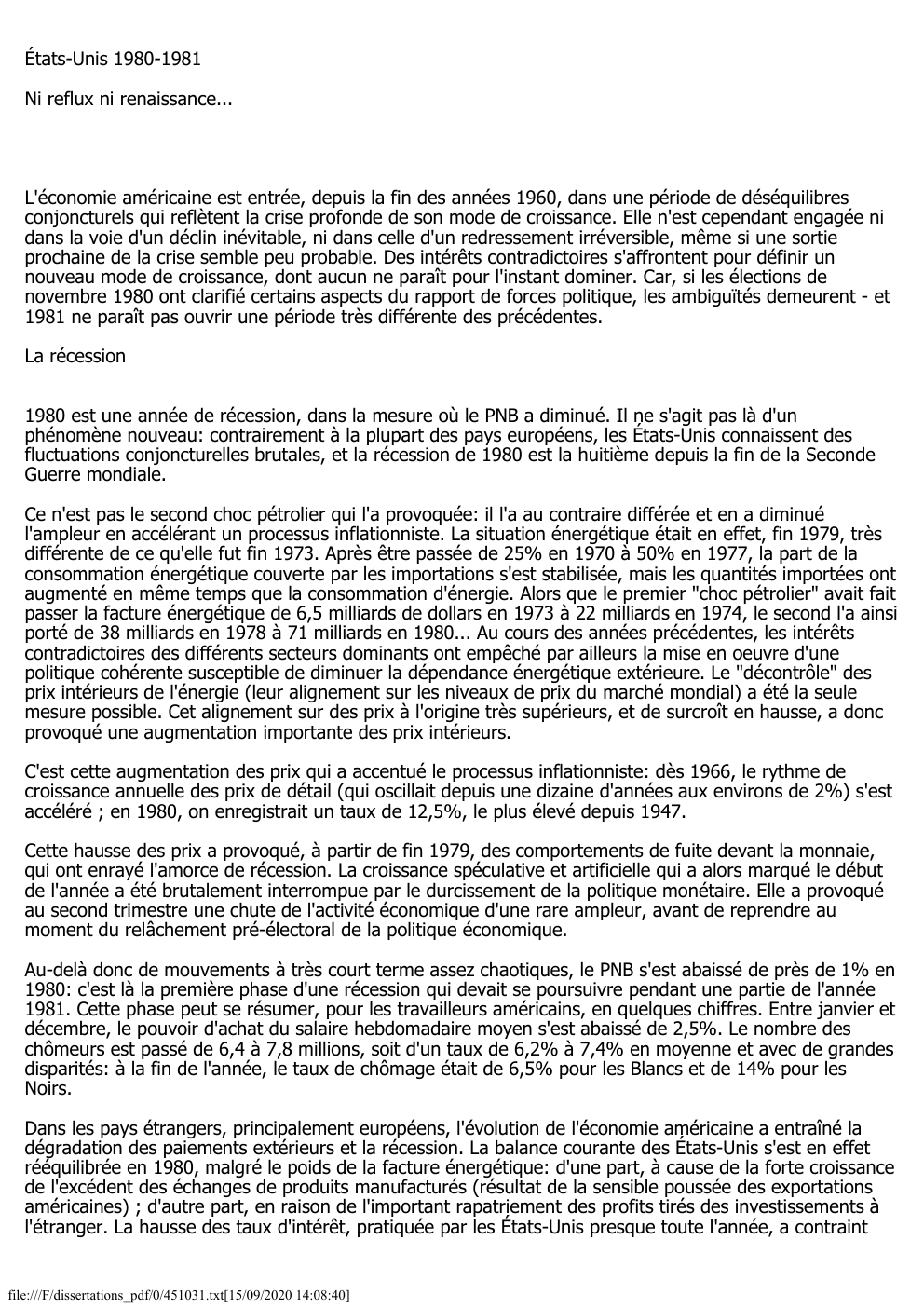États-Unis 1980-1981 Ni reflux ni renaissance... L'économie américaine est entrée, depuis la fin des années 1960, dans une période de...
Extrait du document
«
États-Unis 1980-1981
Ni reflux ni renaissance...
L'économie américaine est entrée, depuis la fin des années 1960, dans une période de déséquilibres
conjoncturels qui reflètent la crise profonde de son mode de croissance.
Elle n'est cependant engagée ni
dans la voie d'un déclin inévitable, ni dans celle d'un redressement irréversible, même si une sortie
prochaine de la crise semble peu probable.
Des intérêts contradictoires s'affrontent pour définir un
nouveau mode de croissance, dont aucun ne paraît pour l'instant dominer.
Car, si les élections de
novembre 1980 ont clarifié certains aspects du rapport de forces politique, les ambiguïtés demeurent - et
1981 ne paraît pas ouvrir une période très différente des précédentes.
La récession
1980 est une année de récession, dans la mesure où le PNB a diminué.
Il ne s'agit pas là d'un
phénomène nouveau: contrairement à la plupart des pays européens, les États-Unis connaissent des
fluctuations conjoncturelles brutales, et la récession de 1980 est la huitième depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
Ce n'est pas le second choc pétrolier qui l'a provoquée: il l'a au contraire différée et en a diminué
l'ampleur en accélérant un processus inflationniste.
La situation énergétique était en effet, fin 1979, très
différente de ce qu'elle fut fin 1973.
Après être passée de 25% en 1970 à 50% en 1977, la part de la
consommation énergétique couverte par les importations s'est stabilisée, mais les quantités importées ont
augmenté en même temps que la consommation d'énergie.
Alors que le premier "choc pétrolier" avait fait
passer la facture énergétique de 6,5 milliards de dollars en 1973 à 22 milliards en 1974, le second l'a ainsi
porté de 38 milliards en 1978 à 71 milliards en 1980...
Au cours des années précédentes, les intérêts
contradictoires des différents secteurs dominants ont empêché par ailleurs la mise en oeuvre d'une
politique cohérente susceptible de diminuer la dépendance énergétique extérieure.
Le "décontrôle" des
prix intérieurs de l'énergie (leur alignement sur les niveaux de prix du marché mondial) a été la seule
mesure possible.
Cet alignement sur des prix à l'origine très supérieurs, et de surcroît en hausse, a donc
provoqué une augmentation importante des prix intérieurs.
C'est cette augmentation des prix qui a accentué le processus inflationniste: dès 1966, le rythme de
croissance annuelle des prix de détail (qui oscillait depuis une dizaine d'années aux environs de 2%) s'est
accéléré ; en 1980, on enregistrait un taux de 12,5%, le plus élevé depuis 1947.
Cette hausse des prix a provoqué, à partir de fin 1979, des comportements de fuite devant la monnaie,
qui ont enrayé l'amorce de récession.
La croissance spéculative et artificielle qui a alors marqué le début
de l'année a été brutalement interrompue par le durcissement de la politique monétaire.
Elle a provoqué
au second trimestre une chute de l'activité économique d'une rare ampleur, avant de reprendre au
moment du relâchement pré-électoral de la politique économique.
Au-delà donc de mouvements à très court terme assez chaotiques, le PNB s'est abaissé de près de 1% en
1980: c'est là la première phase d'une récession qui devait se poursuivre pendant une partie de l'année
1981.
Cette phase peut se résumer, pour les travailleurs américains, en quelques chiffres.
Entre janvier et
décembre, le pouvoir d'achat du salaire hebdomadaire moyen s'est abaissé de 2,5%.
Le nombre des
chômeurs est passé de 6,4 à 7,8 millions, soit d'un taux de 6,2% à 7,4% en moyenne et avec de grandes
disparités: à la fin de l'année, le taux de chômage était de 6,5% pour les Blancs et de 14% pour les
Noirs.
Dans les pays étrangers, principalement européens, l'évolution de l'économie américaine a entraîné la
dégradation des paiements extérieurs et la récession.
La balance courante des États-Unis s'est en effet
rééquilibrée en 1980, malgré le poids de la facture énergétique: d'une part, à cause de la forte croissance
de l'excédent des échanges de produits manufacturés (résultat de la sensible poussée des exportations
américaines) ; d'autre part, en raison de l'important rapatriement des profits tirés des investissements à
l'étranger.
La hausse des taux d'intérêt, pratiquée par les États-Unis presque toute l'année, a contraint
file:///F/dissertations_pdf/0/451031.txt[15/09/2020 14:08:40]
par ailleurs des pays comme l'Allemagne - dont la parité monétaire est sensible aux différentiels de taux à mener une politique monétaire restrictive nullement justifiée par les conditions économiques internes.
La détermination de Reagan
Pour différentes raisons, la fraction des adultes en âge de voter inscrite sur les listes électorales diminue
sans cesse, et parmi les inscrits, le nombre d'abstentionnistes augmente de plus en plus.
Aussi, en
novembre 1980, moins de la moitié des électeurs potentiels a voté: Reagan est donc l'élu du quart de la
population américaine.
Le résultat des élections n'est pourtant pas dépourvu d'intérêt: il traduit une
modification significative du rapport de forces économique, politique et géographique entre les différents
groupes dominants, et l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration - même si elle n'entraînera pas
de bouleversements majeurs - induira aussi des modifications de la stratégie économique.
L'économie américaine traverse....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓