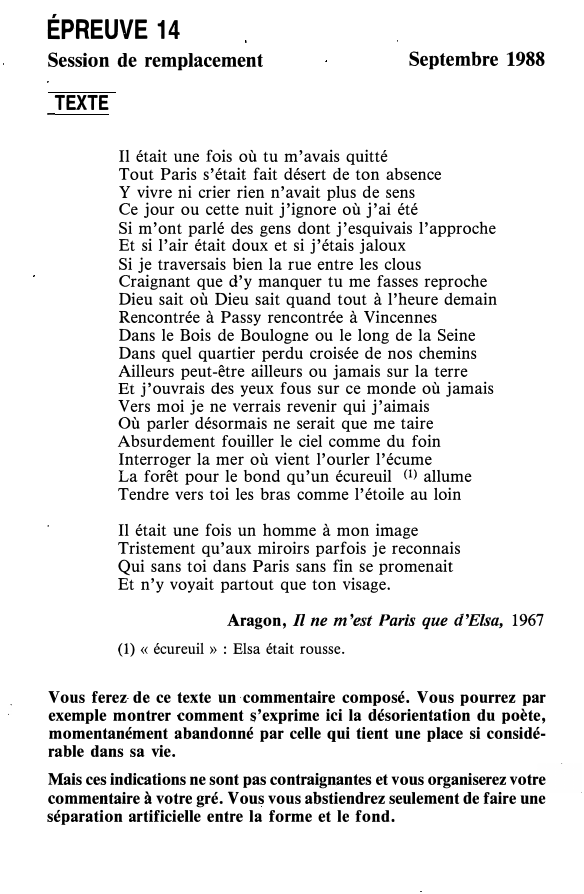ÉPREUVE 14 Session de remplacement Septembre 1988 TEXTE Il était une fois où tu m'avais quitté Tout Paris s'était fait...
Extrait du document
«
ÉPREUVE 14
Session de remplacement
Septembre 1988
TEXTE
Il était une fois où tu m'avais quitté
Tout Paris s'était fait désert de ton absence
Y vivre ni crier rien n'avait plus de sens
Ce jour ou cette nuit j'ignore où j'ai été
Si m'ont parlé des gens dont j'esquivais l'approche
Et si l'air était doux et si j'étais jaloux
Si je traversais bien la rue entre les clous
Craignant que d'y manquer tu me fasses reproche
Dieu sait où Dieu sait quand tout à l'heure demain
Rencontrée à Passy rencontrée à Vincennes
Dans le Bois de Boulogne ou le long de la Seine
Dans quel quartier perdu croisée de nos chemins
Ailleurs peut-être ailleurs ou jamais sur la terre
Et j'ouvrais des yeux fous sur ce monde où jamais
Vers moi je ne verrais revenir qui j'aimais
Où parler désormais ne serait que me taire
Absurdement fouiller le ciel comme du foin
Interroger la mer où vient l'ourler l'écume
La forêt pour le bond qu'un écureuil CIJ allume
Tendre vers toi les bras comme l'étoile au loin
Il était une fois un homme à mon image
Tristement qu'aux miroirs parfois je reconnais
Qui sans toi dans Paris sans fin se promenait
Et n'y voyait partout que ton visage.
Aragon, Il ne m'est Paris que d'Elsa, 1967
(1) « écureuil » : Elsa était rousse.
Vous ferez de ce texte un commentaire composé.
Vous pourrez par
exemple montrer comment s'exprime ici la désorientation du poète,
momentanément abandonné par celle qui tient une place si considé
rable dans sa vie.
Mais ces indications ne sont pas contraignantes et vous organiserez votre
commentaire à votre gré.
Vous vous abstiendrez seulement de faire une
séparation artificielle entre la forme et le fond.
■ Il s'agit d'un poème suivi, d'un ensemble en alexandrins de forme régu
lière.
Est-ce vraiment une strophe, ce qui se détache à la fin? ou simple•
ment une graphie? Ce qui compte c'est qu'ainsi est mise particulièrement
en valeur la répétition de "Il était une fois» : c'est un leitmotiv, un peu
comme une litanie.
On sent le poète désemparé.
Thème de l'absence, - de l'abandon?
Le poète n'est rien sans Elsa.
C'est un véritable dithyrambe.
■
■ Il faut bien remarquer la suppression de ponctuation.
C'est la marque
du passage d'Aragon au mouvement surréaliste.
La suppression de la ponc
tuation est prônée par Apollinaire (elle avait cependant déjà été utilisée par
Mallarmé) pour contraindre le lecteur à ne pas être passif.
C'est le lecteur
qui doit reconstituer en partie le poème dans sa lecture.
Introduction
Ill Louis Aragon est un romancier, essayiste, critique d'art et d'histoire, mais
plus encore un poète, dont la vie et l'œuvre couvrent une bonne partie du
xx• siècle.
■ D'abord·surréaliste, après sa rencontre essentielle avec !'écrivain russe
Elsa Triolet, il abandonne ce mouvement et devient un écrivain engagé représentant du communisme.
Cependant, il est avant tout connu comme
le chantre de l'amour parfait et partagé.
La majorité de son œuvre est dédiée
à la compagne de sa vie, Elsa, qui a sauvé le poète de sa propre ruine,
l'a transformé, a forgé son identité, et qui est pour lui source de vie, fon
taine de jouvence.
Ce thème d'un amour tel, qu'il ne peut vivre même momentanément sans
Elsa, est celui du texte Il ne m'est Paris que d'Elsa.
li serait possible d'en centrer le commentaire d'abord sur la « désorien
tation» du poète, « une fois que tu m'avais quitté» et la manière dont celui-ci
traduit sa solitude et son abandon.
Puis, serait mise en valeur la place que
tient Elsa dans sa vie, à la fois amante, guide et conseillère, omniprésente
par la passion exclusive qu'elle inspire.
■
■
VOCABULAIRE
•leitmotiv: c'est un terme allemand signifiant motif dominant.
En fran
çais, le mot est utilisé en musique et désigne un motif musical répété
dans une œuvre ; et en stylistique ou poésie, où il indique une phrase
(ou une formule) qui revient à plusieurs reprises.
• litanie : vient du latin chrétien litania « prière publique ».
C'est une
prière liturgique où toutes les invocations, courtes et suivies, adressées
à Dieu, ou à la Vierge, ou aux Saints, sont suivies d'une sorte de répéti
tion en refrain, énoncée par les fidèles.
Aussi, dans l'usage courant,
litanie signifie-t-il : « énumération répétitive, monotone et ennuyeuse ».
Premier thème : le poète désemparé
■
Dès le premier vers, Aragon signale l'absence par un choix de termes
simples:« tu m'avais quitté».
Un véritable trouble s'empare de lui, mani
festé par des images qui se bousculent.
Tout devient vague, aussi bien le
temps, que le lieu, les sentiments, les rencontres.
Tout ce qui n'est pas
Elsa s'efface du souvenir.
L'absence même veut être présentée en fiction
par une formule empruntée au conte:« Il était une fois».
Tout ce qui va
suivre pourrait ainsi paraître imaginaire.
D'autre part, le poète ne peut savoir
si les gestes accomplis, sa promenade par exemple, se situaient« cette
nuit» ou « ce jour».
Le doute temporel est mis en valeur par la coordina
tion « ou».
Par ailleurs, Aragon avoue à travers l'expression« Dieu sait quand tout
à l'heure demain » son désarroi que seule une puissance supérieure (« Dieu
sait») pourrait dominer ..., à moins que ce soit au contraire cette vague formule populaire qui traduit l'impuissance.
L'absence de ponctuation en tout
cas, juxtaposant les adverbes de temps accentue l'impression de cette igno
rance du temps.
De même, la fiction de conte, de rêve triste y ajoute.
Elle
est reprise(« Il était une fois») à la fin du poème, dans une sorte de conclu
sion détachée par la graphie et par l'insistance anaphorique.
Cette sensation d'incapacité se révèle aussi dans une sorte d'ignorance
des fieux, le sentiment d'être perdu, de ne plus savoir où il a pu aller, expri
mée avec la même volontaire platitude : « j'ignore où j'ai été» ; ce deuxième
hémistiche du vers résume l'état d'esprit du poète.
Là encore, l'expression
traditionnelle« Dieu sait», alliée à l'adverbe de lieu« où», traduit nettement
le désordre sentimental, en l'exprimant par une véritable perte d'orienta
tion.
La juxtaposition de deux indépendantes:« Rencontrée à Passy ren
contrée à Vincennes», l'anaphore de« rencontrée», insistante, soulignent
la confusion de la mémoire, où plus rien ne se différencie clairement.
Quant
aux apparentes précisions « dans le bois de Boulogne ou le long de la
Seine», elles sont tout aussi empreintes de doute.
C'est l'indication de l'inat
tention d'Aragon qui vient de son indifférence à ce qui n'est pas Elsa.
Il ne se souvient pas non plus du quartier parcouru, ce dont témoigne
l'interrogation indirecte de la forme de style« dans quel».
La formule cou
rante cc à la croisée des chemins », qui indique ordinairement un lieu de ren
contre est transformée volontairement ; accolée à « perdu», elle devient
poignante: que ne peuvent-ils se croiser, leurs chemins, même dans un
« quartier perdu» ( le sens second est « lointain», « loin du centre ville»,
mais le mot est pris ici dans sa signification originelle) ? Un espoir insensé
surgit dans«....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓