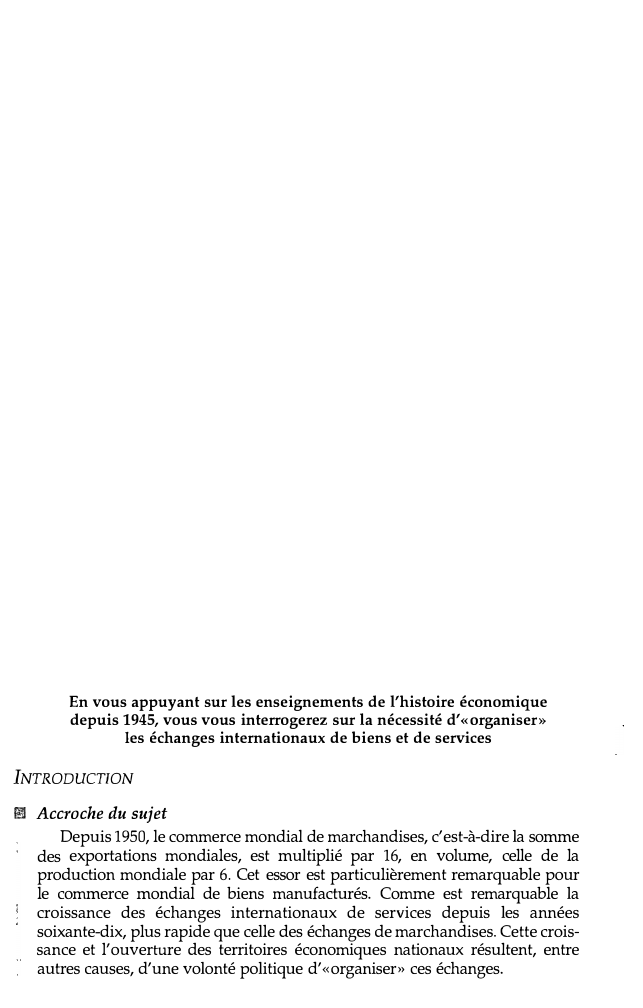En vous appuyant sur les enseignements de l'histoire économique depuis 1945, vous vous interrogerez sur la nécessité d'«organiser» les échanges...
Extrait du document
«
En vous appuyant sur les enseignements de l'histoire économique
depuis 1945, vous vous interrogerez sur la nécessité d'«organiser»
les échanges internationaux de biens et de services
INTRODUCTION
Il Accroche du sujet
Depuis 1950, le commerce mondial de marchandises, c'est-à-dire la somme
des exportations mondiales, est multiplié par 16, en volume, celle de la
production mondiale par 6.
Cet essor est particulièrement remarquable pour
le commerce mondial de biens manufacturés.
Comme est remarquable la
croissance des échanges internationaux de services depuis les années
soixante-dix, plus rapide que celle des échanges de marchandises.
Cette crois
sance et l'ouverture des territoires économiques nationaux résultent, entre
autres causes, d'une volonté politique d'«organiser» ces échanges.
Ill Définitions et problématique
Le mot «organiser» prête à confusion dans la mesure où la libéralisation
des échanges, soit d'une certaine façon, l'absence d'organisation, demeure le
dogme doctrinal dominant qui légitime, apparemment, les mesures de
,.
politique commerciale des Etats-nations qui participent aux écha�ges.
Cependant, la divergence entre les intérêts commerciaux des différents Etats
nations et des agents économiques qu'ils représentent est telle que la libérali
sation doit être organisée aux niveaux international et régional.
Depuis les
accords du GATT, signés le 30 octobre 1947, les échanges internationaux de
biens et de services font donc l'objet, d'un «code de bonne conduite «auquel
souscrivent un nombre de plus en plus important d'États-Nations puisqu'en
1997, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui succède au GATT,
comprend 132 membres et 32 candidats membres, dont la Chine et la Russie.
1111 Annonce de plan
De 1947 aux années soixante-dix, l'organisation des échanges internatio
naux de biens et de services cherche à promouvoir la libéralisation des
échanges tout en prenant en compte les intérêts spécifiques des États-Nations
(I).
Le ralentissement de la croissance économique depuis les années soixante
dix exacerbe les tensions, tandis qu'apparaissent de nombreuses fonnes
d'organisation des échanges (II).
PARTIE 1
De 1947 à la fin des années soixante-dix, l'organisation des échanges interna
tionaux de biens et de services s'effectue dans le cadre du GAIT (A) ce qui crée
les conditions d'une croissance rapide de la production et des échanges (B),
tout en prenant en compte certaines spécificités régionales et nationales (C).
lm A.
De 1947 à la fin des années soixante-dix, l'organisation des échanges interna
tionaux s'effectue dans le cadre du GATT.
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un consensus, explicable par le
contexte historique, se dégage pour affirmer la nécessité d'organiser les
échanges internationaux de biens et de services.
Ce consensus ne concerne, il
est vrai, qu'une minorité de pays 23 pays deviendront en 1947 «parties
contractantes» des accords du GATT qui représentent néanmoins la plus
grande part du commerce mondial.
Il s'agit de rétablir les conditions d'une
remise en route des échanges, de prévenir le retour d'une crise comparable à
celle des années trente, et d'assurer une croissance de plein emploi dans un
contexte de libéralisation des échanges internationaux.
Ce dernier objectif
intègre les enseignements de J.M.
Keynes sur les imperfections du marché qui
légitimeraient une intervention volontariste des Etats tant à l'échelle des terri
toires économiques nationaux qu'à celui des marchés mondiaux.
Il faut
ajouter le changement de doctrine des États-Unis qui, forts d'une position
hégémonique sans précédent historique, assument le leadership du monde
occidental.
À cet égard, le Plan Marshall apparaît comme l'antithèse des tarifs
Hawley-Smoot décidés en 1930.
À défaut de l'Organisation Internationale du Commerce, voulue par
J.M.
Keynes, et inscrite dans la Charte de La Havane, ce sont des accords du
GATT, signés le 30 octobre 1947 à titre provisoire, qui vont demeurer, jusqu'au
milieu des années quatre-vingt-dix, le cadre institutionnel des négociations
commerciales internationales.
Pour S.
Strange, toute institution et toute organi
sation internationale doivent assurer trois missions : établir des règles et agir de
telle façon que les mesures prises soient compatibles avec les intérêts des
puissances dominantes, sanctionner les acteurs qui ne jouent pas le jeu et
élaborer une représentation de l'intérêt général qui soit acceptée par tous les
acteurs.
Il existe des contradictions entre ces missions, mais le GATT a su
incarner ces missions, au moins jusqu'à la fin des années quatre-vingt.
P.
Krugman évoque le «mercantilisme éclairé» qui aurait servi de doctrine aux
parties contractantes du GATT.
Cette expression semble bien exprimer l'équi
libre fragile entre la volonté de libéraliser les échanges et la prise en compte des
intérêts nationaux sans retomber dans le sophisme mercantiliste selon lequel
chaque pays doit exporter plus qu'il n'importe.
Ce mercantilisme éclairé s'est
traduit par certaines obligations comme celle de la clause de «la nation la plus
favorisée» et l'établissement d'un «code de bonne conduite» en matière de
restrictions des échanges.
Ces obligations ont été mises en pratique jusqu'aux
années quatre-vingt dans un cadre où le multilatéralisme a prédominé.
a B.
Les résultats en termes de croissances sont impressionnants.
Les indicateurs convergent qui légitiment, apparemment, l'organisation des
échanges internationaux établie en 1947.
Le commerce mondial de marchan
dises croît ainsi de 8,5% par an, en volume de 1960 à 1970, et de 5,3% de 1970 à
1980.
La croissance économique mondiale connaît une période historiquement
sans précédent.
Le commerce mondial augmentant encore plus rapidement que
les productions nationales, les taux d'ouverture, mesurés par la part des expor
tations de marchandises sur les PIB, de la plupart des pays s'accroissent: 7%
pour l'économie mondiale en 1950 et plus de 11% en 1973, 3% et 5% pour les
États-Unis, 2,3% et 7,9% pour le Japon, 7,7% et 15,4% pour la France.
Les
Nouveaux Pays Industrialisés Asiatiques (NPIA) développent des stratégies de
promotion des exportations dès les années soixante : le taux d'ouverture de la
Corée du Sud passe de 1% en 1950 à 8,2% en 1973.
À partir de 1973, la hausse
du prix des matières premières, notamment celui du pétrole brut, permet à
certains PED de s'intégrer dans les échanges internationaux et de financer leurs
croissances nationales.
La croissance économique mondiale, ainsi qu'une
intégration plus forte de tous les pays dans les échanges internationaux, sont
explicables, entre autres raisons, par les cycles de négociations multilatérales
-les «Rounds» qui interviennent dans le cadre du GATT de 1947 à 1979.
Les résultats en termes de libéralisation des échanges sont modestes
jusqu'au Dillon Round (1961-1962).
Ce cycle de négociation qui prend en
compte la création du marché commun européen ouvre une période de
négociation qui conduit à une baisse notable des tarifs douanier� : 40 % en
moyenne en 1947 et moins de 5% à la fin des années soixante-dix.
A partir du
Kennedy Round (1964-1967), les barrières non tarifaires font l'objet de
négociations.
Le Tokyo Round ou Nixon Round (1973-1979) maintient le cap
de la libéralisation malgré les signes de crise économique.
On peut se demander, comme le fait P.
Messerlin, si les résultats n'auraient
pas été plus probants avec une plus forte option libre échangiste dès les
années d'après-guerre.
Cette option repose sur les conclusions issues de la
tradition classique et néoclassique : dimension autorégulatrice du marché et
bienfaits économiques même dans le cadre d'un libre-échange unilatéral.
Cependant, l'histoire des relations économiques internationales démontre que
la marche vers une libéralisation des échanges demeure en permanence
contestée par les conséquences économiques et sociales des chocs de demande
et d'offre inhérents aux économies capitalistes de marché.
C.
C'est pour prendre en compte ces conséquences que le GATT avait prévu des
«exceptions» aux obligations résultant de la signature des accords.
Des droits sont reconnus aux États-Nations.
Ainsi les pays dont un ou des
secteurs sont en déclin peuvent bénéficier de la clause de «sauvegarde» qui
consiste à établir un régime de protection temporaire, sous la forme de tarifs
douaniers ou de barrières quantitatives, pour restructurer le ou les secteurs.
Inversement, conformément aux principes du «protectionnisme éducateur»,
certains pays, et plus particulièrement les PED, peuvent aussi recourir à des
mesures protectionnistes temporaires.
Par ailleurs, l'article XXIV du GATT prévoit la possibilité d'établir des
Unions douanières entre certains pays, «parties contractantes» des accords, à
condition que le niveau du tarif extérieur commun ne contredise pas les résul
tats des négociations multilatérales.
Enfin, certains secteurs font l'objet de
régimes spéciaux, jusqu'à la fin des années quatre-vingt, notamment les
services, l'agriculture et les secteurs du textile.
PARTIE
II
Depuis la fin des années soixante-dix, l'émergence d'un nouvel environnement
international (A), provoque une multiplication de formes d'organisation des
échanges internationaux (B), créant ainsi de nouveaux enjeux (C).
li A.
Depuis les années soixante-dix, l'environnement international est devenu plus
complexe.
Cette complexité résulte de processus complémentaires et contradictoires,
mêlés sous l'expression de «globalisation».
D'abord le nombre d'acteurs du commerce mondial augmente.
Il faut citer
les «économies émergentes», plus particulièrement les économies asiatiques.
Aux «quatre dragons» sont venus s'ajouter les «bébés tigres», la Chine et
l'Inde.
P.N.
Giraud, dans L'Inégalité du....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓