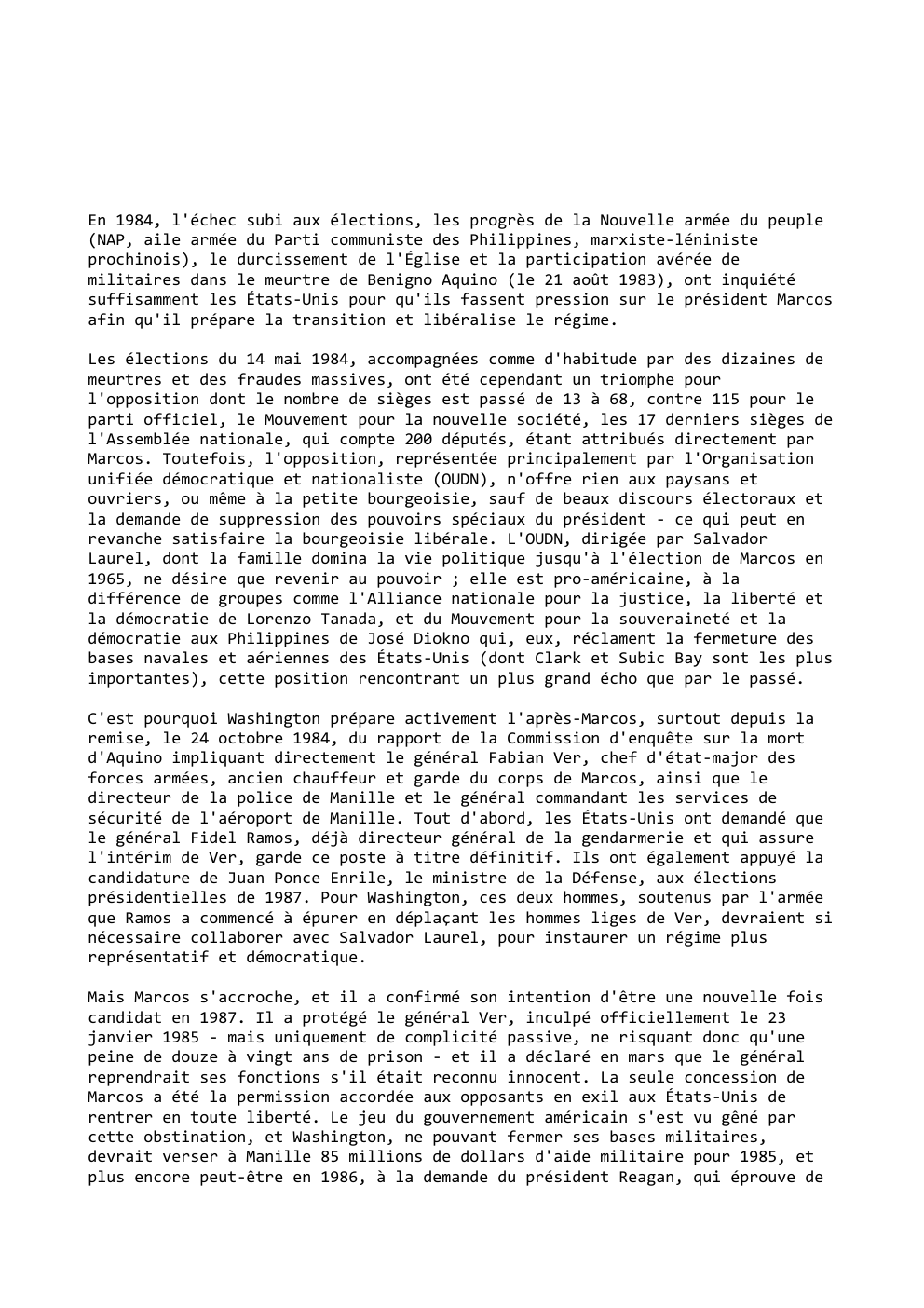En 1984, l'échec subi aux élections, les progrès de la Nouvelle armée du peuple (NAP, aile armée du Parti communiste...
Extrait du document
«
En 1984, l'échec subi aux élections, les progrès de la Nouvelle armée du peuple
(NAP, aile armée du Parti communiste des Philippines, marxiste-léniniste
prochinois), le durcissement de l'Église et la participation avérée de
militaires dans le meurtre de Benigno Aquino (le 21 août 1983), ont inquiété
suffisamment les États-Unis pour qu'ils fassent pression sur le président Marcos
afin qu'il prépare la transition et libéralise le régime.
Les élections du 14 mai 1984, accompagnées comme d'habitude par des dizaines de
meurtres et des fraudes massives, ont été cependant un triomphe pour
l'opposition dont le nombre de sièges est passé de 13 à 68, contre 115 pour le
parti officiel, le Mouvement pour la nouvelle société, les 17 derniers sièges de
l'Assemblée nationale, qui compte 200 députés, étant attribués directement par
Marcos.
Toutefois, l'opposition, représentée principalement par l'Organisation
unifiée démocratique et nationaliste (OUDN), n'offre rien aux paysans et
ouvriers, ou même à la petite bourgeoisie, sauf de beaux discours électoraux et
la demande de suppression des pouvoirs spéciaux du président - ce qui peut en
revanche satisfaire la bourgeoisie libérale.
L'OUDN, dirigée par Salvador
Laurel, dont la famille domina la vie politique jusqu'à l'élection de Marcos en
1965, ne désire que revenir au pouvoir ; elle est pro-américaine, à la
différence de groupes comme l'Alliance nationale pour la justice, la liberté et
la démocratie de Lorenzo Tanada, et du Mouvement pour la souveraineté et la
démocratie aux Philippines de José Diokno qui, eux, réclament la fermeture des
bases navales et aériennes des États-Unis (dont Clark et Subic Bay sont les plus
importantes), cette position rencontrant un plus grand écho que par le passé.
C'est pourquoi Washington prépare activement l'après-Marcos, surtout depuis la
remise, le 24 octobre 1984, du rapport de la Commission d'enquête sur la mort
d'Aquino impliquant directement le général Fabian Ver, chef d'état-major des
forces armées, ancien chauffeur et garde du corps de Marcos, ainsi que le
directeur de la police de Manille et le général commandant les services de
sécurité de l'aéroport de Manille.
Tout d'abord, les États-Unis ont demandé que
le général Fidel Ramos, déjà directeur général de la gendarmerie et qui assure
l'intérim de Ver, garde ce poste à titre définitif.
Ils ont également appuyé la
candidature de Juan Ponce Enrile, le ministre de la Défense, aux élections
présidentielles de 1987.
Pour Washington, ces deux hommes, soutenus par l'armée
que Ramos a commencé à épurer en déplaçant les hommes liges de Ver, devraient si
nécessaire collaborer avec Salvador Laurel, pour instaurer un régime plus
représentatif et démocratique.
Mais Marcos s'accroche, et il a confirmé son intention d'être une nouvelle fois
candidat en 1987.
Il a protégé le général Ver, inculpé officiellement le 23
janvier 1985 - mais uniquement de complicité passive, ne risquant donc qu'une
peine de douze à vingt ans de prison - et il a déclaré en mars que le général
reprendrait ses fonctions s'il était reconnu innocent.
La seule concession de
Marcos a été la permission accordée aux opposants en exil aux États-Unis de
rentrer en toute liberté.
Le jeu du gouvernement américain s'est vu gêné par
cette obstination, et Washington, ne pouvant fermer ses bases militaires,
devrait verser à Manille 85 millions de dollars d'aide militaire pour 1985, et
plus encore peut-être en 1986, à la demande du président Reagan, qui éprouve de
la sympathie pour Marcos.
Marcos s'est d'autre part heurté de plus en plus violemment à l'Église, dont les
membres ont participé activement aux manifestations d'opposition, comme celles
du 27 septembre et du 7 octobre 1984, qui ont réuni des dizaines de milliers de
manifestants, alors que le cardinal Sin, archevêque de Manille, parlait du
"régime moribond".
Cette évolution, qui s'est traduite par de multiples
arrestations de religieux, est due au choc provoqué par l'assassinat d'Aquino,
ainsi qu'à la prise de conscience de la régression du niveau de vie de la
population, dont 80% vit au-dessous du seuil de la pauvreté, alors que les
protégés de Marcos s'enrichissent scandaleusement.
Un ami du président, Eduardo
Cojuangco, surnommé le "roi de la noix de coco", puis celui de la bière,
actionnaire de nombreuses banques et compagnies industrielles, pratiquement
exempté d'impôts et soutenu totalement par la famille Marcos, était sur le point
de faire main basse sur toute l'économie du pays avec son compère Roberto
Benedicto, le "roi du sucre".
Mais avec 26 milliards de dollars de dette à la fin de 1984, le gouvernement
s'est vu....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓