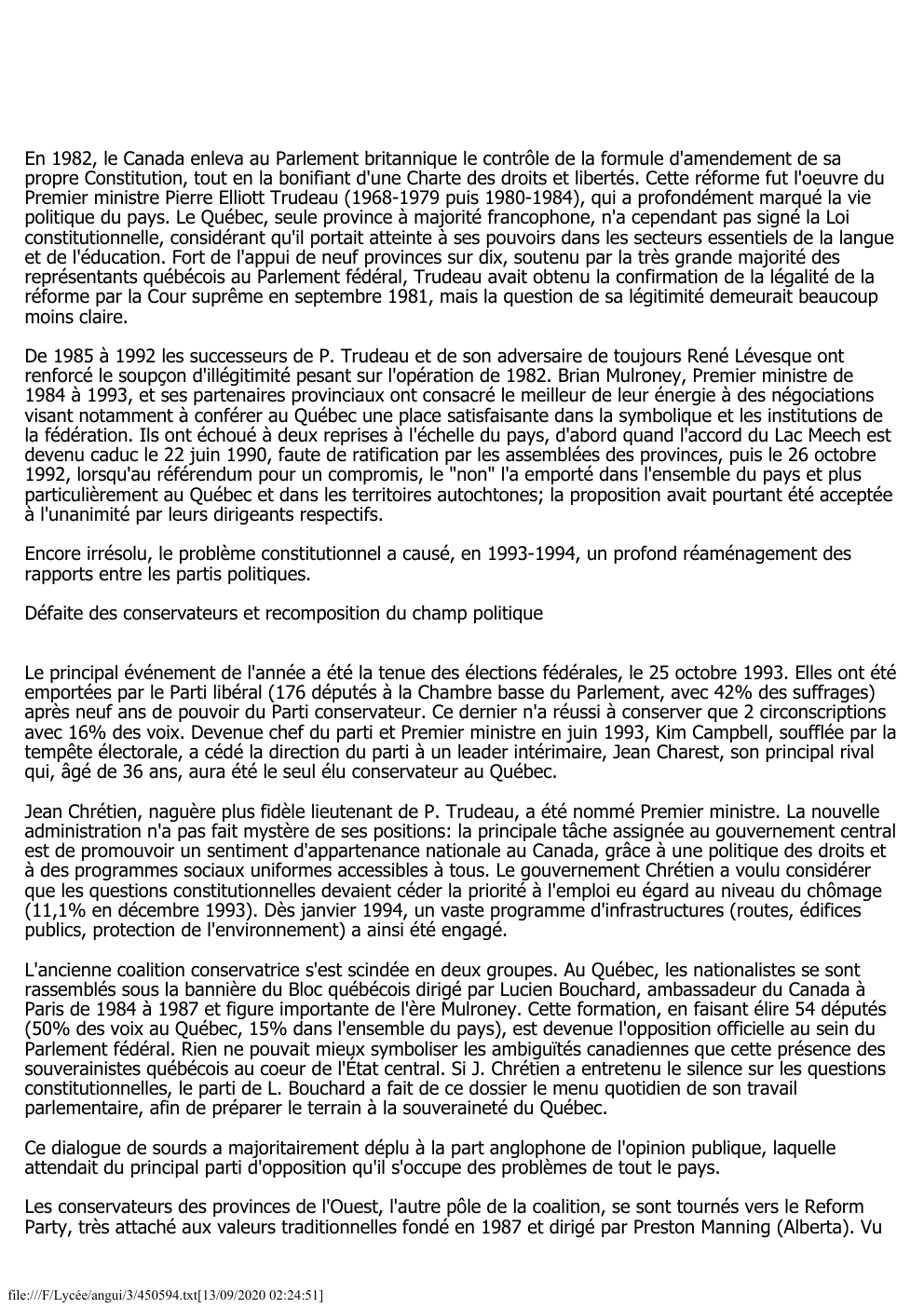En 1982, le Canada enleva au Parlement britannique le contrôle de la formule d'amendement de sa propre Constitution, tout en...
Extrait du document
«
En 1982, le Canada enleva au Parlement britannique le contrôle de la formule d'amendement de sa
propre Constitution, tout en la bonifiant d'une Charte des droits et libertés.
Cette réforme fut l'oeuvre du
Premier ministre Pierre Elliott Trudeau (1968-1979 puis 1980-1984), qui a profondément marqué la vie
politique du pays.
Le Québec, seule province à majorité francophone, n'a cependant pas signé la Loi
constitutionnelle, considérant qu'il portait atteinte à ses pouvoirs dans les secteurs essentiels de la langue
et de l'éducation.
Fort de l'appui de neuf provinces sur dix, soutenu par la très grande majorité des
représentants québécois au Parlement fédéral, Trudeau avait obtenu la confirmation de la légalité de la
réforme par la Cour suprême en septembre 1981, mais la question de sa légitimité demeurait beaucoup
moins claire.
De 1985 à 1992 les successeurs de P.
Trudeau et de son adversaire de toujours René Lévesque ont
renforcé le soupçon d'illégitimité pesant sur l'opération de 1982.
Brian Mulroney, Premier ministre de
1984 à 1993, et ses partenaires provinciaux ont consacré le meilleur de leur énergie à des négociations
visant notamment à conférer au Québec une place satisfaisante dans la symbolique et les institutions de
la fédération.
Ils ont échoué à deux reprises à l'échelle du pays, d'abord quand l'accord du Lac Meech est
devenu caduc le 22 juin 1990, faute de ratification par les assemblées des provinces, puis le 26 octobre
1992, lorsqu'au référendum pour un compromis, le "non" l'a emporté dans l'ensemble du pays et plus
particulièrement au Québec et dans les territoires autochtones; la proposition avait pourtant été acceptée
à l'unanimité par leurs dirigeants respectifs.
Encore irrésolu, le problème constitutionnel a causé, en 1993-1994, un profond réaménagement des
rapports entre les partis politiques.
Défaite des conservateurs et recomposition du champ politique
Le principal événement de l'année a été la tenue des élections fédérales, le 25 octobre 1993.
Elles ont été
emportées par le Parti libéral (176 députés à la Chambre basse du Parlement, avec 42% des suffrages)
après neuf ans de pouvoir du Parti conservateur.
Ce dernier n'a réussi à conserver que 2 circonscriptions
avec 16% des voix.
Devenue chef du parti et Premier ministre en juin 1993, Kim Campbell, soufflée par la
tempête électorale, a cédé la direction du parti à un leader intérimaire, Jean Charest, son principal rival
qui, âgé de 36 ans, aura été le seul élu conservateur au Québec.
Jean Chrétien, naguère plus fidèle lieutenant de P.
Trudeau, a été nommé Premier ministre.
La nouvelle
administration n'a pas fait mystère de ses positions: la principale tâche assignée au gouvernement central
est de promouvoir un sentiment d'appartenance nationale au Canada, grâce à une politique des droits et
à des programmes sociaux uniformes accessibles à tous.
Le gouvernement Chrétien a voulu considérer
que les questions constitutionnelles devaient céder la priorité à l'emploi eu égard au niveau du chômage
(11,1% en décembre 1993).
Dès janvier 1994, un vaste programme d'infrastructures (routes, édifices
publics, protection de l'environnement) a ainsi été engagé.
L'ancienne coalition conservatrice s'est scindée en deux groupes.
Au Québec, les nationalistes se sont
rassemblés sous la bannière du Bloc québécois dirigé par Lucien Bouchard, ambassadeur du Canada à
Paris de 1984 à 1987 et figure importante de l'ère Mulroney.
Cette formation, en faisant élire 54 députés
(50% des voix au Québec, 15% dans l'ensemble du pays), est devenue l'opposition officielle au sein du
Parlement fédéral.
Rien ne pouvait mieux symboliser les ambiguïtés canadiennes que cette présence des
souverainistes québécois au coeur de l'État central.
Si J.
Chrétien a entretenu le silence sur les questions
constitutionnelles, le parti de L.
Bouchard a fait de ce dossier le menu quotidien de son travail
parlementaire, afin de préparer le terrain à la souveraineté du Québec.
Ce dialogue de sourds a majoritairement déplu à la part anglophone de l'opinion publique, laquelle
attendait du principal parti d'opposition qu'il s'occupe des problèmes de tout le pays.
Les conservateurs des provinces de l'Ouest, l'autre pôle de la coalition, se sont tournés vers le Reform
Party, très attaché aux valeurs traditionnelles fondé en 1987 et dirigé par Preston Manning (Alberta).
Vu
file:///F/Lycée/angui/3/450594.txt[13/09/2020 02:24:51]
l'ampleur du déficit budgétaire de l'État (environ 34 milliards de dollars canadiens en 1993), P.
Manning
préconisait que la taille des administrations de l'État central et les programmes sociaux de l'Étatprovidence soient réduits.
En octobre 1993, le Reform Party a obtenu 53 députés (avec 17% des voix),
tous dans les quatre provinces de l'Ouest, sauf un en Ontario.
Cette formation avait présenté des
candidats dans tout le pays, hormis le Québec.
A l'exception des libéraux, ces élections ont donc abouti à
ce qu'il n'y ait plus de parti fédéral solidement implanté dans toutes les régions du pays.
L'État-providence, ou la différence canadienne
A l'instar de J.
Chrétien, P.
Manning estime que le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓