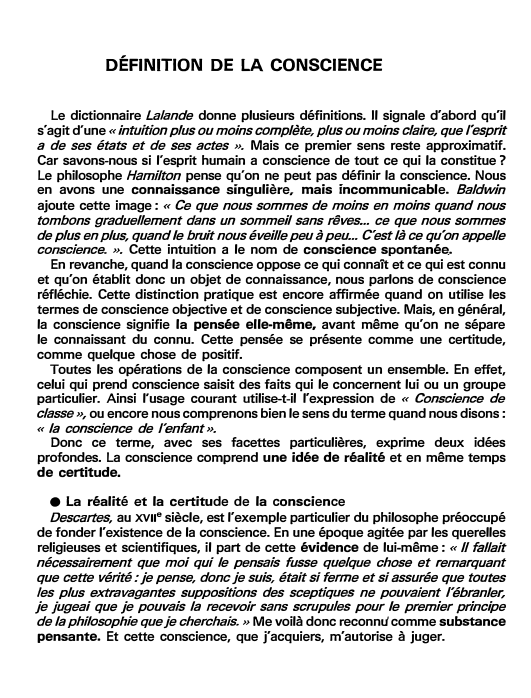DÉFINITION DE LA CONSCIENCE Le dictionnaire Lalande donne plusieurs définitions. Il signale d'abord qu'il s·agit d'une « intuition plus ou...
Extrait du document
«
DÉFINITION DE LA CONSCIENCE
Le dictionnaire Lalande donne plusieurs définitions.
Il signale d'abord qu'il
s·agit d'une « intuition plus ou moins complète, plus ou moins claire, que /'esprit
a de ses états et de ses actes ».
Mais ce premier sens reste approximatif.
Car savons-nous si l'esprit humain a conscience de tout ce qui la constitue?
Le philosophe Hamilton pense qu'on ne peut pas définir la conscience.
Nous
en avons une connaissance singulière, mais incommunicable.
Baldwin
ajoute cette image: « Ce que nous sommes de moins en moins quand nous
tombons graduellement dans un sommeil sans rêves...
ce que nous sommes
de plus en plus, quand le bruit nous éveille peu à peu...
C'est là ce qu'on appelle
conscience.
».
Cette intuition a le nom de conscience spontanée.
En revanche, quand la conscience oppose ce qui connaît et ce qui est connu
et qu'on établit donc un objet de connaissance, nous parlons de conscience
réfléchie.
Cette distinction pratique est encore affirmée quand on utilise les
termes de conscience objective et de conscience subjective.
Mais, en général,
la conscience signifie la pensée elle-même, avant même qu'on ne sépare
le connaissant du connu.
Cette pensée se présente comme une certitude,
comme quelque chose de positif.
Toutes les opérations de la conscience composent un ensemble.
En effet,
celui qui prend conscience saisit des faits qui le concernent lui ou un groupe
particulier.
Ainsi l'usage courant utilise-t-il l'expression de « Conscience de
classe», ou encore nous comprenons bien le sens du terme quand nous disons:
« la conscience de /'enfant».
Donc ce terme, avec ses facettes particulières, exprime deux idées
profondes.
La conscience comprend une idée de réalité et en même temps
de certitude.
• La réalité et la certitude de la conscience
Descartes, au XVll8 siècle, est l'exemple particulier du philosophe préoccupé
de fonder l'existence de la conscience.
En une époque agitée par les querelles
religieuses et scientifiques, il part de cette évidence de lui-même: « Il fallait
nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose et remarquant
que cette vérité: je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes
les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne pouvaient l'ébranler,
je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupules pour le premier principe
de la philosophie que je cherchais.
» Me voilà donc reconnu' comme substance
pensante.
Et cette conscience, que j'acquiers, m'autorise à juger.
• La conscience morale
J.
Lachelier note que « le propre de la conscience est d'approuver ou blâmer,
la joie ou la douleurne venant qu'après le jugement moral».
L'usage populaire
a gardé l'image de la voix de la conscience.
Elle attire la mémoire parce qu'elle
situe le caractère immédiat de la conscience.
Hier la théologie ou l'inspiration
artistique se plaisaient à cette évocation.
En....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓