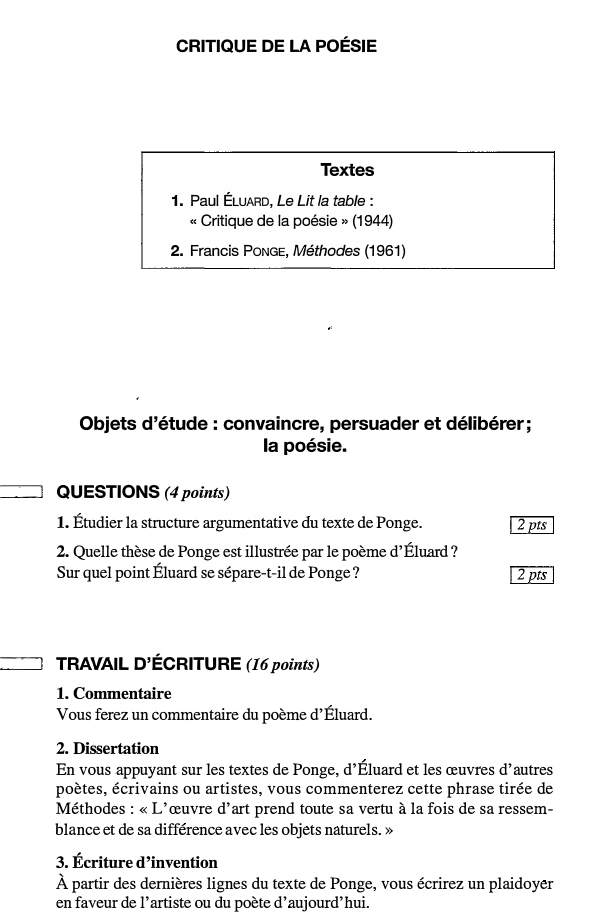CRITIQUE DE LA POÉSIE Textes 1. Paul ÉLUARD, Le Lit la table : « Critique de la poésie » (1944) 2....
Extrait du document
«
CRITIQUE DE LA POÉSIE
Textes
1.
Paul ÉLUARD, Le Lit la table :
« Critique de la poésie » (1944)
2.
Francis PONGE, Méthodes (1961)
Objets d'étude: convaincre, persuader et délibérer;
la poésie.
===:J QUESTIONS (4 points)
1.
Étudier la structure argumentative du texte de Ponge.
2.
Quelle thèse de Ponge est illustrée par le poème d'Éluard?
Sur quel point Éluard se sépare-t-il de Ponge?
===:J TRAVAIL D'ÉCRITURE (16 points)
1.
Commentaire
Vous ferez un commentaire du poème d'Éluard.
2.
Dissertation
En vous appuyant sur les textes de Ponge, d'Éluard et les œuvres d'autres
poètes, écrivains ou artistes, vous commenterez cette phrase tirée de
Méthodes:« L'œuvre d'art prend toute sa vertu à la fois de sa ressem
blance et de sa différence avec les objets naturels.
»
3.
Écriture d'invention
À partir des dernières lignes du texte de Ponge, vous écrirez un plaidoyer
en faveur de l'artiste ou du poète d'aujourd'hui.
==:J CORPUS
■ Texte 1 : Paul
ÉLUARD,
Le Lit la table (1944)
Critique de la poésie
Le feu réveille la forêt
Les troncs les cœurs les mains les feuilles
Le bonheur en un seul bouquet
Confus léger fondant sucré
5 C'est toute une forêt d'amis
Qui s'assemble aux fontaines vertes
Du bon soleil du bois flambant
Garcia Lorca1 a été mis à mort
Maison d'une seule parole
1 o Et des lèvres unies pour vivre
Un tout petit enfant sans larmes
Dans ses prunelles d'eau perdue
La lumière de l'avenir
Goutte à goutte elle comble l'homme
15 Jusqu'aux paupières transparentes
Saint-Pol-Roux2 a été mis à mort
Sa fille a été suppliciée
Ville glacée d'angles semblables
Où je rêve de fruits en fleur
20 Du ciel entier et de la terre
Comme à des vierges découvertes
Dans un jeu qui n'en finit pas
Pierres fanées murs sans écho
Je vous évite d'un sourire.
25 Decour3 a été mis à mort.
Droits Réservés.
1.
Federico Garcia Lorca, auteur dramatique espagnol, arrêté par la garde civile fran
quiste et exécuté en 1936, bien que n'ayant jamais appartenu à une organisation politique.
2.
Saint-Pol Roux, un des précurseurs de la poésie moderne.
En 1940, les Allemands
torturèrent sa famille sous ses yeux.
Il ne put survivre aux siens.
3.
Jacques Decour, professeur et écrivain, Résistant, fusillé par les Allemands.
■ Texte 2: Francis
PONGE,
Méthodes (1961)
Quel que soit le lecteur de ces lignes, la vie, puisque enfin il peut lire, lui
laisse donc quelque loisir.
Et non seulement sa vie, mais sa pensée même,
puisqu'il confie ce loisir à la pensée d'un autre homme.
(Lecteur, entre
parenthèses, soit donc le bienvenu en ma pensée...)
5
Mais si maintenant ma pensée est seulement celle-ci : de te conserver
à ton loisir, de t'engager plus profondément en lui - et si j'y parviens ...
Alors peut-être suis-je un artiste.
Note que, si bref soit-il, ce loisir tu pouvais l'employer à contempler la
nature, l'un de tes semblables ou enfin ta propre pensée.
Tu pouvais
10 l'occuper encore à chanter ou siffler quelque air improvisé de ton cru ou à
danser, courir, faire jouer ton corps.
Certes tout cela est légitime et tu t'y
adonnes parfois, et beaucoup d'hommes s'y adonnent.
Toutefois, cela ne
suffirait guère à te distinguer des animaux.
Mais il se trouve que certains hommes sont capables- Dieu sait pourquoi
15 - de produire - Dieu sait comment- des objets tels qu'ils puissent être choi
sis par toi pour que leur contemplation ou leur étude occupent profondément
ton loisir, le satisfassent, lui suffisent et ne t'engagent en rien d'autre.
Voici que tombe sous nos sens quelqu'un de ces objets étranges ...
Oui, bien apparemment l'ouvrage d'un de nos semblables.
Fait d'une
20 matière et de parties que la nature ne fournit jamais que séparées ou dans
un état brut fort différent.
Or, cet objet nous paraît aussitôt intéressant, joli,
beau ou sublime.
Il semble ne servir pratiquement à rien, mais sa considé
ration ou contemplation provoque en nous - d'abord je ne sais quel mou
vement d'instinct, comme si une conformité secrète à nos organes dès sa
25 rencontre nous appelait- puis nombre de sentiments profonds ou élevéset nous désirons nous l'approprier, ou du moins en conserver l'usage pour
notre plaisir éternel.
Ce plaisir, en effet, nous est confirmé par l'usage.
L'envie cependant nous vient de le montrer à ceux que nous aimons, pour
leur faire partager notre intérêt.
Sur plusieurs d'entre eux il produit un·effet
30 pareil.
L'on nous assure d'ailleurs que telle est sa seule d�stination, sinon
forcément peut-être l'intention de son auteur.
Un tel objet est une œuvre d'art.
Celui qui l'a produite est un artiste.
Et il
semble que de tels objets, comme aussi l'intérêt ou l'amour qu'ils inspirent,
ne se rencontrent que chez les hommes.
[...]
35
La fonction de l'artiste est ainsi fort claire : il doit ouvrir un atelier, et y
prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient.
Non
pour autant qu'il se tienne pour un mage.
Seule!71ent un horloger.
Répara
teur attentif du homard ou du citron, de la cruche ou du qompotier, tel est
bien l'artiste moderne.
Irremplaçable dans sa fonction.
Son rôle est
40 modeste, on le voit.
Mais l'on ne saurait s'en passer.
D'où lui en vient cependant le pouvoir, et quelles sont les conditions
nécessaires à son exercice? Eh bien! li lui vient sans doute d'abord d'une
sensibilité au fonctionnement du monde et d'un violent besoin d'y rester
intégré, mais ensuite- et cette condition est sine qua non - d'une aptitude
particulière à manier lui-même une matière déterminée.
Car l'œuvre d'art
prend toute sa vertu à la fois de sa ressemblance et de sa différence avec
les objets naturels.
D'où lui vient cette ressemblance? De ce qu'elle est
faite aussïd'une matière.
Mais sa différence? - D'une matière expressive,
qu'est-ce à dire? Qu'elle allume l'intelligence (mais elle doit l'éteindre aus50 sitôt).
Mais quels sont les matériaux expressifs? Ceux qui signifient déjà
quelque chose: les langages.
Il s'agit seulement de faire qu'ils ne signifient
plus tellement qu'ils ne FONCTIONNENT.
Ainsi, pour prendre un exemple dans les Belles-Lettres, la non-signifi
cation du monde peut bien désespérer ceux qui, croyant (paradoxalement)
55 encore aux idées, s'obligent à en déduire une philosophie ou une morale.
Elle ne saurait désespérer les poètes, car eux ne travaillent pas à partir
d'idées, mais disons grossièrement de mots.
Dès lors, nulles consé
quences.
Sinon quelque réconciliation profonde :....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓