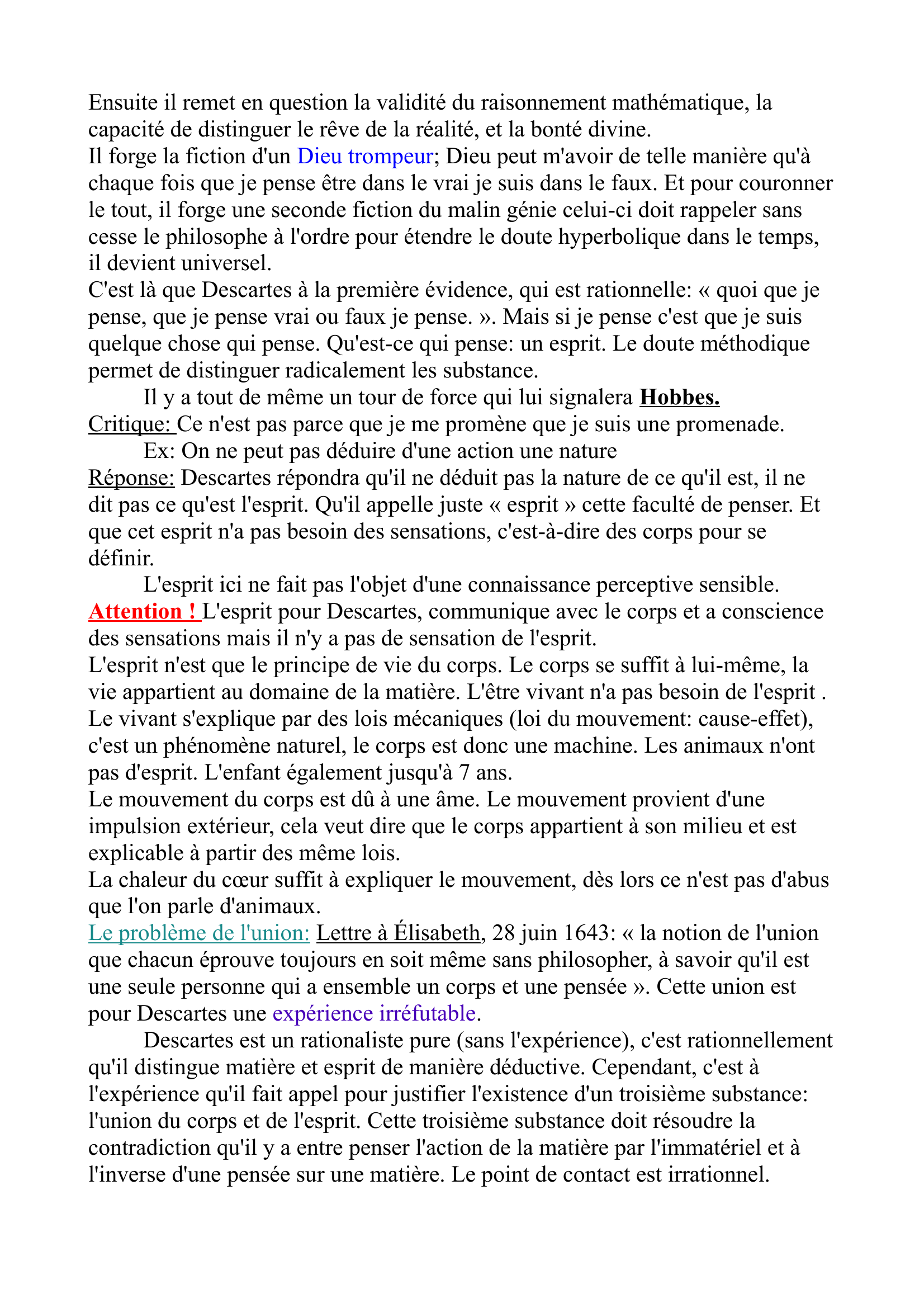Cours: matière et esprit
Publié le 02/05/2012
Extrait du document

Position du probl�me: La mati�re et l'esprit appartiennent-ils à des ordres
différents, incomparables, ayant chacun une logique propre (dualisme: 2 ordres
différents); ou bien correspondent-ils à des niveaux différents d'une seule et
même chose ? (monisme: même réalité).
S'interroger sur le dualisme et le monisme c'est d'emblée reconnaître que
leur existence réciproque est problématique. Ce qui est intéressant c'est de
remarquer comme il est facile de faire disparaître l'un au profit de l'autre (quand
l'esprit n'existe pas on est dans le matérialisme: disparition de l'esprit comme
l'ordre en soit; et de l'autre, l'idéalisme absolu: quand rien n'existe d'autre que
l'esprit). Le dualisme posera le probl�me de la relation, de l'union; comment
quelque chose de non matériel peut-il agir sur de la mati�re.
Pour le monisme se sera le probl�me de la réduction. Il n'y a-t-il pas quelque
chose dans l'esprit, une certaine spontanéité, liberté de l'esprit qui n'est pas
réductible à des mécanismes physiques voir, à des phénom�nes neuronaux. Le
cerveau peut-il à lui seul rendre compte des notre liberté de pensée ou même les
sentiments ne reposent-ils que sur des échanges chimiques.
Les théories localistes: c'est celles qui attribuent aux pensées une origine
neuronale, reste tout de même problématique parce qu'elle cherche à associer
aux pensées un lieu physique, n'est-ce pas se condamner à passer à coté de la
spécificité essentielle de l'esprit humain, c'est-à-dire la capacité de créer
librement des significations (donation de sens). Les significations sont
difficilement réductible à une mati�re organique.

«
Ensuite il remet en question la validité du raisonnement mathématique, la
capacité de distinguer le rêve de la réalité, et la bonté divine.
Il forge la fiction d'un Dieu trompeur ; Dieu peut m'avoir de telle manière qu'à
chaque fois que je pense être dans le vrai je suis dans le faux.
Et pour couronner
le tout, il forge une seconde fiction du malin génie celui-ci doit rappeler sans
cesse le philosophe à l'ordre pour étendre le doute hyperbolique dans le temps,
il devient universel.
C'est là que Descartes à la première évidence, qui est rationnelle: « quoi que je
pense, que je pense vrai ou faux je pense.
».
Mais si je pense c'est que je suis
quelque chose qui pense.
Qu'est-ce qui pense: un esprit.
Le doute méthodique
permet de distinguer radicalement les substance.
Il y a tout de même un tour de force qui lui signalera Hobbes.
Critique: Ce n'est pas parce que je me promène que je suis une promenade.
Ex: On ne peut pas déduire d'une action une nature
Réponse: Descartes répondra qu'il ne déduit pas la nature de ce qu'il est, il ne
dit pas ce qu'est l'esprit.
Qu'il appelle juste « esprit » cette faculté de penser.
Et
que cet esprit n'a pas besoin des sensations, c'est-à-dire des corps pour se
définir.
L'esprit ici ne fait pas l'objet d'une connaissance perceptive sensible.
Attention ! L'esprit pour Descartes, communique avec le corps et a conscience
des sensations mais il n'y a pas de sensation de l'esprit.
L'esprit n'est que le principe de vie du corps.
Le corps se suffit à lui-même, la
vie appartient au domaine de la matière.
L'être vivant n'a pas besoin de l'esprit .
Le vivant s'explique par des lois mécaniques (loi du mouvement: cause-effet),
c'est un phénomène naturel, le corps est donc une machine.
Les animaux n'ont
pas d'esprit.
L'enfant également jusqu'à 7 ans.
Le mouvement du corps est dû à une âme.
Le mouvement provient d'une
impulsion extérieur, cela veut dire que le corps appartient à son milieu et est
explicable à partir des même lois.
La chaleur du cœur suffit à expliquer le mouvement, dès lors ce n'est pas d'abus
que l'on parle d'animaux.
Le problème de l'union: Lettre à Élisabeth , 28 juin 1643: « la notion de l'union
que chacun éprouve toujours en soit même sans philosopher, à savoir qu'il est
une seule personne qui a ensemble un corps et une pensée ».
Cette union est
pour Descartes une expérience irréfutable .
Descartes est un rationaliste pure (sans l'expérience), c'est rationnellement
qu'il distingue matière et esprit de manière déductive.
Cependant, c'est à
l'expérience qu'il fait appel pour justifier l'existence d'un troisième substance:
l'union du corps et de l'esprit.
Cette troisième substance doit résoudre la
contradiction qu'il y a entre penser l'action de la matière par l'immatériel et à
l'inverse d'une pensée sur une matière.
Le point de contact est irrationnel..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'ESPRIT (cours)
- ESPRIT ET MATIERE
- Vous expliquerez et apprécierez ce parallèle entre le XVIIe siècle classique et le moyen âge : «Le XVIIe siècle - en ce qu'il a de classique - bien plus que l'introduction à la pensée scientifique, moderne et athée du XVIIIe siècle, est l'épanouissement de la pensée du moyen âge, dont il donne, sous des habits empruntés et dans une langue magnifique, une nouvelle et somptueuse image. Un homme prévenu, qui oublierait tant de poncifs et de jugements consacrés, comment ne serait-il pas fr
- COMTE : Cours de philosophie positive Discours sur l'esprit positif Système de politique positive Catéchisme positiviste
- Au cours d'une interview, l'écrivain allemand Heinrich BOil (prix Nobel de Littérature 1972) fit cette remarque : « ... J'ai l'impression qu'en Allemagne comme ailleurs, des jeunes gens pourtant très sérieux commencent à sous-estimer la poésie. Au point que l'on peut craindre qu'elle ne finisse dans une poubelle ... Je crois que ce serait un crime non seulement esthétique mais encore social et politique, car la poésie est aussi un extraordinaire moyen de combat ou de résistance, en mim