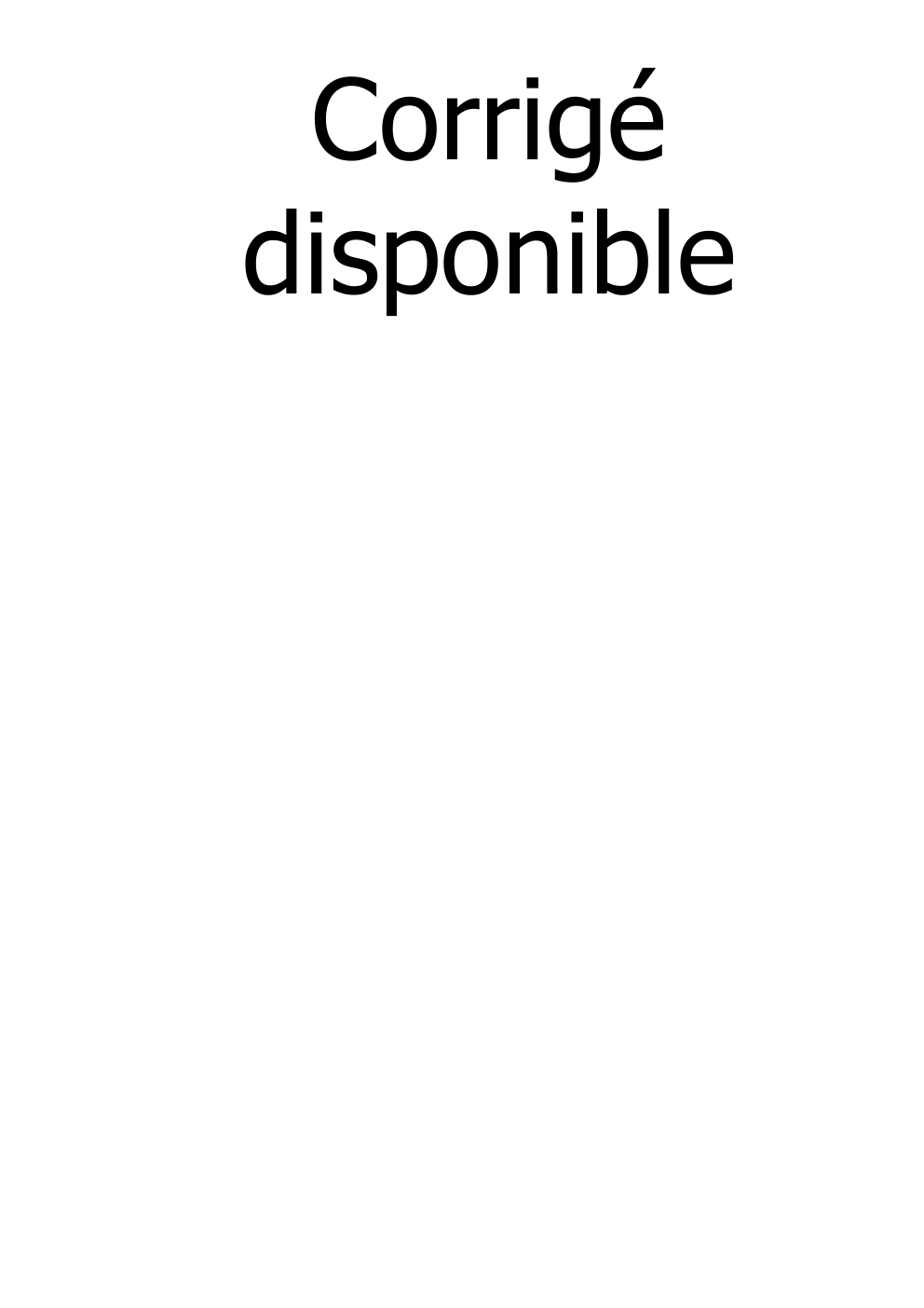Corrigé disponible XVIIIe siècle => combats et actions des philosophes des Lumières. I- Une manière d’écrire La littérature s’engage dans...
Extrait du document
«
Corrigé
disponible
XVIIIe siècle => combats et actions des philosophes des Lumières.
I- Une manière d’écrire
La littérature s’engage dans les grandes causes.
Voltaire : « Un livre n’est
excusable qu’autant qu’il apprend quelque chose ».
A- Plaire et distraire son lectorat
« Il obtient tous les suffrages celui qui unit l’utile à l’agréable, et plaît et instruit en
même temps.»
(Horace, Art poétique, III, 342-343).
• Les écrivains au XVIIIe siècle investissent des genres plus simples, moins ardus que des
essais.
Plaisir de la lecture + facilité.
Ex :
• Dépaysement : Zadig => action dans l’Orient lointain, à une époque imaginaire et
antique.
Exotisme qui rappelle les Mille et une nuits.
« Du temps du roi Moabdard… »
• Candide : les personnages sont tous bons ou mauvais.
Jeux de mots sur les nom (Candide
est naïf, M.
Vanderdendur, le méchant hollandais qui exploite le « nègre »…), facéties : les
quartiers de noblesse… Candide se promène à travers le monde, découvre un pays
utopique, celui de l’Eldorado… Voltaire décrit le parcours d’un jeune homme naïf qui
parcourt le monde, accompagné de Pangloss son mentor, un philosophe pour qui « tout
est pour le mieux dans le meilleur des mondes ».
Dans Candide, nous sommes dans l’univers du conte, de l’histoire plaisante où le
héros se fait fesser en cadence et où ceux qui meurent peuvent revenir.
NB : Le conte pour Voltaire doit être entendu par le plus de monde (ne pas oublier
que les Lumières veulent que leurs idées rayonnent le plus possible) => certaine
démocratisation de la littérature.
=> Comme le rappelle Voltaire, afin de convaincre et de toucher son auditoire « Il faut
être très court et un peu salé, sans quoi les ministres et Mme de Pompadour, les commis
et les femmes de chambre font de papillotes du livre ».
B- Une lecture active, l’ironie
• L’ironie est l’art de dire le contraire de ce que l’on pense, de se moquer de quelqu’un ou
de quelque chose en vue de faire réagir un lecteur ou un interlocuteur.
De nombreux
auteurs, dont Voltaire, ont eu recourt à l’ironie afin de dénoncer, de critiquer les travers et
les vices de la société ou de comportements.
=> L’ironie est omniprésente dans Candide :
• L’ironie invite donc le lecteur à être actif pendant sa lecture, à réfléchir et à choisir une
position.
L’auteur d’un apologue parsème ainsi son texte d’éléments qui doivent interpeller.
La lecture ne doit donc pas se faire au premier degré simplement.
• Guerre : « boucherie héroïque », « Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien
ordonné que les deux armées ».
• Dans le chapitre VI, Candide et Pangloss, pour des raisons dérisoires, sont conduits
« séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était
jamais incommodé du soleil ».
Comprenons que Voltaire désigne ici le cachot !
C- Un appel à la réflexion
• Dans le Supplément au voyage de Bougainville, Diderot remet en question ce qui
paraissait normal.
Pour un Européen, il semblait normal que les colons découvrent un pays
et disent : ce pays appartient à la France, l’Angleterre… Or, en faisant parler le vieux
Tahitien, Diderot fait comprendre au lecteur l’absurdité d’un tel jugement => À travers
l'affrontement des points de vue, le dialogue cherche à convaincre et à persuader le
destinataire en favorisant sa réflexion.
Cf.
l’inversion : si un Tahitien arrive en France, dirat-il que le pays appartient à son peuple ?
• Cf.
les critiques des divers aspects de la société française dans les Lettres persanes.
• Force du conte philosophique et des formes argumentatives développées au XVIIIe
siècle : piquent la curiosité, l’intérêt, la réflexion du lecteur.
Ce dernier est amener à
réfléchir sur des sujets importants.
• Le théâtre => Cf.
Le Mariage de Figaro.
Ex : par le discours de Marcelline, la mère de
Figaro, Beaumarchais interpelle ses contemporains.
(Marcelline[1] évoque la détresse des
femmes de condition sociale modeste, maintenues dans l’ignorance et la pauvreté, le
comportement des hommes…).
=> Naissance d’une littérature de contestation
∆) Les Lumières développent de nouvelles formes d’expression afin de combattre des
réalités de leur temps :
II- Des combats menés contre les réalités de leurs temps
Les philosophes des Lumières se sont engagés pour les causes de leur temps.
A- Un combat contre la société de son temps
• Malgré le ton léger, dans Candide, Voltaire évoque des réalités peu plaisantes : la
guerre ; le froid et la faim ; la maladie, dans la personne de Pangloss retrouvé en Hollande
sous l’apparence d’un »gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez
rongé..
» ; les catastrophes naturelles, d’abord sous la forme du séisme de Lisbonne, fait
historique survenu en novembre 1755 qui avait beaucoup impressionné les imaginations
de l’époque ; enfin sous celle de la tempête et du naufrage qui l’accompagne souvent.
• Dans Candide, Voltaire dénonce de nombreux travers de la société de son temps :
l’esclavage ; l’oisiveté et la non productivité de noblesse (il aborde également ce sujet dans
sa Lettre sur le commerce) ; l’hypocrisie …
Ex.
Candide au pays de l’Eldorado : critique sous-jacente de la société française et injuste.
Or, c’est justement par l’utopie que Voltaire nous fait prendre conscience de cette injustice
et il évite ainsi tout censure.
Voltaire dénonce, dans ce petit conte, les abus de la société.
• Neveu de Rameau : Diderot peut dresser une satire de la société à travers ses deux
personnages.
En représentant les grands, le Neveu nous en montre également ses aspects
négatifs.
Néanmoins, après la démonstration du philosophe, « Lui » n'est pas convaincu
par ses arguments et il reste sur l'idée de bizarrerie des philosophes : chacun reste sur ses
positions => but du dialogue devient peut-être alors précisément d'amener le lecteur à se
faire une opinion.
B- Un combat contre la « religion » ou surtout l’Inquisition
• Cf.
Voltaire : parlez par exemple de l’affaire Calas (lutte pour réhabiliter la mémoire d’un
protestant, accusé à tort, en raison de sa religion, du meurtre de son fils) ou celle du
chevalier de la Barre.
• Dans Candide, Voltaire dénonce l’Inquisition et le fanatisme religieux.
Ex : «....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓