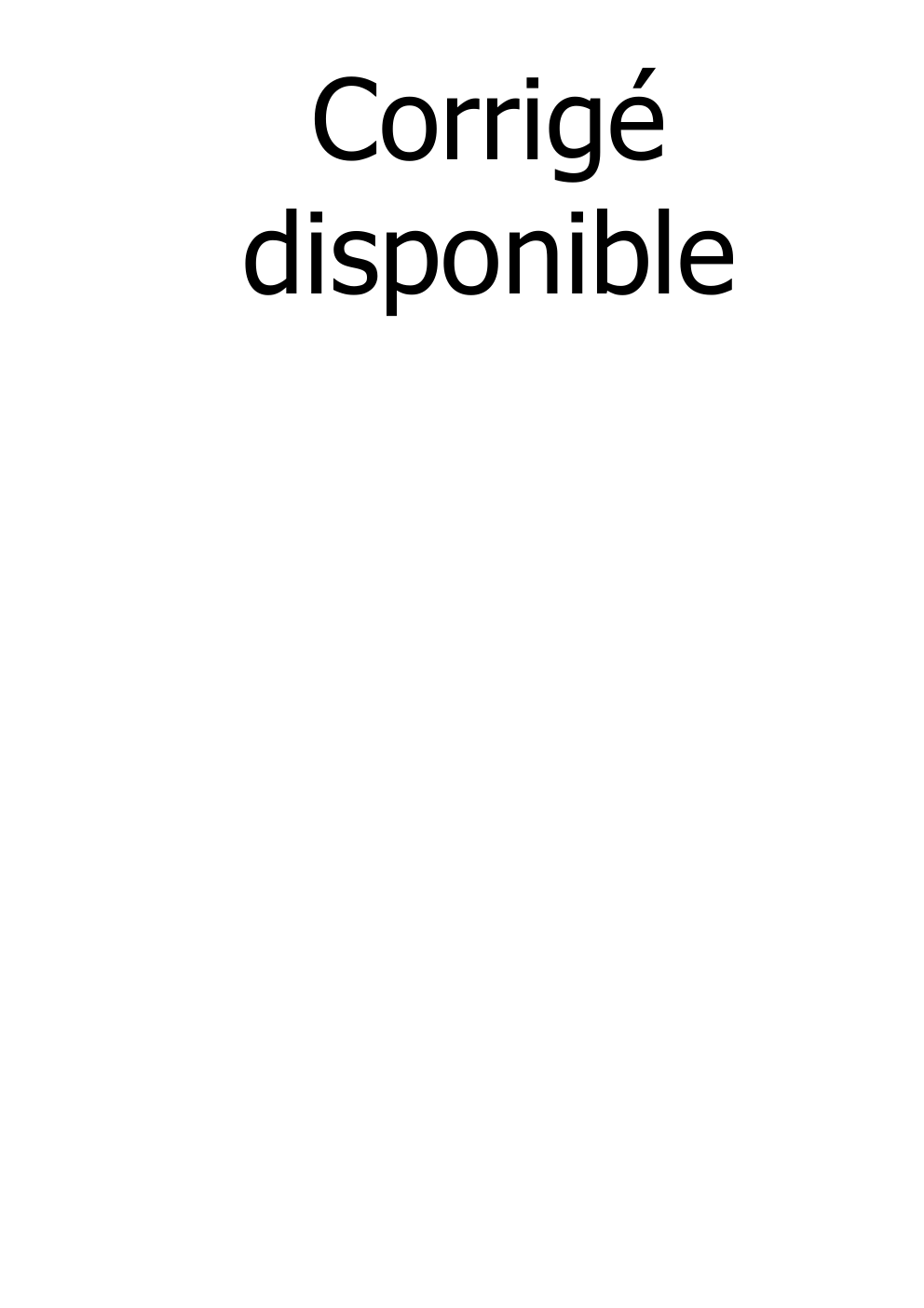Corrigé disponible L’apologue est un court récit souvent allégorique, une histoire en vers ou en prose, comportant un enseignement ou...
Extrait du document
«
Corrigé
disponible
L’apologue est un court récit souvent allégorique, une histoire en vers ou en prose,
comportant un enseignement ou une morale.
Ce terme générique regroupe donc des récits
tels les contes philosophiques, les fables, les paraboles, les utopies, les contre utopies…
=> La fable est donc une sorte d’apologue, au même titre que le conte…
La Fontaine introduit le livre I des Fables en s'adressant à monseigneur le Dauphin en ces
termes : « je ne doute point monseigneur, que vous ne regardiez favorablement des
inventions si utiles et tout ensemble si agréables ».
=> Quelle est la stratégie argumentative de l’apologue, de la fable ? Qu’est-ce
qui peut limiter leur portée ?
I- La fantaisie de l’apologue
A- Un genre souvent adapté enfants
• La Fontaine dédie ses fables à un enfant, au Dauphin =>nombreuses fables font parler
des animaux, personnifications.
Monde enfantin : animaux qui parlent…
• Candide : les personnages sont tous bons ou mauvais.
Jeux de mots sur les nom (Candide
est naïf, M.
Vanderdendur, le méchant hollandais qui exploite le « nègre »…), facéties : les
quartiers de noblesse), personnages meurent et ressuscitent (Pangloss)…
• Les contes de Perrault sont surtout lus par les enfants (Le Petit poucet, La Belle au bois
dormant…).
B- Un récit très agréable à lire
• Fable de La Fontaine => récit léger et agréable.
Vs chez Ésope, pour qui le récit n’a
qu’une fonction secondaire, d’illustration, chez La Fontaine, le récit (animé, vivant et
pittoresque par la variété des temps employés) se développe considérablement par rapport
à la morale, qui, loin de rester la seule finalité de la fable, en devient plutôt le prétexte =>
ses fables sont de véritables petites scènes de genre, pittoresques et circonstanciées, le
plus souvent teintées d’humour.
Jouant sur l’alternance irrégulière de différents mètres
(octosyllabes et alexandrins, par exemple), La Fontaine dynamise le récit, lui donner
l’allure naturelle d’un conte, à mi-chemin entre prose et poésie.
Cf.
« Les Obsèques de la
lionne ».
• Candide se promène à travers le monde, découvre un pays utopique, celui de l’Eldorado…
Voltaire décrit le parcours d’un jeune homme naïf qui parcourt le monde, accompagné de
Pangloss son mentor, un philosophe pour qui « tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes ».
C- Le dépaysement, l’amusement
• Zadig de Voltaire : histoire orientale, dépaysement du lecteur.
Voltaire situe l’action dans
l’Orient lointain, à une époque imaginaire et antique.
Exotisme qui rappelle les Mille et une
nuits.
« Du temps du roi Moabdard… »
•Candide : les personnages sont tous bons ou mauvais.
Jeux de mots sur les nom (Candide
est naïf, M.
Vanderdendur, le méchant hollandais qui exploite le « nègre »…), facéties : les
quartiers de noblesse… Candide se promène à travers le monde, découvre un pays
utopique, celui de l’Eldorado… Voltaire décrit le parcours d’un jeune homme naïf qui
parcourt le monde, accompagné de Pangloss son mentor, un philosophe pour qui « tout
est pour le mieux dans le meilleur des mondes ».
Dans Candide, nous sommes dans l’univers du conte, de l’histoire plaisante où le
héros se fait fesser en cadence et où ceux qui meurent peuvent revenir.
∆) L’apologue est un récit plaisant => facile et agréable à lire, il touche plus le
lecteur qui est donc amené plus facilement à être touché par l’argumentation sous-jacente
au texte.
NB : La Fontaine s’accuse lui-même de futilité quand il se définit dans une lettre à Madame
de la Sablière : « Je suis chose légère et je vole à tout sujet.
Je vais de fleur en fleur et
d'objet en objet ».
II- L’apologue, un texte à plusieurs niveaux… qui peuvent ne pas être perçus…
A- Les pistes qui signalent que le récit n’est pas aussi anodin qu’il pourrait paraître
Au fil du texte, de nombreux éléments signalent au lecteur que le récit n’est pas
si anodin.
• Dans les fables de La Fontaine, bien que l’on soit dans le monde animal, le système décrit
ressemble fort à celui des hommes et à celui de la cour de Louis XIV : « le Prince, sa
Province, les Prévôts, Messieurs les Courtisans, la Reine, le Roi ».
Cf.
chez Voltaire, même
dans un Orient profond on retrouve des personnages bien connus (le juge…).
• L’ironie est l’art de dire le contraire de ce que l’on pense, de se moquer de quelqu’un ou
de quelque chose en vue de faire réagir un lecteur ou un interlocuteur.
De nombreux
auteurs, dont Voltaire, ont eu recourt à l’ironie afin de dénoncer, de critiquer les travers et
les vices de la société ou de comportements.
=> L’ironie est omniprésente dans Candide :
- « Comment on fit un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre,
et comment Candide fut fessé » (Voltaire a subi l’autodafé + à la fin du chapitre, la terre
tremble).
- Guerre : « boucherie héroïque », « Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si
bien ordonné que les deux armées ».
- Dans le chapitre VI, Candide et Pangloss, pour des raisons dérisoires, sont
conduits « séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on
n'était jamais incommodé du soleil ».
Comprenons que Voltaire désigne ici le cachot !
∆) L’ironie invite donc le lecteur à être actif pendant sa lecture, à réfléchir et à
choisir une position.
L’auteur d’un apologue parsème ainsi son texte d’éléments qui doivent
interpeller.
La lecture ne doit donc pas se faire au premier degré simplement.
Toutefois, le propre de l’ironie est d’être à double sens => le risque est qu’elle ne soit pas
perçue…
B- Une ambiguïté de lectorat
Pour qui s’adressent les apologues ?
• La Fontaine adresse ses fables à un enfant, Louis de France, dit plus tard le
Grand Dauphin, qui a alors 7 ans.
« Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons » :
à la grande joie des plus petits, les fables font parler des animaux.
Mise en scène du monde
animal : le lion, la belette, le singe, tous parlent, certains sont habillés et ils ressemblent
aux hommes : univers de l’enfant.
=> Les fables sont ânonnées en classe par tous les petits écoliers de France et de Navarre.
Les Contes de Perrault, Le Petit Chaperon rouge, Peau d’âne, Le Petit Poucet, Le Chat
Botté… => appartiennent à la littérature enfantine.
• Pourtant, les messages de ces histoires s’adressent-ils vraiment à des enfants.
Cf.
dans L’Émile, Rousseau démontre que les Fables de La Fontaine ne sont pas destinées
aux enfants, qu’elles ne sont pas appropriées à leur esprit encore trop jeune – morale trop
pessimiste….
(En effet, contes et fables ne sont pas gratuits, ils sont utilisés par l’auteur
comme vecteur de son message).
• Or : justement parce qu’ils sont lus par des enfants, que l’apologues, la fable…
semblent n’être que....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓