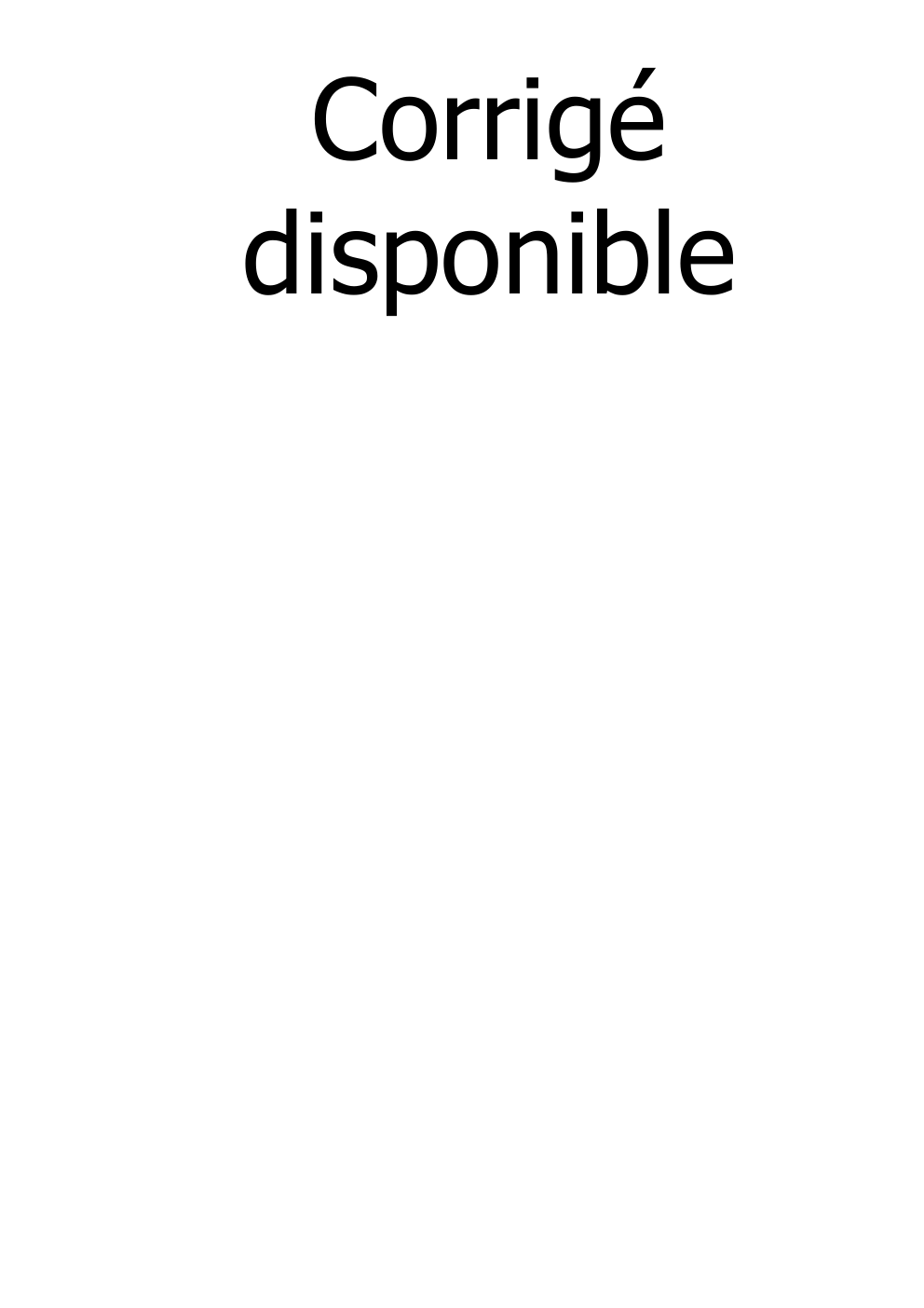Corrigé disponible Jean Genet, Préface de Les Bonnes : « Je vais au théâtre afin de me voir, sur la...
Extrait du document
«
Corrigé
disponible
Jean Genet, Préface de Les Bonnes : « Je vais au théâtre afin de me voir, sur la
scène (restitué en un seul personnage ou à l'aide d'un personnage multiple et
sous forme de conte) tel que je ne saurais – ou n'oserais – me voir ou me rêver,
et tel pourtant que je sais être.
Les comédiens ont donc pour fonction d'endosser
des gestes et des accoutrements qui leur permettront de me montrer à moimême, et de me montrer nu, dans la solitude et sans allégresse ».
Expliquez et éventuellement discutez cette conception du théâtre et du
jeu
comédien
en
faisant
référence
notamment
aux
pièces
que
vous
connaissez.
Genet => le personnage de théâtre > joué par le comédien, représente le spectateur, lui
rappelle qui il est vraiment.
Rôle des comédiens => nous montrer à nous même ; Rôle du
théâtre => nous montrer sur scène.
Le théâtre nous représente-t-il sur scène ?
I- Le monde du théâtre
A- Un spectacle
• Le théâtre est le monde de l’illusion => le public vient pour assister à un spectacle.
• Salle de théâtre => endroit fermé, moment à part, le temps de la représentation.
Salle
dans le noire : personnes regroupées le temps du spectacle.
Moments ritualisés : les coups
de bâton, les entractes…
• Le théâtre est un moment particulier où le spectateur s’évade de son quotidien.
Théâtre,
«pays de l’irréel » : monde de carton : décor ; éclairages, musiques, costumes...
tout est
« artificiel » et entre dans des règles (vers, diction : pas très naturel > on parle rarement
en alexandrins…), réalités scéniques…
+ Le comédien feint d’être le personnage (maquillage, costume) et le spectateur feint de
croire qu’il est.
B- Des personnages bien différents de nous
• Au théâtre => les personnages sont définis par leur statut social très défini (Les Bonnes,
Le Bourgeois gentilhomme… ; héros de tragédie sont des rois, des demi-dieux.
Cf.
Bérénice, Néron, Titus, Phèdre, Hyppolite…).
Évoquez la vraie différence entre les
soubrettes et les maîtresses (Cf.
Marivaux qui inverse même les rôles dans L’Ile aux
esclaves) => ce qui est renforcé par les costumes.
La servante ne sera pas habillée comme
sa dame.
• Soumis à des passions, des sentiments extrêmes, exacerbés (parfois, pas loin de la folie)
et aucune véritable occupation autre que leurs passions (les femmes ne travaillent pas…).
• Ils ont des destins d’exception.
Cf.
Ruy Blas ou Hernani.
C- Des personnages aux mentalités différentes du spectateur, excessives parfois
• Il est très difficile pour un spectateur d’aujourd’hui de comprendre pourquoi Rodrigue
doit aller tuer le père de Chimène simplement parce que ce dernier a donné un soufflet à
son père => code de l’honneur bien éloigné de notre vie.
• Phèdre jalouse pense tuer sa rivale et conduit à la mort celui qu’elle aime.
• Les codes de l’honneur, les mentalités nous semblent très très éloignés, voire
incompréhensibles.
Pourquoi Agamemnon devrait-il sacrifier sa fille pour aller à la guerre…
∆) Il semblerait que les personnages sur scène ne soient pas si proches que cela de nous,
et pourtant…
II- Un spectacle pas si éloigné de la réalité
A- Le héros bon et brigand du drame romantique
• Drame romantique : héros singuliers remplacent les personnages stéréotypés des XVIIe
et XVIIIe siècles.
Hugo voulait rendre vrais ses personnages (pas que tragiques ou
comiques).
Hugo : « Les personnages de l’ode sont des colosses : Adam, Caïn, Noé ; ceux
de l’épopée sont des géants : Achille, Atrée, Oreste ; ceux du drame sont des hommes :
Hamlet, Macbeth, Othello.
L’ode vit de l’idéal, l’épopée du grandiose, le drame du réel ».
• Le héros romantique est comme le spectateur bon et mauvais : on pense aux orgies de
Lorenzo (qui lui valent le surnom péjoratif de Lorenzaccio), à sa vie malsaine.
Et pourtant,
le fond de son cœur est pur.
Il a un idéal.
Hernani : héros courageux mais jaloux !
∆) Par certains aspects, le héros romantique ressemble plus au spectateur car il
est plus complexe, moins stéréotypé.
B- Quand la caricature sert le réel
• Prendre une pièce et montrer comment tout est un peu grossi, caricatural mais que
finalement, ce n’est pas si loin de la vérité.
• Par ses comédies, Molière dénonce le ridicule d’une société > moraliste => reprend la
devise d’Horace Castigat ridendo mores d’Horace – corriger les moeurs par le rire.
Ex : se moque des Précieuses dans les Précieuses ridicules ou les Femmes savantes ;
critique des défauts des hommes et par exemple, l’aveuglement d’Orgon qui doit attendre
de voir son cher ami caresser sa femme pour comprendre que ce dernier n’est pas le saint
qu’il prétend être.
Cf.
Tartuffe.
Ex : le spectateur rit de bon cœur devant Harpagon qui pleure devant la perte de sa
cassette « mon pauvre argent ! Mon pauvre argent ! Mon cher ami ! On m'a privé de toi »
mais pour Molière, il devrait aussi prendre conscience, s’il est avare, du ridicule de son
comportement.
Ex : Tartuffe : « type » du faux dévot.
Molière l’a inventé en regroupant toutes les
caractéristiques des dévots qui entourent Louis XIV.
Histoire inventée et caricature mais
les « dévots » et « faux dévots » existaient.
La caricature est un miroir de la réalité.
=> Derrière le rire et la caricature, le spectateur doit / peut se reconnaître.
C- Le théâtre miroir du réel
• Ex : Rhinocéros Par l’absurde de sa pièce (Jean etc.
qui deviennent des rhinocéros),
Ionesco montre, met en scène une réalité : la monté du nazisme ou de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓