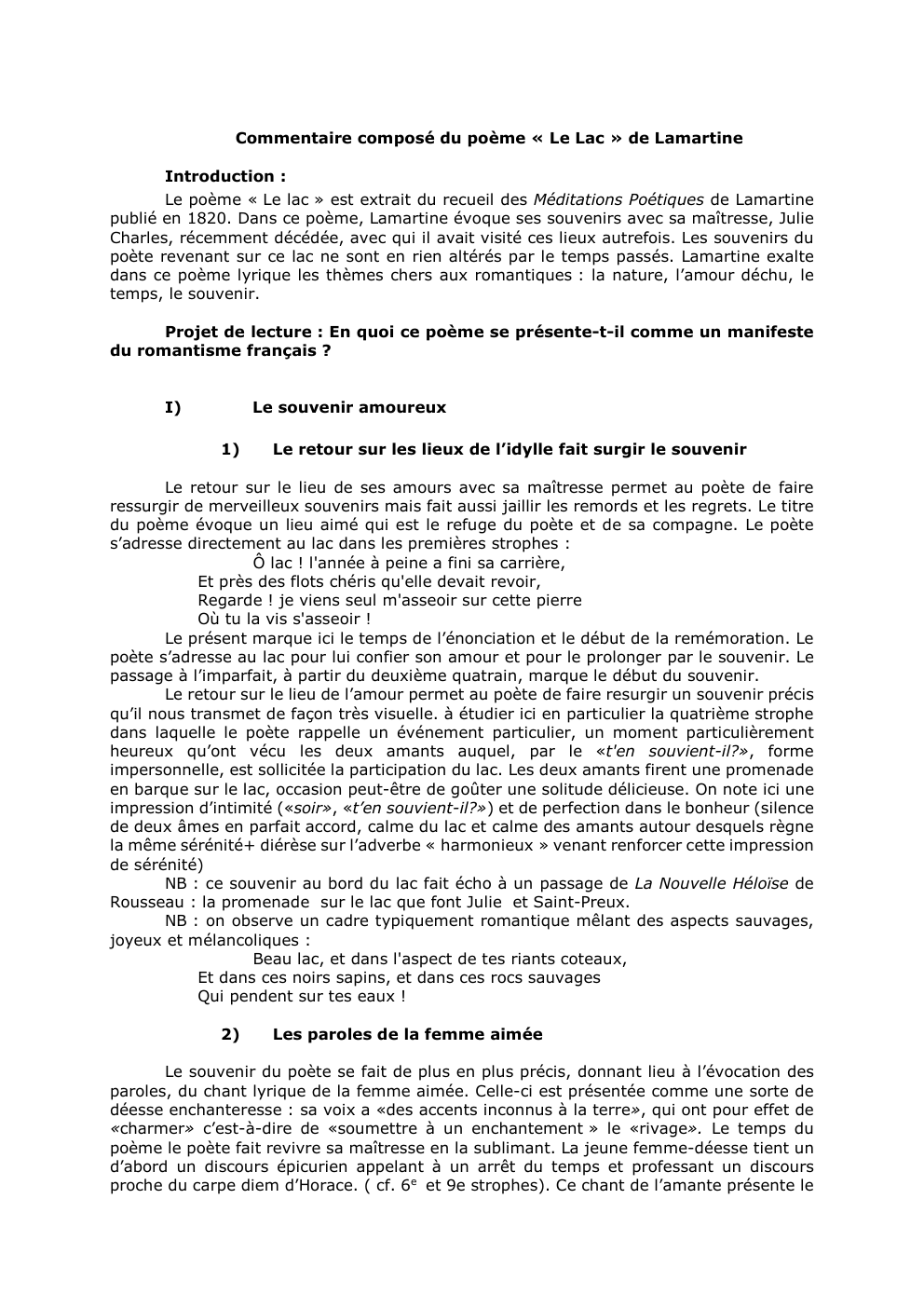Commentaire composé du poème « Le Lac » de Lamartine Introduction : Le poème « Le lac » est extrait...
Extrait du document
«
Commentaire composé du poème « Le Lac » de Lamartine
Introduction :
Le poème « Le lac » est extrait du recueil des Méditations Poétiques de Lamartine
publié en 1820.
Dans ce poème, Lamartine évoque ses souvenirs avec sa maîtresse, Julie
Charles, récemment décédée, avec qui il avait visité ces lieux autrefois.
Les souvenirs du
poète revenant sur ce lac ne sont en rien altérés par le temps passés.
Lamartine exalte
dans ce poème lyrique les thèmes chers aux romantiques : la nature, l’amour déchu, le
temps, le souvenir.
Projet de lecture : En quoi ce poème se présente-t-il comme un manifeste
du romantisme français ?
I)
Le souvenir amoureux
1)
Le retour sur les lieux de l’idylle fait surgir le souvenir
Le retour sur le lieu de ses amours avec sa maîtresse permet au poète de faire
ressurgir de merveilleux souvenirs mais fait aussi jaillir les remords et les regrets.
Le titre
du poème évoque un lieu aimé qui est le refuge du poète et de sa compagne.
Le poète
s’adresse directement au lac dans les premières strophes :
Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s'asseoir !
Le présent marque ici le temps de l’énonciation et le début de la remémoration.
Le
poète s’adresse au lac pour lui confier son amour et pour le prolonger par le souvenir.
Le
passage à l’imparfait, à partir du deuxième quatrain, marque le début du souvenir.
Le retour sur le lieu de l’amour permet au poète de faire resurgir un souvenir précis
qu’il nous transmet de façon très visuelle.
à étudier ici en particulier la quatrième strophe
dans laquelle le poète rappelle un événement particulier, un moment particulièrement
heureux qu’ont vécu les deux amants auquel, par le «t'en souvient-il?», forme
impersonnelle, est sollicitée la participation du lac.
Les deux amants firent une promenade
en barque sur le lac, occasion peut-être de goûter une solitude délicieuse.
On note ici une
impression d’intimité («soir», «t’en souvient-il?») et de perfection dans le bonheur (silence
de deux âmes en parfait accord, calme du lac et calme des amants autour desquels règne
la même sérénité+ diérèse sur l’adverbe « harmonieux » venant renforcer cette impression
de sérénité)
NB : ce souvenir au bord du lac fait écho à un passage de La Nouvelle Héloïse de
Rousseau : la promenade sur le lac que font Julie et Saint-Preux.
NB : on observe un cadre typiquement romantique mêlant des aspects sauvages,
joyeux et mélancoliques :
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux !
2)
Les paroles de la femme aimée
Le souvenir du poète se fait de plus en plus précis, donnant lieu à l’évocation des
paroles, du chant lyrique de la femme aimée.
Celle-ci est présentée comme une sorte de
déesse enchanteresse : sa voix a «des accents inconnus à la terre», qui ont pour effet de
«charmer» c’est-à-dire de «soumettre à un enchantement » le «rivage».
Le temps du
poème le poète fait revivre sa maîtresse en la sublimant.
La jeune femme-déesse tient un
d’abord un discours épicurien appelant à un arrêt du temps et professant un discours
proche du carpe diem d’Horace.
( cf.
6e et 9e strophes).
Ce chant de l’amante présente le
bonheur amoureux comme une expérience intense et brève.
Ce chant résonne dans l’esprit
du poète qui médite ensuite sur ce souvenir fugitif mais intense du bonheur amoureux :
« Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur », l’intensité, la plénitude de l’amour sont
rendues par la longueur de diphtongues qui résonnent longtemps : «Où», «mour»,
«longs», «nous», «vers», «nheur».
La paix de l’amour est rendue par la régularité du
rythme.
Le poème s’achève sur l’affirmation de la réalité de cet amour : «Tout dise : « Ils
ont aimé ! »
II)
La fuite du temps
1)
L’obsession du temps
Dans ce poème, on observe une omniprésence de la référence au temps.
Le temps
semble être une obsession pour le poète.à étudier le champ lexical du temps ordonné selon
des divisions temporelles : "la nuit", "le jour", "l’aurore", "le soir", "les heures", "l’année",
"moments", "l’éternité".
L’omniprésence du temps est aussi figurée par l’alternance dans
le poème entre présent, passé simple, imparfait et même le futur dans la première strophe.
Cette obsession du temps est associé à un désir épicurien dans tout le poème.
à étudier la
métaphore
«Ô
temps,
suspends
ton
vol !
et
vous,
heures
propices,
Suspendez votre cours ! » : le temps est ici assimilé à un oiseau à qui le poète enjoint de
se reposer.
2)
L’impuissance de l’homme face au temps
Si le poète est obsédé par le temps, c’est parce qu’il prend conscience de son
impuissance fasse à lui.
L’homme n’a aucune prise sur la fuite du temps : c’est le constat
amer fait dans tout ce poème : « Le temps m'échappe et fuit » .
Dès la première
strophe, la passivité et l’impuissance de l’homme face au temps sont soulignées par la
voix passive – « Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,/Dans la nuit
éternelle emportés sans retour » - et par la métaphore « l’océan des âges » présentant
le temps comme un flot interminable qui n’est pas à la mesure de l’homme.
Le temps est
ressenti de façon subjective par l’homme, les moments d'attente semblent interminables
et ceux de bonheur trop courts.
L’homme voudrait pouvoir accélérer le temps dans les
moments difficiles et ralentir sa course pour pérenniser les moment heureux.
Etudier la
référence aux « malheureux » dans le chant de l’amante :
Assez de malheureux ici-bas vous implorent ;
Coulez, coulez pour eux ;
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ;
Oubliez les heureux.
Cette strophe correspond à cette demande d'accélérer le temps pour soulager les
souffrances que l'on ressent et dont on attend des lendemains meilleurs.
La fragilité de l’homme est mise en valeur et donne une tonalité élégiaque, lyrique,
au poème.
Le poète, à travers les paroles de l’aimée, se plaint en apostrophant le temps ;
il évoque sa douleur à travers plusieurs interro-négations à la strophe 11 :
Hé quoi ! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ?
Quoi ! passés pour jamais ? quoi ! tout entiers perdus ?
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface
Ne nous les rendra plus ?
Le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓