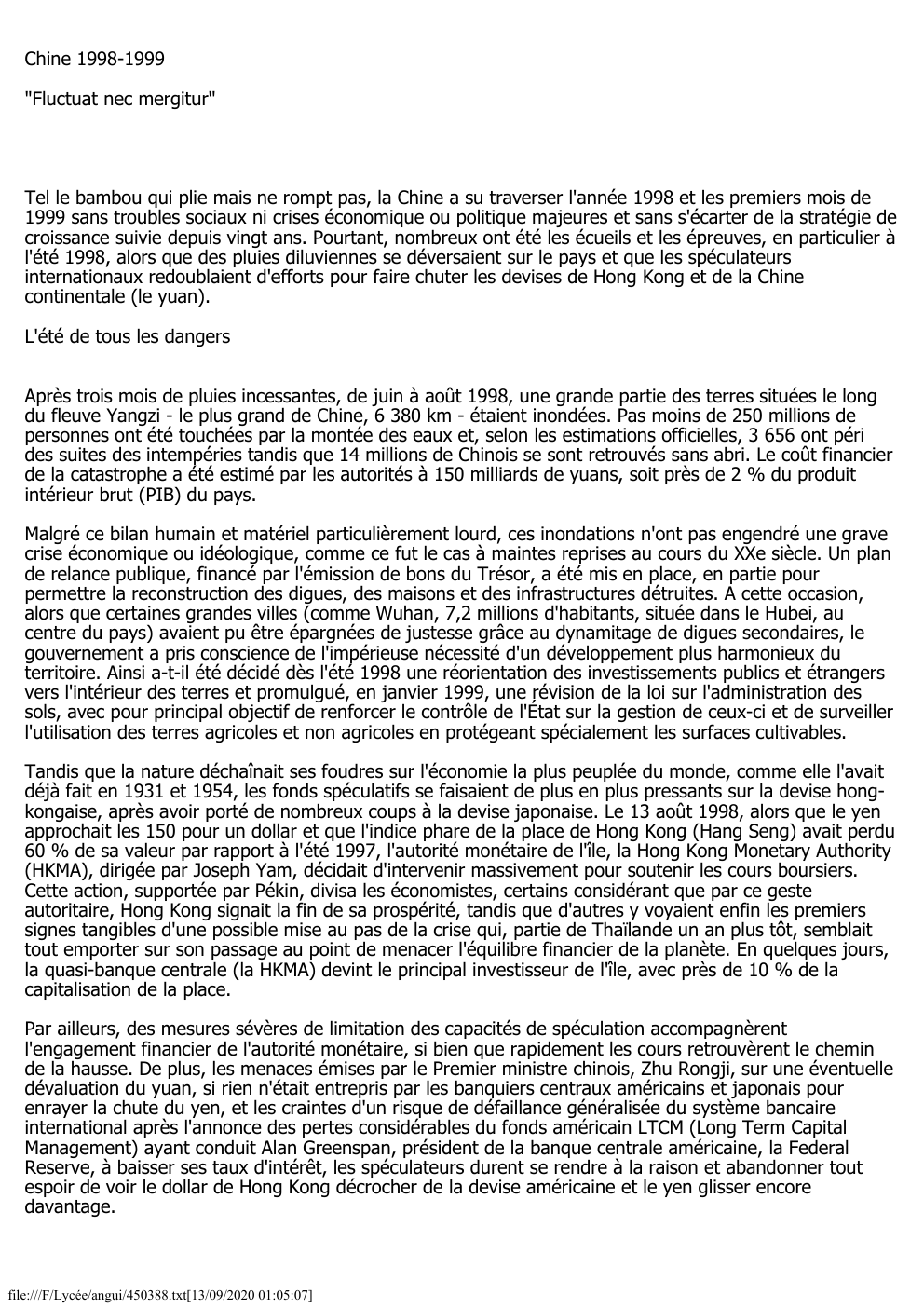Chine 1998-1999 "Fluctuat nec mergitur" Tel le bambou qui plie mais ne rompt pas, la Chine a su traverser l'année...
Extrait du document
«
Chine 1998-1999
"Fluctuat nec mergitur"
Tel le bambou qui plie mais ne rompt pas, la Chine a su traverser l'année 1998 et les premiers mois de
1999 sans troubles sociaux ni crises économique ou politique majeures et sans s'écarter de la stratégie de
croissance suivie depuis vingt ans.
Pourtant, nombreux ont été les écueils et les épreuves, en particulier à
l'été 1998, alors que des pluies diluviennes se déversaient sur le pays et que les spéculateurs
internationaux redoublaient d'efforts pour faire chuter les devises de Hong Kong et de la Chine
continentale (le yuan).
L'été de tous les dangers
Après trois mois de pluies incessantes, de juin à août 1998, une grande partie des terres situées le long
du fleuve Yangzi - le plus grand de Chine, 6 380 km - étaient inondées.
Pas moins de 250 millions de
personnes ont été touchées par la montée des eaux et, selon les estimations officielles, 3 656 ont péri
des suites des intempéries tandis que 14 millions de Chinois se sont retrouvés sans abri.
Le coût financier
de la catastrophe a été estimé par les autorités à 150 milliards de yuans, soit près de 2 % du produit
intérieur brut (PIB) du pays.
Malgré ce bilan humain et matériel particulièrement lourd, ces inondations n'ont pas engendré une grave
crise économique ou idéologique, comme ce fut le cas à maintes reprises au cours du XXe siècle.
Un plan
de relance publique, financé par l'émission de bons du Trésor, a été mis en place, en partie pour
permettre la reconstruction des digues, des maisons et des infrastructures détruites.
A cette occasion,
alors que certaines grandes villes (comme Wuhan, 7,2 millions d'habitants, située dans le Hubei, au
centre du pays) avaient pu être épargnées de justesse grâce au dynamitage de digues secondaires, le
gouvernement a pris conscience de l'impérieuse nécessité d'un développement plus harmonieux du
territoire.
Ainsi a-t-il été décidé dès l'été 1998 une réorientation des investissements publics et étrangers
vers l'intérieur des terres et promulgué, en janvier 1999, une révision de la loi sur l'administration des
sols, avec pour principal objectif de renforcer le contrôle de l'État sur la gestion de ceux-ci et de surveiller
l'utilisation des terres agricoles et non agricoles en protégeant spécialement les surfaces cultivables.
Tandis que la nature déchaînait ses foudres sur l'économie la plus peuplée du monde, comme elle l'avait
déjà fait en 1931 et 1954, les fonds spéculatifs se faisaient de plus en plus pressants sur la devise hongkongaise, après avoir porté de nombreux coups à la devise japonaise.
Le 13 août 1998, alors que le yen
approchait les 150 pour un dollar et que l'indice phare de la place de Hong Kong (Hang Seng) avait perdu
60 % de sa valeur par rapport à l'été 1997, l'autorité monétaire de l'île, la Hong Kong Monetary Authority
(HKMA), dirigée par Joseph Yam, décidait d'intervenir massivement pour soutenir les cours boursiers.
Cette action, supportée par Pékin, divisa les économistes, certains considérant que par ce geste
autoritaire, Hong Kong signait la fin de sa prospérité, tandis que d'autres y voyaient enfin les premiers
signes tangibles d'une possible mise au pas de la crise qui, partie de Thaïlande un an plus tôt, semblait
tout emporter sur son passage au point de menacer l'équilibre financier de la planète.
En quelques jours,
la quasi-banque centrale (la HKMA) devint le principal investisseur de l'île, avec près de 10 % de la
capitalisation de la place.
Par ailleurs, des mesures sévères de limitation des capacités de spéculation accompagnèrent
l'engagement financier de l'autorité monétaire, si bien que rapidement les cours retrouvèrent le chemin
de la hausse.
De plus, les menaces émises par le Premier ministre chinois, Zhu Rongji, sur une éventuelle
dévaluation du yuan, si rien n'était entrepris par les banquiers centraux américains et japonais pour
enrayer la chute du yen, et les craintes d'un risque de défaillance généralisée du système bancaire
international après l'annonce des pertes considérables du fonds américain LTCM (Long Term Capital
Management) ayant conduit Alan Greenspan, président de la banque centrale américaine, la Federal
Reserve, à baisser ses taux d'intérêt, les spéculateurs durent se rendre à la raison et abandonner tout
espoir de voir le dollar de Hong Kong décrocher de la devise américaine et le yen glisser encore
davantage.
file:///F/Lycée/angui/450388.txt[13/09/2020 01:05:07]
Certains, pris de panique, quittèrent précipitamment les marchés asiatiques après avoir racheté leurs
positions, initiant un mouvement de forte appréciation du yen, et une baisse de la pression sur la devise
hong-kongaise.
Par ricochet, les taux d'intérêt à Hong Kong pouvaient baisser, mouvement favorable à
une reprise de l'immobilier, secteur particulièrement stratégique pour la petite île chinoise.
A la mi-octobre 1998, l'indice Hang Seng avait repassé la barre des 10 000 points, soit une hausse de 50
% par rapport au point bas atteint en août 1998.
Aussi, alors que la Chine était parvenue à contenir les assauts des spéculateurs et les dérèglements de la
nature, par une politique de relance et de restructurations visant à améliorer l'efficacité du système
productif dans son ensemble, la mise en faillite de la société d'investissement de la province du
Guangdong, la Guangdong International Trust and Investment Company (GITIC), le 6 octobre 1998,
confirma la volonté des autorités d'éviter à la Chine une crise financière analogue à celle qui avait plongé
ses voisins d'Asie dans la récession en 1998.
Simultanément à l'annonce de la liquidation de quelques
ITIC, Zhu Rongji décida de réformer en profondeur le secteur financier.
A l'hiver 1998 fut mise en place la
nouvelle organisation de la banque centrale selon le modèle de la Réserve fédérale américaine, puis une
nouvelle loi sur les marchés financiers fut établie pour entrer en vigueur le 1er juillet 1999, tandis que les
pouvoirs des institutions de contrôle étaient renforcés.
Pour rééquilibrer le développement du pays, le gouvernement décida de recentraliser le marché des
grains.
Désormais les paysans ne pourront plus vendre qu'aux entreprises d'État spécialisées qui
s'engagent à acheter leur récolte et à les payer rapidement, à charge pour elles de les revendre aux
entreprises de transformation.
L'objectif de cette politique est d'accroître le revenu des paysans chinois,
qui jusqu'alors devaient céder aux tentations des entreprises privées qui leur proposaient d'acheter leur
production à vil prix en échange d'un paiement comptant, alors que les compagnies publiques, à court de
trésorerie, tardaient à les régler.
Pour éviter de telles mésaventures à l'avenir, la Banque de
développement agricole décida parallèlement d'accroître ses crédits aux entreprises d'État et de s'assurer
que les prêts seront effectivement utilisés pour l'achat des grains et non pour des opérations de
spéculation immobilière comme cela fut régulièrement le cas - à grande échelle - dans le passé.
En
octobre 1998, le gouvernement annonça avoir mis fin à un vaste mécanisme - estimé à 214 milliards de
yuans - de détournement d'argent public.
Des entreprises d'État chargées d'acheter des grains aux
paysans utilisaient en....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓