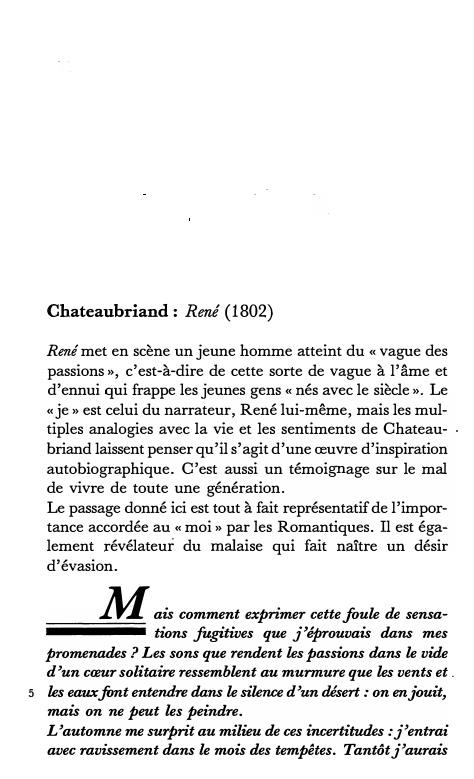Chateaubriand: René (1802) René met en scène un jeune homme atteint du« vague des passions», c'est-à-dire de cette sorte de...
Extrait du document
«
Chateaubriand: René (1802)
René met en scène un jeune homme atteint du« vague des
passions», c'est-à-dire de cette sorte de vague à l'âme et
d'ennui qui frappe les jeunes gens« nés avec le siècle».
Le
«je» est celui du narrateur, René lui-même, mais les mul
tiples analogies avec la vie et les sentiments de Chateau
briand laissent penser qu'il s'agit d'une œuvre d'inspiration
autobiographique.
C'est aussi un témoignage sur le mal
de vivre de toute une génération.
Le passage donné ici est tout à fait représentatif de l'impor
tance accordée au « moi» par les Romantiques.
Il est éga
lement révélateur du malaise qui fait naître un désir
d'évasion.
M
5
ais comment exprimer cette foule de sensa
tions fugitives que j'éprouvais dans mes
promenades ? Les sons que rendent les passions dans le vide
d'un cœur solitaire ressemblent au murmure que les vents et.
les eauxfont entendre dans le silence d'un désert: on enjouit,
mais on ne peut les peindre.
L'automne me surprit au milieu de ces incertitudes: j'entrai
avec ravissement dans le mois des tempêtes.
Tantôt j'aurais
voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des
nuages et desfantômes; tantôtj'enviaisjusqu'au sort du
pâtre-que je voyais réchauffer ses mains à l'humble feu de
broussailles qu'il avait allumé au coin d'un bois.J'écoutais
ses chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans tout
pays, le chant naturel de l'homme est triste, lors même qu'il
15 exprime le bonheur.
Notre cœur est un instrument incomplet, une ryre où il manque des cordes, et où nous sommes
forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré aux
soupirs.
Le jour, je m'égarais sur de grandes bruyères terminées par
20 des forêts.
Qµ 'ilfallait peu de chose à ma rêverie ! une feuille
séchée que le vent chassait devant moi, une cabane dont la
fumée s'élevait dans la cime dépouillée des arbres, la mousse
qui tremblait au sou.file du nord sur le tronc d'un chêne, une
roche écartée, un étang désert où le jonc flétri murmurait !
25 Le clocher solitaire s'élevant au loin dans la vallée a souvent
attiré mes regards ; souvent j'ai suivi des yeux les oiseaux de
passage qui volaient au-dessus de ma tête.Je me.figurais les
bords ignorés, les climats lointains où ils se rendent ;j'aurais
voulu être sur leurs ailes.
Un secret instinct me tourmentait;
30 je sentais que je n'étais moi-même qu'un V'!)'ageur; mais une
voix du ciel semblait me dire : « Homme, la saison de ta
migration n'est pas encore venue; attends que le vent de la
mort se lève, alors tu déploieras ton vol vers ces régi,ons inconnues qué ton cœur demande.»
35 « Levez-vous vite, orages désirés 1, qui devez emporter René
dans les espaces d'une autre vie!» Ainsi disant,je marchais
à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma
chevelure, ne sentant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté, et comme possédé par le démon de mon cœur.
10
François-René de Chateaubriand, René (1802)
1.
Ces
14
«
orages
»
peuvent être assimilés à la mort.
"
Idée directrice
Le texte associe le récit d'une expérience de vagabondage
dans la nature à l'analyse psychologique.
Le narrateur
s'interroge, s'observe et étudie ses sentiments avec une
certaine complaisance.
Les incertitudes et l'insatisfaction
qu'il sent en lui le poussent à souhaiter, avec lyrisme*, un
départ pour « une autre vie », qui est peut-être la mort.
Les caractéristiques du texte font qu'on peut étudier successivement :
- l'expression du« moi» et l'intérêt que le narrateur porte
à ses actions et à ses sentiments ;
- l'accord avec la nature ;
- le malaise et le désir d'évasion.
PISTES DE LECTURE
A.
L'expression du «moi»
Le texte est écrit à la première personne et le narrateur,
René, se met en cause dans le récit de ses actions et dans
l'analyse de ses sentiments.
• La prédominance du «je»
Presque toutes les phrases du texte comportent le pronom
personnel de la première personne.
On note ainsi treize
emplois de «je», sujet, relayé par la forme d'insistance
« moi-même » (1.
30), par des formes du pronom complément(« m' », «moi» ou« me») et par des adjectifs possessifs de la première personne (1.
2, 20, 26, 27, 29, 31, 37,
39).
La ligne 5 fait apparaître le pronom« on» et les lignes
15-18 le pronom« nous», qui englobent le narrateur dans
un groupe plus large.
Dans le passage rapporté au style
direct (1.
31-34), la première personne devenue destinataire
du message se transforme en« tu», mais il s'agit toujours
du narrateur.
15
• Le narrateur, centre d'intérêt pour lui-même
La prédominance de la première personne souligne que le
narrateur se prend lui-même comme centre d'intérêt, à la
fois dans ce qu'il fait (cela correspond au récit) et dans ce
qu'il ressent (cela correspond à l'analyse des sentiments).
- Le récit : c'est celui des actions accomplies par le narrateur («j'entrai», I.
7; «je voyais,,, I.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓