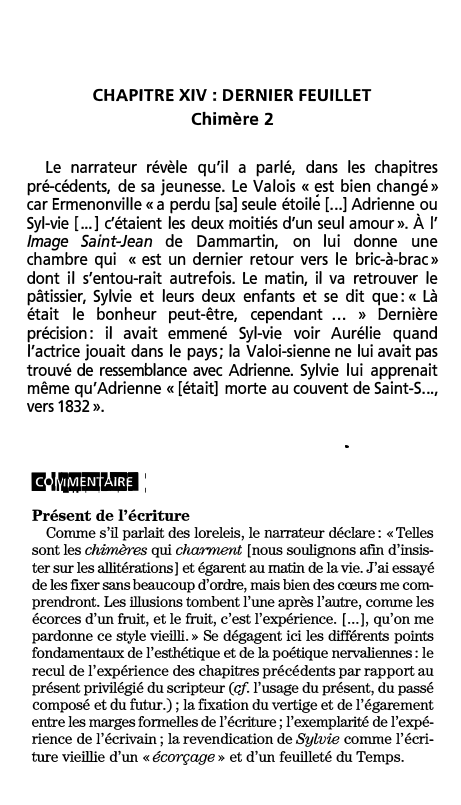CHAPITRE XIV : DERNIER FEUILLET Chimère 2 Le narrateur révèle qu'il a parlé, dans les chapitres précédents, de sa jeunesse....
Extrait du document
«
CHAPITRE XIV : DERNIER FEUILLET
Chimère 2
Le narrateur révèle qu'il a parlé, dans les chapitres
précédents, de sa jeunesse.
Le Valois « est bien changé»
car Ermenonville« a perdu [sa] seule étoile [...
] Adrienne ou
Sylvie [ ...
] c'étaient les deux moitiés d'un seul amour».
À I'
Image Saint-Jean de Dammartin, on lui donne une
chambre qui « est un dernier retour vers le bric-à-brac»
dont il s'entourait autrefois.
Le matin, il va retrouver le
pâtissier, Sylvie et leurs deux enfants et se dit que:« Là
était le bonheur peutêtre, cependant ...
» Dernière
précision: il avait emmené Sylvie voir Aurélie quand
l'actrice jouait dans le pays; la Valoisienne ne lui avait pas
trouvé de ressemblance avec Adrienne.
Sylvie lui apprenait
même qu'Adrienne« [était] morte au couvent de Saint-5...
,
vers 1832».
A•1t'dl"ifüitfüJi
Présent de l'écriture
Comme s'il parlait des loreleis, le narrateur déclare : « Telles
sont les chimères qui charment [nous soulignons afin d'insis
ter sur les allitérations] et égarent au matin de la vie.
J'ai essayé
de les fixer sans beaucoup d'ordre, mais bien des cœurs me com
prendront.
Les illusions tombent l'une après l'autre, comme les
écorces d'un fruit, et le fruit, c'est l'expérience.
[...], qu'on me
pardonne ce style vieilli.
» Se dégagent ici les différents points
fondamentaux de l'esthétique et de la poétique nervaliennes: le
recul de l'expérience des chapitres précédents par rapport au
présent privilégié du scripteur (cf.
l'usage du présent, du passé
composé et du futur.); la fixation du vertige et de l'égarement
entre les marges formelles de l'écriture; l'exemplarité de l'expé
rience de !'écrivain; la revendication de Sylvie comme l'écri
ture vieillie d'un « écorçage » et d'un feuilleté du Temps.
Feuilleté des Souvenirs du Valois;
l'espace du Temps
« Je suis le ténébreux, - le veuf, - l'inconsolé,
Le prince d'Aquitaine à la tour abolie:
Ma seule étoile est morte, - et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.»
Premier quatrain d'« El Desdichado »,
premier sonnet des Chimères.
Tout change, même la nature, si elle ne parle plus au cœur
de l'homme.
Ermenonville (cf.
chap.
IX) le déçoit.
À Othys (cf.
chap.
VI), Montagny (cf.
chap.
v et IX), Loisy (cf.
chap.
v, VIII, x et XII) et Châalis que l'on restaure (cf.
chap.
VII,
x et XI) - au rythme des souvenirs, ces noms rebondissent en
échos aux sonorités vocaliques entre le passé le plus fantas
matique et un présent si ponctuel qu'il imite le passé - le nar
rateur ne retrouve rien de lui-même.
Le souvenir personnel
vieillit puisqu'il se dégrade en« traces fugitives» de ce qui ne
fut peut-être bien qu'illusion et artifice; en effet, le narrateur
se rappelle un temps« où le naturel était affecté».
La nature traduit ainsi l'univers intérieur d'un moi que la
durée entraîne.
Cela se manifeste précisément par certains
complexes que nous avons déjà perçus :
- le motif de la mortefontaine ;
- le motif de l'écho inaudible;
- le motif de la topographie brouillée: Ermenonville - qui
incarnait pour Nerval un passé glorieux du Valois - est isolé à
l'écart des chemins praticables; c'est le passé finalement qui,
en s'estompant, devient impraticable.
À Dammartin, de la fenêtre
de la chambre où il couche quand il s'y rend, le narrateur ne dis
tingue pas Ermenonville qui n'a malheureusement pas de clo
cher vers lequel se diriger, ou s'élever...
Le culte des souvenirs
est peut-être question de foi...
Par ailleurs, cette chambre - même
si la fenêtre est« encadrée de vigne et de roses» (cf.
chap.
v, et
même VI) - n'est plus celle de la tante, ni celle de Sylvie;
- le motif du bric-à-brac stérile: renoncement en fait aux
mélanges éclectiques (au syncrétisme fascinant et illusoire?),
aux réconciliations artificielles.
On ne conciliera pas ce
qui est discontinu et hétérogène;
- le motif de la tour abolie : les souvenirs monumentaux
disparaissent aussi; le château de Dammartin n'a laissé que
les débris de ses vieilles tours de brique (cf.
chap.
rr, VII et IX).
Mais« dans les allées de tilleuls» qui les« ceignent», les enfants
de Sylvie jouent avec « les flèches paternelles ».
La tradition
« du tir des compagnons de l'arc» semble devoir subsister ...
Avec le pâtissier, Sylvie (et leurs enfants), le narrateur doit se
contenter d'évocations d'un passé qui meurt; c'est dire qu'il n'a
plus rien à partager avec eux.
D'ailleurs, devant le « sourire athé
nien» de Sylvie, il pense: « Là était le bonheur peut-être; cepen
dant ...» La nostalgie laisse place, en fait, à la mélancolie car il
n'a, au fond, aucune envie de vivre cette réalité présente.
Il ne
lui reste plus que le recours lucide aux représentations d'ordre
esthétique qu'il devra remplacer par ses transpositions person
nelles, non plus pour masquer le réel ou le fmr - démarche qui
commanda longtemps son appréhension des modèles culturels-,
mais pour opérer une purgation personnelle et exemplaire des
passions destructrices.
L'esthète devra écrire Sylvie, en somme.
Ermenonville! pays où fleurissait encore l'idylle antique, traduite
une seconde fois d'après Gessner...
(poète Suisse du XVIII" siècle)
par Nerval (?), n'est plus rien au cœur du narrateur.
Il faut donc,
de transposition en transposition, éviter que le son ne s'éteigne,
que le palimpseste ne présente qu'une surface opaque et illisible.
Esthète et écrivain
En effet, les modèles culturels traditionnels sont pré
caires car ils s'usent; ils ne peuvent valoir pour tous les temps.
Les œuvres ne peuvent plus conduire qu'à une sollicitation
lucide du fantasme; car, dans le cas contraire, ce serait là un
refuge névrotique.
Aussi l'ironie apparaît-elle.
L'ironie du scripteur - devenu le producteur de sa propre
compensation esthétique - peut lui permettre de raisonner
sa mélancolie et de refouler la nostalgie, par une pratique
intertextuelle de la parodie littéraire.
Rousseau et sa Julie
sont démentis bien sûr; le spectacle d'une nature qui a changé
ne peut consoler, on l'a vu: « Je cherche parfois à retrouver
mes bosquets de Clarens perdus au nord de Paris, dans les
brumes.» À Clarens, domaine de l'amour épuré, Julie, mariée
à Wolmar, acceptait de recevoir son ancien amoureux, Saint
Preux; et lui confiait l'éducation de ses enfants ...
Ainsi, tout
autant que les souvenirs personnels qui ne sont plus d'époque,
ce sont les représentations esthétiques qui les ont finalement
véhiculés qui sont datées ou font date, au point qu'on affecte
(encore) de les tourner en ridicule; comme « certains vers
de Roucher » (poète....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓