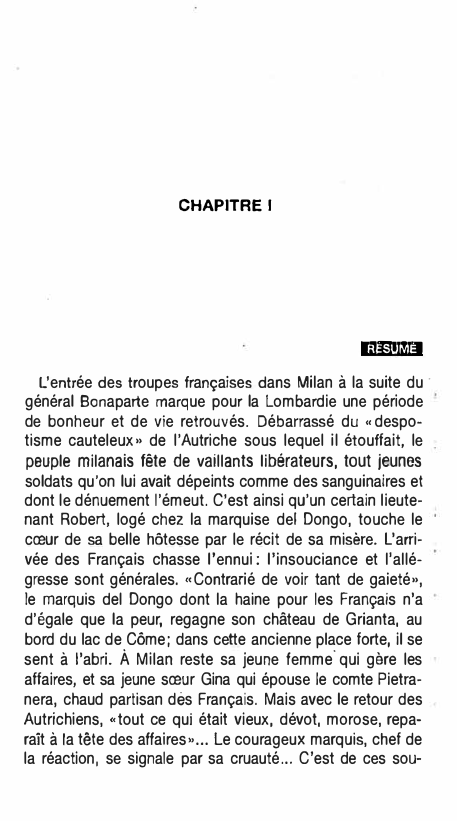CHAPITRE 1 l;li#JIJrili l'entrée des troupes françaises dans Milan à la suite du· général Bonaparte marque pour la Lombardie une...
Extrait du document
«
CHAPITRE 1
l;li#JIJrili
l'entrée des troupes françaises dans Milan à la suite du·
général Bonaparte marque pour la Lombardie une période
de bonheur et de vie retrouvés.
Débarrassé du « despo
tisme cauteleux» de l'Autriche sous lequel il étouffait, le
peuple milanais fête de vaillants libérateurs, tout jeunes
soldats qu'on lui avait dépeints comme des sanguinaires et
dont le dénuement l'émeut.
C'est ainsi qu'un certain lieute
nant Robert, logé chez la marquise del Dongo, touche le
cœur de sa belle hôtesse par le récit de sa misère.
l'arri
vée des Français chasse l'ennui: l'insouciance et l'allé
gresse sont générales.
«Contrarié de voir tant de gaieté»,
le marquis del Dongo dont la haine pour les Français n'a
d'égale que la peur, regagne son château de Grianta, au
bord du lac de Côme; dans cette ancienne place forte, il se
sent à l'abri.
À Milan reste sa jeune femme· qui gère les
affaires, et sa jeune sœur Gina qui épouse le comte Pietra
nera, chaud partisan dès Français.
Mais avec le retour des
Autrichiens, «tout ce qui était vieux, dévot, morose, repa
raît à la tête des affaires,, ...
Le courageux marquis, chef de
la réaction, se signale par sa cruauté ...
C'est de ces sou-
.
,
'
1
·
bresauts de l'Hi.stoire que naît le héros du roman, Fabrice
Valserra, qui devient ainsi le second fils du marquis; sa
mère ne quitte pas le noir depuis la défaite des Français.
Mals le sort des armes change à nouveau : Bonaparte fran
ch l t les Alpes, ·entre dans Milan, gagne à Marengo:
« l'ivresse des Milanais fut au comble».
Le marquis plus
que compromis court se terrer à Grianta...
S'écoulent"«dix années de progrès et de bonheur» ...
Fabrice fait le coup de poing avec les villageois, puis est
envoyé chez les Jésuites à Milan pour apprendre le latin;
sa tante, la jeune comtesse Pietranera, qui brille à la cour
du prince Eugène, le prend sous sa coupe et va jusqu'à
demander pour lui une place de page.
Cette folie provoque
le retour de Fabrice à Grianta où l'accueille sa mère, émer
veillée par ses grâces nouvelles, mais épouvantée par son
ignorance.
Elle en informe le lieutenant Robert avec qui elle
n'a cessé de correspondre.
La vie s'écoule fort triste sous
l'œil soupçonneux du marquis qui complote pour
l'Autriche.
Fabrice, lui, passe «ses journées à la chasse ou
à courir le lac sur une barque» tout en fréquentant les
cochers et les hommes d'écurie qui se moquent des valets
dévots et poudrés de son père.
COMMENTAIRE
Les promesses d'un roman historique
Précision et vérité de la date, du personnage, de l'événement
majeur, l'ouverture de La Chartreuse de Parme convoque les ingré
dients essentiels de la chronique napoléonnienne, dont elle semble
promettre le roman.
L'incipit (premières lignes d'un livre) nous greffe
sans équivoque sur l'Histoire, qui plus est, la grande, celle que
d'autres héros stendhaliens, nés trop tôt et surtout trop tard, ne pou
vaient que rêver et poursuivre comme un fant ôme.
Le vent d'une
époque héroïque soufflerait enfin pour Fabrice: de fait, il marchera sur
les traces réelles de Bonaparte à·Waterloo; de fait, l'empereur n'est
plus un portrait vénéré en secret, comme pour Julien Sorel, .mais per
sonnage en acte dans le roman.
Pourtant l'objectivité de la chronique
ne passe pas la troisième ligne: le franchissement du Pont de Lodi et
l'entrée des Français à Milan se lisent moins comme un épisode particulier, la prise anecdotique d'une ville, que comme l'avènement d'une
ère nouvelle, plus exactement la résurrection d'un temps héroïque,
compris comme une longue durée mythique en latence sous les accidents de l'histoire événementielle.
Le mythe
•Milan en 1796»: quoi qu'annonce le titre, trompeur, du chapitre,
(seul titre de chapitre d'ailleurs de tout le roman, auquel n" confère donc
un statut à part), ce n'est pas en fait une page d'Histoire que nous offre
La Chartreuse de Parme à ses débuts: titre en trompe l'œil, puisqu'au
delà de la septième page, le texte déborde spatialement et temporellement, les !Imites qu'il s'était fixées.
Autre débordement : la légende dissipe très vite !'Histoire et, du tableau historico-panoramique, autonome
et préalable auquel nous pouvions nous attendre, nous n'aurons
qu'une toi!e de fond mythique sur laquelle se détacheront progressivement des destinées individuelles.
Du passage du Pont de Lodi - dont
les historiens savent qu'il ne fut pas si facile - le roman ne garde que la
magie d'un franchissement allègre où s'abolit toute l'épaisseur du
réel, qui ne résiste plus à cette « jeune armée• venue réveiller un peuple
au bois dormant.
Victoire historique des Français sur les Autrichiens ?
Plus: triomphe éternel de la lumière sur les ténèbres, tel est le sens de,
pour citer Philippe Berthier, •cette avalanche de foi juvénile .déboulée
des Alpes pour pulvériser toute la vieillerie du monde•.
Une genèse
Balzac proposait à Stendhal de supprimer cette ouverture : il ne put
s'y résoudre: •ce début engage mieux mon cœur• lui répondit-il.
L'année qui précède la naissance du héros n'est certes pas le sujet du
roman, elle lui semble pourtant essentielle.
Préhistoire du récit, elle
singularise le destin de Fabrice panni les créatures stendhaliennes.
En
suggérant que le père de Fabrice est le lieutenant Robert, Stendhal fait
de ce héros un • bâtard merveilleux• promis à un supplémenl de
liberté et de fantaisie.
C'était dans une scène de brutanté paternelle
qu'apparaissait Julien Sorel, d'où un état initial de violence, de dualité,
de dissonance qui s'inscrit au cœur de l'être.
Le personnage se
construisait alors à l'intérieur de cette duplicité et n'en sortait que très
difficilement, dans la prison finale.
Tout le problème de Julien était
d'effacer le nom - ineffaçable - du Père.
Dans le monde de La Char-
treuse, la dualité existe bien entre les êtres vils et les êtres sublimes.
Mais, à la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓