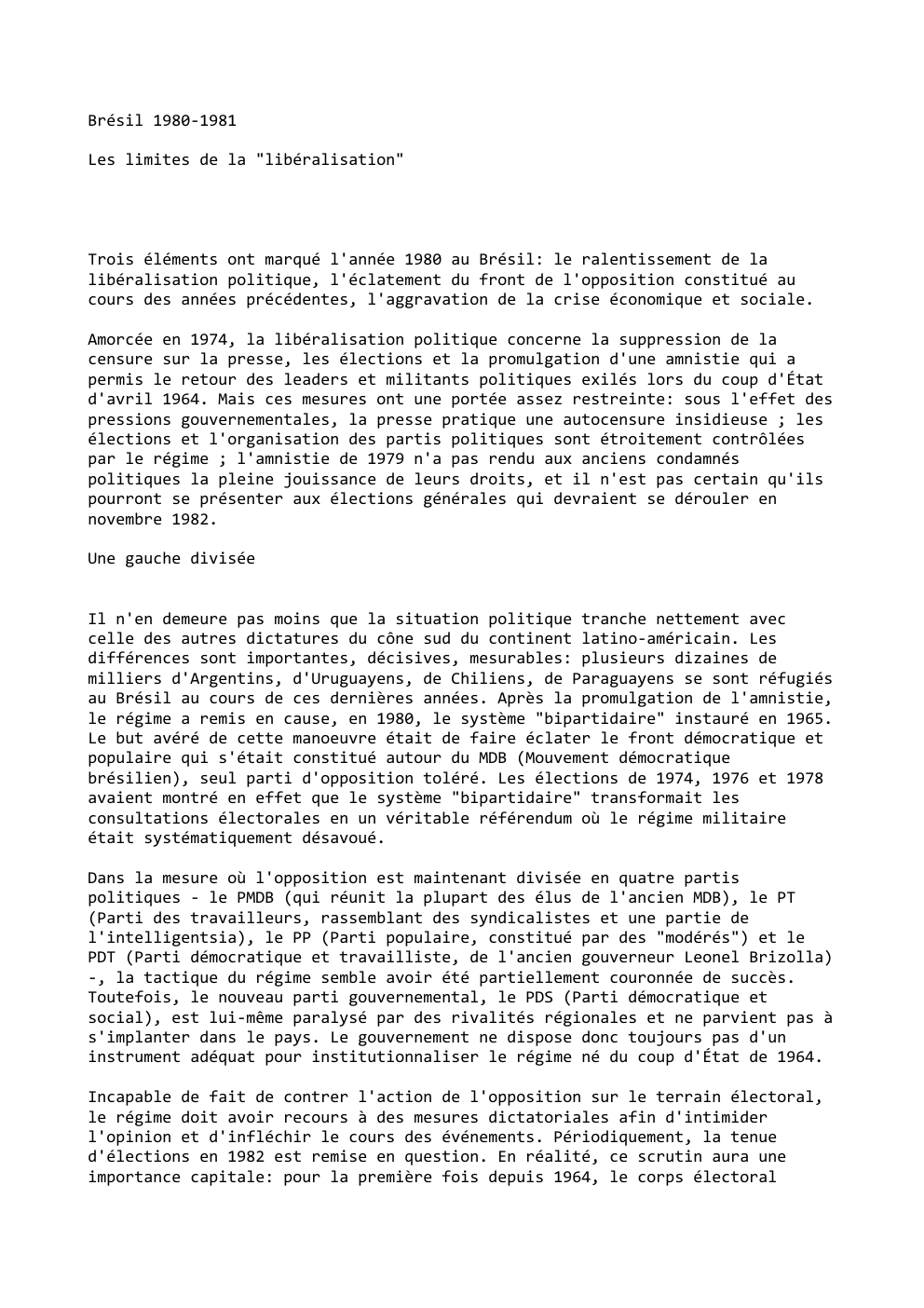Brésil 1980-1981 Les limites de la "libéralisation" Trois éléments ont marqué l'année 1980 au Brésil: le ralentissement de la libéralisation...
Extrait du document
«
Brésil 1980-1981
Les limites de la "libéralisation"
Trois éléments ont marqué l'année 1980 au Brésil: le ralentissement de la
libéralisation politique, l'éclatement du front de l'opposition constitué au
cours des années précédentes, l'aggravation de la crise économique et sociale.
Amorcée en 1974, la libéralisation politique concerne la suppression de la
censure sur la presse, les élections et la promulgation d'une amnistie qui a
permis le retour des leaders et militants politiques exilés lors du coup d'État
d'avril 1964.
Mais ces mesures ont une portée assez restreinte: sous l'effet des
pressions gouvernementales, la presse pratique une autocensure insidieuse ; les
élections et l'organisation des partis politiques sont étroitement contrôlées
par le régime ; l'amnistie de 1979 n'a pas rendu aux anciens condamnés
politiques la pleine jouissance de leurs droits, et il n'est pas certain qu'ils
pourront se présenter aux élections générales qui devraient se dérouler en
novembre 1982.
Une gauche divisée
Il n'en demeure pas moins que la situation politique tranche nettement avec
celle des autres dictatures du cône sud du continent latino-américain.
Les
différences sont importantes, décisives, mesurables: plusieurs dizaines de
milliers d'Argentins, d'Uruguayens, de Chiliens, de Paraguayens se sont réfugiés
au Brésil au cours de ces dernières années.
Après la promulgation de l'amnistie,
le régime a remis en cause, en 1980, le système "bipartidaire" instauré en 1965.
Le but avéré de cette manoeuvre était de faire éclater le front démocratique et
populaire qui s'était constitué autour du MDB (Mouvement démocratique
brésilien), seul parti d'opposition toléré.
Les élections de 1974, 1976 et 1978
avaient montré en effet que le système "bipartidaire" transformait les
consultations électorales en un véritable référendum où le régime militaire
était systématiquement désavoué.
Dans la mesure où l'opposition est maintenant divisée en quatre partis
politiques - le PMDB (qui réunit la plupart des élus de l'ancien MDB), le PT
(Parti des travailleurs, rassemblant des syndicalistes et une partie de
l'intelligentsia), le PP (Parti populaire, constitué par des "modérés") et le
PDT (Parti démocratique et travailliste, de l'ancien gouverneur Leonel Brizolla)
-, la tactique du régime semble avoir été partiellement couronnée de succès.
Toutefois, le nouveau parti gouvernemental, le PDS (Parti démocratique et
social), est lui-même paralysé par des rivalités régionales et ne parvient pas à
s'implanter dans le pays.
Le gouvernement ne dispose donc toujours pas d'un
instrument adéquat pour institutionnaliser le régime né du coup d'État de 1964.
Incapable de fait de contrer l'action de l'opposition sur le terrain électoral,
le régime doit avoir recours à des mesures dictatoriales afin d'intimider
l'opinion et d'infléchir le cours des événements.
Périodiquement, la tenue
d'élections en 1982 est remise en question.
En réalité, ce scrutin aura une
importance capitale: pour la première fois depuis 1964, le corps électoral
pourra élire les gouverneurs qui dirigent les différents États de la fédération,
et les quatre partis d'opposition paraissent à même de l'emporter dans onze
États, parmi les plus peuplés et les plus riches du pays (représentant à eux
seuls 80% du produit national brut brésilien).
L'envers du "miracle"
C'est dans le domaine social que les limites de la "libéralisation" apparaissent
clairement.
Les recensements précédents avaient déjà montré l'ampleur des
modifications sociales engendrées par la croissance économique des vingt
dernières années: entre 1960 et 1976, la proportion des travailleurs employés
dans le secteur industriel a pratiquement doublé.
Les grèves, commencées dans la
zone industrielle de São Paulo en 1976, montrent aussi que cette nouvelle classe
ouvrière a débordé les structures corporatives qui coiffent le mouvement
syndical.
Ces mouvements revendicatifs ont atteint leur apogée en mai-juin 1978,
lorsque 1 500 000 ouvriers ont cessé le travail dans les usines de São Paulo.
A
l'occasion d'une nouvelle et importante grève en avril 1980, le gouvernement
intervient brutalement: la grève est déclarée illégale, ses dirigeants sont
jugés et condamnés par un tribunal militaire au nom de la loi de sécurité
nationale.
Cette dernière reste une épée de Damoclès au-dessus de la société
tout entière: presque tous....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓