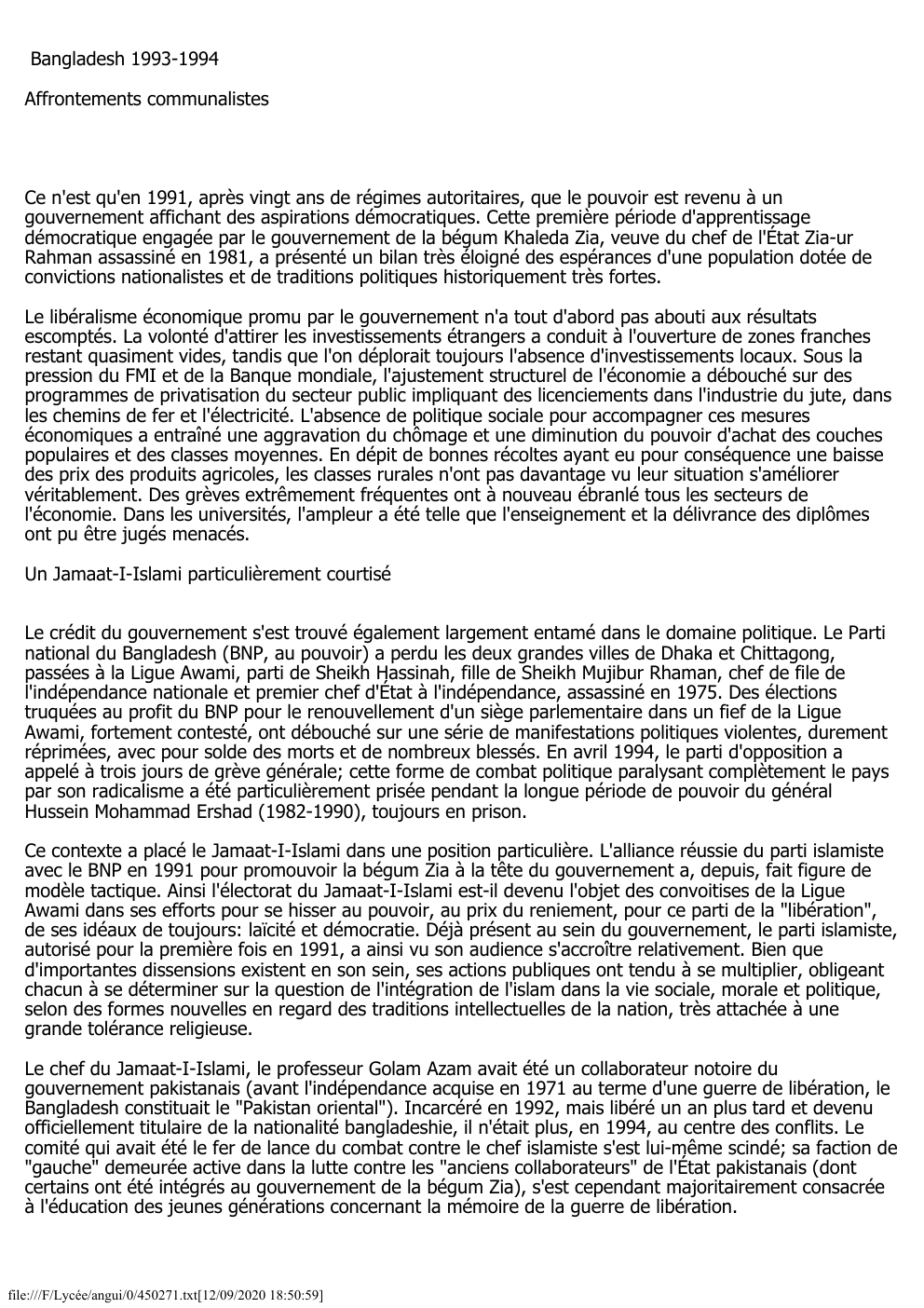Bangladesh 1993-1994 Affrontements communalistes Ce n'est qu'en 1991, après vingt ans de régimes autoritaires, que le pouvoir est revenu à...
Extrait du document
«
Bangladesh 1993-1994
Affrontements communalistes
Ce n'est qu'en 1991, après vingt ans de régimes autoritaires, que le pouvoir est revenu à un
gouvernement affichant des aspirations démocratiques.
Cette première période d'apprentissage
démocratique engagée par le gouvernement de la bégum Khaleda Zia, veuve du chef de l'État Zia-ur
Rahman assassiné en 1981, a présenté un bilan très éloigné des espérances d'une population dotée de
convictions nationalistes et de traditions politiques historiquement très fortes.
Le libéralisme économique promu par le gouvernement n'a tout d'abord pas abouti aux résultats
escomptés.
La volonté d'attirer les investissements étrangers a conduit à l'ouverture de zones franches
restant quasiment vides, tandis que l'on déplorait toujours l'absence d'investissements locaux.
Sous la
pression du FMI et de la Banque mondiale, l'ajustement structurel de l'économie a débouché sur des
programmes de privatisation du secteur public impliquant des licenciements dans l'industrie du jute, dans
les chemins de fer et l'électricité.
L'absence de politique sociale pour accompagner ces mesures
économiques a entraîné une aggravation du chômage et une diminution du pouvoir d'achat des couches
populaires et des classes moyennes.
En dépit de bonnes récoltes ayant eu pour conséquence une baisse
des prix des produits agricoles, les classes rurales n'ont pas davantage vu leur situation s'améliorer
véritablement.
Des grèves extrêmement fréquentes ont à nouveau ébranlé tous les secteurs de
l'économie.
Dans les universités, l'ampleur a été telle que l'enseignement et la délivrance des diplômes
ont pu être jugés menacés.
Un Jamaat-I-Islami particulièrement courtisé
Le crédit du gouvernement s'est trouvé également largement entamé dans le domaine politique.
Le Parti
national du Bangladesh (BNP, au pouvoir) a perdu les deux grandes villes de Dhaka et Chittagong,
passées à la Ligue Awami, parti de Sheikh Hassinah, fille de Sheikh Mujibur Rhaman, chef de file de
l'indépendance nationale et premier chef d'État à l'indépendance, assassiné en 1975.
Des élections
truquées au profit du BNP pour le renouvellement d'un siège parlementaire dans un fief de la Ligue
Awami, fortement contesté, ont débouché sur une série de manifestations politiques violentes, durement
réprimées, avec pour solde des morts et de nombreux blessés.
En avril 1994, le parti d'opposition a
appelé à trois jours de grève générale; cette forme de combat politique paralysant complètement le pays
par son radicalisme a été particulièrement prisée pendant la longue période de pouvoir du général
Hussein Mohammad Ershad (1982-1990), toujours en prison.
Ce contexte a placé le Jamaat-I-Islami dans une position particulière.
L'alliance réussie du parti islamiste
avec le BNP en 1991 pour promouvoir la bégum Zia à la tête du gouvernement a, depuis, fait figure de
modèle tactique.
Ainsi l'électorat du Jamaat-I-Islami est-il devenu l'objet des convoitises de la Ligue
Awami dans ses efforts pour se hisser au pouvoir, au prix du reniement, pour ce parti de la "libération",
de ses idéaux de toujours: laïcité et démocratie.
Déjà présent au sein du gouvernement, le parti islamiste,
autorisé pour la première fois en 1991, a ainsi vu son audience s'accroître relativement.
Bien que
d'importantes dissensions existent en son sein, ses actions publiques ont tendu à se multiplier, obligeant
chacun à se déterminer sur la question de l'intégration de l'islam dans la vie sociale, morale et politique,
selon des formes nouvelles en regard des traditions intellectuelles de la nation, très attachée à une
grande tolérance religieuse.
Le chef du Jamaat-I-Islami, le professeur Golam Azam avait été un collaborateur notoire du
gouvernement pakistanais (avant l'indépendance acquise en 1971 au terme d'une guerre de libération, le
Bangladesh constituait le "Pakistan oriental").
Incarcéré en 1992, mais libéré un an plus tard et devenu
officiellement titulaire de la nationalité bangladeshie, il n'était plus, en 1994, au centre des conflits.
Le
comité qui avait été le fer de lance du combat contre le chef islamiste s'est lui-même scindé; sa faction de
"gauche" demeurée active dans la lutte contre les "anciens collaborateurs" de l'État pakistanais (dont
certains ont été intégrés au gouvernement de la bégum Zia), s'est cependant majoritairement consacrée
à l'éducation des jeunes générations concernant la mémoire de la guerre de libération.
file:///F/Lycée/angui/0/450271.txt[12/09/2020 18:50:59]
Le mouvement islamiste a fait surface sur la scène politique et sociale par des attaques violentes contre
les écoles d'importantes ONG (organisations non gouvernementales) bangladeshies (Grameen Bank,
Brac), employant dans les villages de nombreuses femmes des couches sociales les plus démunies, et
leur offrant des possibilités de crédit et d'éducation.
Une série de fatwa (avis juridiques, ici
condamnations à mort) ont été prononcées contre des femmes travaillant hors du foyer (même à des
tâches domestiques) dans différentes parties du pays, d'autres ont été lapidées ou ont....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓