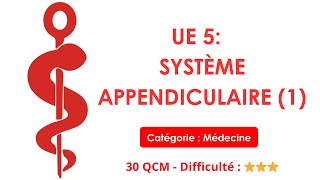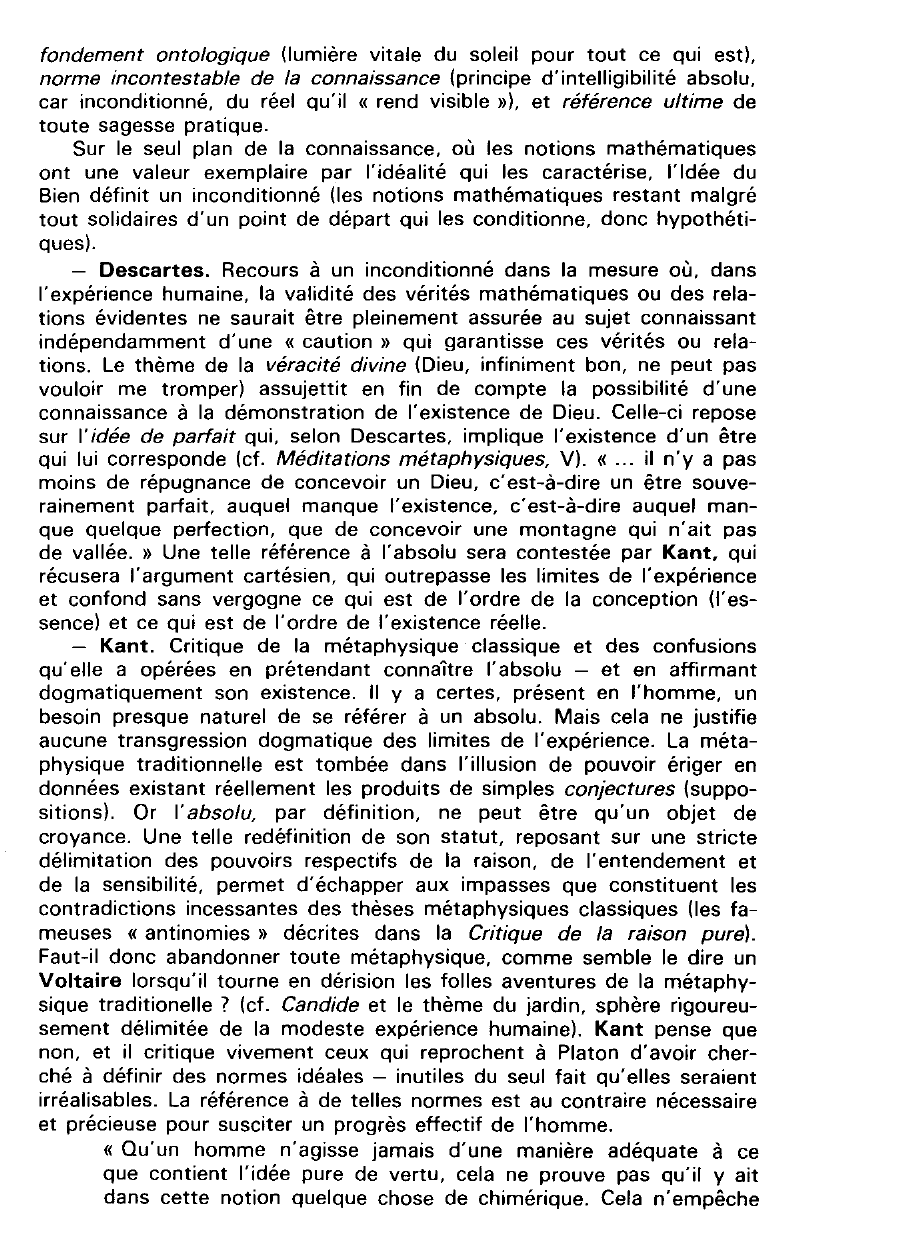APPROCHE DE LA METAPHYSIQUE QUELQUES REMARQUES SUR LA NOTION D'ABSOLU.
Publié le 06/04/2014
Extrait du document
- Descartes. Recours à un inconditionné dans la mesure où. dans
l'expérience humaine, la validité des vérités mathématiques ou des relations
évidentes ne saurait être pleinement assurée au sujet connaissant
indépendamment d'une « caution � qui garantisse ces vérités ou relations.
Le th�me de la véracité divine (Dieu, infiniment bon, ne peut pas
vouloir me tromper) assujettit en fin de compte la possibilité d'une
connaissance à la démonstration de l'existence de Dieu. Celle-ci repose
sur l'idée de parfait qui, selon Descartes. implique l'existence d'un être
qui lui corresponde (cf. Méditations métaphysiques, V). « ... il n'y a pas
moins de répugnance de concevoir un Dieu, c'est-à-dire un être souverainement
parfait, auquel manque l'existence, c'est-à-dire auquel manque
quelque perfection, que de concevoir une montagne qui n'ait pas
de vallée. � Une telle référence à l'absolu sera contestée par Kant, qui
récusera largument cartésien. qui outrepasse les limites de l'expérience
et confond sans vergogne ce qui est de lordre de la conception (I' essence)
et ce qui est de l'ordre de lexistence réelle.
«
fondement ontologique (lumière vitale du soleil pour tout ce qui est), norme incontestable de la connaissance (principe d'intelligibilité absolu, car inconditionné, du réel qu'il « rend visible »), et référence ultime de toute sagesse pratique.
Sur le seul plan de la connaissance, où les notions mathématiques ont une valeur exemplaire par l'idéalité qui les caractérise, l'idée du Bien définit un inconditionné (les notions mathématiques restant malgré tout solidaires d'un point de départ qui les conditionne.
donc hypothéti ques).
-Descartes.
Recours à un inconditionné dans la mesure où.
dans l'expérience humaine, la validité des vérités mathématiques ou des rela tions évidentes ne saurait être pleinement assurée au sujet connaissant indépendamment d'une « caution » qui garantisse ces vérités ou rela tions.
Le thème de la véracité divine (Dieu, infiniment bon, ne peut pas vouloir me tromper) assujettit en fin de compte la possibilité d'une connaissance à la démonstration de l'existence de Dieu.
Celle-ci repose sur l'idée de parfait qui, selon Descartes.
implique l'existence d'un être qui lui corresponde (cf.
Méditations métaphysiques, V).
« ...
il n'y a pas moins de répugnance de concevoir un Dieu, c'est-à-dire un être souve rainement parfait, auquel manque l'existence, c'est-à-dire auquel man que quelque perfection, que de concevoir une montagne qui n'ait pas de vallée.
» Une telle référence à l'absolu sera contestée par Kant, qui récusera largument cartésien.
qui outrepasse les limites de l'expérience et confond sans vergogne ce qui est de lordre de la conception (I' es sence) et ce qui est de l'ordre de lexistence réelle.
- Kant.
Critique de la métaphysique classique et des confusions qu'elle a opérées en prétendant connaître labsolu -et en affirmant dogmatiquement son existence.
Il y a certes, présent en l'homme, un besoin presque naturel de se référer à un absolu.
Mais cela ne justifie aucune transgression dogmatique des limites de lexpérience.
La méta physique traditionnelle est tombée dans l'illusion de pouvoir ériger en données existant réellement les produits de simples conjectures (suppo sitions).
Or l'absolu, par définition, ne peut être qu'un objet de croyance.
Une telle redéfinition de son statut, reposant sur une stricte délimitation des pouvoirs respectifs de la raison, de l'entendement et de la sensibilité, permet d'échapper aux impasses que constituent les contradictions incessantes des thèses métaphysiques classiques (les fa meuses « antinomies » décrites dans la Critique de la raison pure).
Faut-il donc abandonner toute métaphysique, comme semble le dire un Voltaire lorsqu'il tourne en dérision les folles aventures de la métaphy sique traditionelle ? (cf.
Candide et le thème du jardin, sphère rigoureu sement délimitée de la modeste expérience humaine).
Kant pense que non, et il critique vivement ceux qui reprochent à Platon d'avoir cher ché à définir des normes idéales - inutiles du seul fait qu'elles seraient irréalisables.
La référence à de telles normes est au contraire nécessaire et précieuse pour susciter un progrès effectif de l'homme.
«Qu'un homme n'agisse jamais d'une manière adéquate à ce que contient l'idée pure de vertu, cela ne prouve pas qu'il y ait dans cette notion quelque chose de chimérique.
Cela n'empêche
120.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La notion de temps absolu a-t-elle un sens ?
- Pensez-vous, avec Jean Brun (Entretiens de Cerisy-la-Salle sur le surréalisme en juillet 1966, Mouton), que le surréalisme se soit méfié du merveilleux moderne et machiniste : «(Le surréalisme) s'est toujours refusé de se laisser prendre aux prestiges de la machine ; car le surréalisme a toujours dénoncé les prophétismes machinistes, il a sans cesse introduit dans le fonctionnement ou dans la structure de la machine - qu'il me suffise de rappeler l'oeuvre de Marcel Duchamp - une notion
- les inégalités sont elles compatibles avec la notion de justice sociale?
- Une approche géocritique de la ville africaine
- L'approche en termes de classes sociales demeure t-elle pertinente pour rendre compte de la structure sociale et de la société française actuelle ?