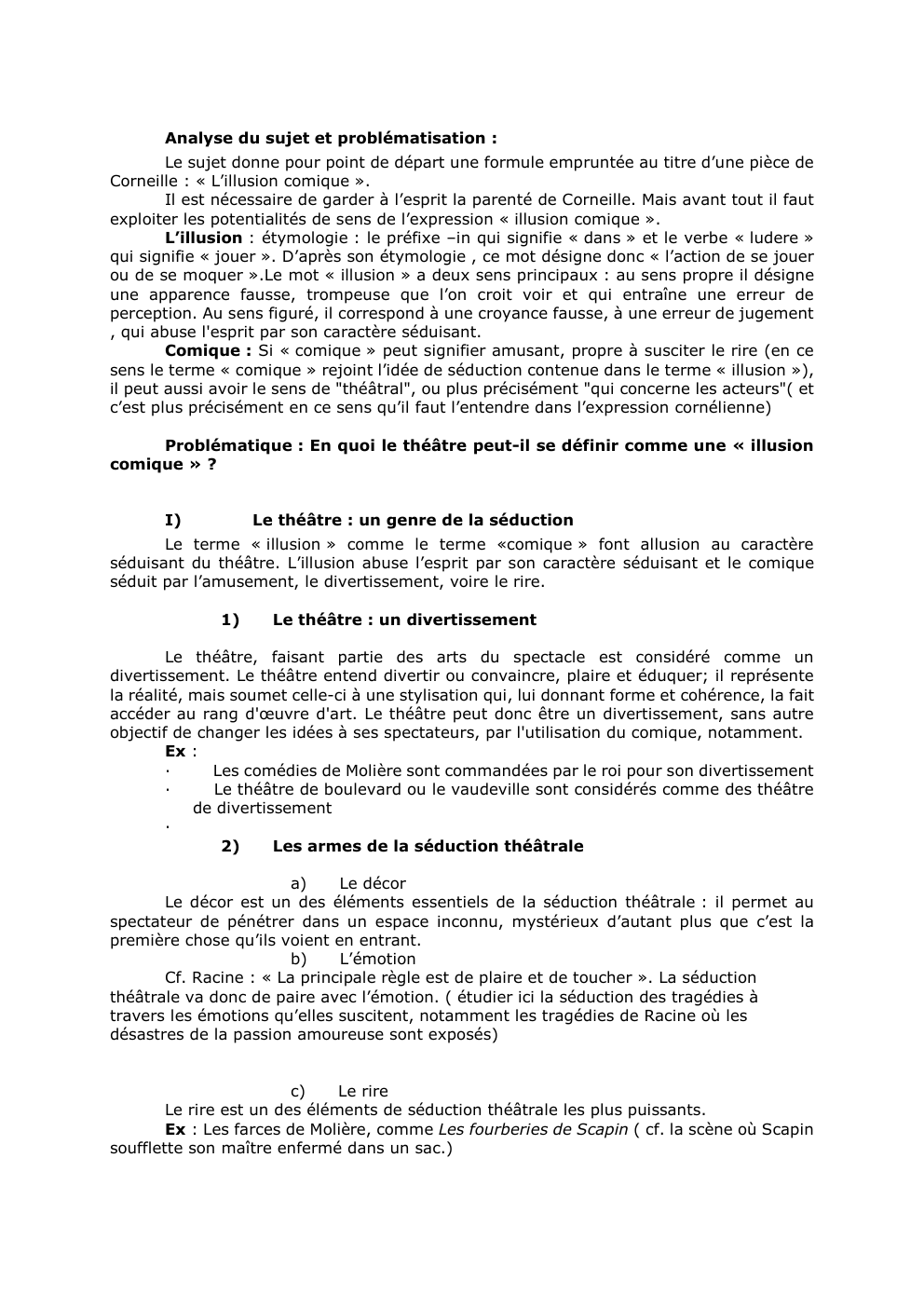Analyse du sujet et problématisation : Le sujet donne pour point de départ une formule empruntée au titre d’une pièce...
Extrait du document
«
Analyse du sujet et problématisation :
Le sujet donne pour point de départ une formule empruntée au titre d’une pièce de
Corneille : « L’illusion comique ».
Il est nécessaire de garder à l’esprit la parenté de Corneille.
Mais avant tout il faut
exploiter les potentialités de sens de l’expression « illusion comique ».
L’illusion : étymologie : le préfixe –in qui signifie « dans » et le verbe « ludere »
qui signifie « jouer ».
D’après son étymologie , ce mot désigne donc « l’action de se jouer
ou de se moquer ».Le mot « illusion » a deux sens principaux : au sens propre il désigne
une apparence fausse, trompeuse que l’on croit voir et qui entraîne une erreur de
perception.
Au sens figuré, il correspond à une croyance fausse, à une erreur de jugement
, qui abuse l'esprit par son caractère séduisant.
Comique : Si « comique » peut signifier amusant, propre à susciter le rire (en ce
sens le terme « comique » rejoint l’idée de séduction contenue dans le terme « illusion »),
il peut aussi avoir le sens de "théâtral", ou plus précisément "qui concerne les acteurs"( et
c’est plus précisément en ce sens qu’il faut l’entendre dans l’expression cornélienne)
Problématique : En quoi le théâtre peut-il se définir comme une « illusion
comique » ?
I)
Le théâtre : un genre de la séduction
Le terme « illusion » comme le terme «comique » font allusion au caractère
séduisant du théâtre.
L’illusion abuse l’esprit par son caractère séduisant et le comique
séduit par l’amusement, le divertissement, voire le rire.
1)
Le théâtre : un divertissement
Le théâtre, faisant partie des arts du spectacle est considéré comme un
divertissement.
Le théâtre entend divertir ou convaincre, plaire et éduquer; il représente
la réalité, mais soumet celle-ci à une stylisation qui, lui donnant forme et cohérence, la fait
accéder au rang d'œuvre d'art.
Le théâtre peut donc être un divertissement, sans autre
objectif de changer les idées à ses spectateurs, par l'utilisation du comique, notamment.
Ex :
·
Les comédies de Molière sont commandées par le roi pour son divertissement
·
Le théâtre de boulevard ou le vaudeville sont considérés comme des théâtre
de divertissement
·
2)
Les armes de la séduction théâtrale
a)
Le décor
Le décor est un des éléments essentiels de la séduction théâtrale : il permet au
spectateur de pénétrer dans un espace inconnu, mystérieux d’autant plus que c’est la
première chose qu’ils voient en entrant.
b)
L’émotion
Cf.
Racine : « La principale règle est de plaire et de toucher ».
La séduction
théâtrale va donc de paire avec l’émotion.
( étudier ici la séduction des tragédies à
travers les émotions qu’elles suscitent, notamment les tragédies de Racine où les
désastres de la passion amoureuse sont exposés)
c)
Le rire
Le rire est un des éléments de séduction théâtrale les plus puissants.
Ex : Les farces de Molière, comme Les fourberies de Scapin ( cf.
la scène où Scapin
soufflette son maître enfermé dans un sac.)
Transition : évoquer les dangers de cette séduction à une identification trop forte
et trompeuse.
II)
Le théâtre : le lieu du règne de l’apparence factice
Illusion comique signifie aussi illusion théâtrale : le théâtre ne présente qu’une
illusion, qu’une apparence trompeuse : il ne doit pas être confondu avec la réalité, ce que
certains dramaturges s’attachent à montrer dans leur pièce en radicalisant l’apparence.
Quels sont les moyens de cette radicalisation de l’apparence et de la présentation de
l’illusion scénique comme telle ?
1)
Le règne des conventions empêche toute confusion du théâtre
avec le réel
L’illusion de la réalité n’est qu’un mythe fondé sur une convention.
Le théâtre
repose sur tout un système de conventions.
Le spectateur sait bien qu’il ne se
passe rien de réel sur la scène.
Mais il feint de croire que le spectacle auquel il
assiste est vrai.
( cf.
Les réflexions de Marthe et de l’actrice Lechy dans l’Echange
de Claudel:
Lechy : Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c’était vrai.
Marthe : Mais puisque ce n’est pas vrai ! c’est comme les rêves que l’on fait quand
on dort.
Lechy : c’est ainsi qu’ils viennent au théâtre la nuit.)
Mais les règles qui régissent le théâtre montre toute sa fausseté ( cf.
la règle des
trois unités chez les classiques, la restriction imposée par l’espace scénique, la
coupure entre scène et salle).
Ce mythe de l’illusion et cette convention ( qui fait
que l’on doit faire semblant d’ »y croire ») mêmes, tendent à être abolis au théâtre :
les dramaturges du XXe siècle luttent pour la radicalisation de l’apparence : cf.
Brecht qui, dans son théâtre, voulait rompre avec l'illusion théâtrale et pousser le
spectateur à la réflexion.
Ses pièces sont donc ouvertement didactiques : par
l'usage de panneaux avec des maximes, des apartés en direction du public pour
commenter la pièce, des intermèdes chantés, etc.
il force le spectateur à avoir un
regard critique.( cf.
processus de la « distanciation »)
2)
La mise en abyme
La mise en abyme au théâtre dénonce souvent l’illusion scénique en la présentant
telle qu’elle est, comme un simulâcre.
Lorsqu’elle est mise en abyme de l’énonciation
théâtrale, elle agit comme un révélateur pour le public, en lui montrant que tout ce qu’il
voit sur scène n’est....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓