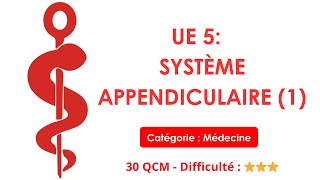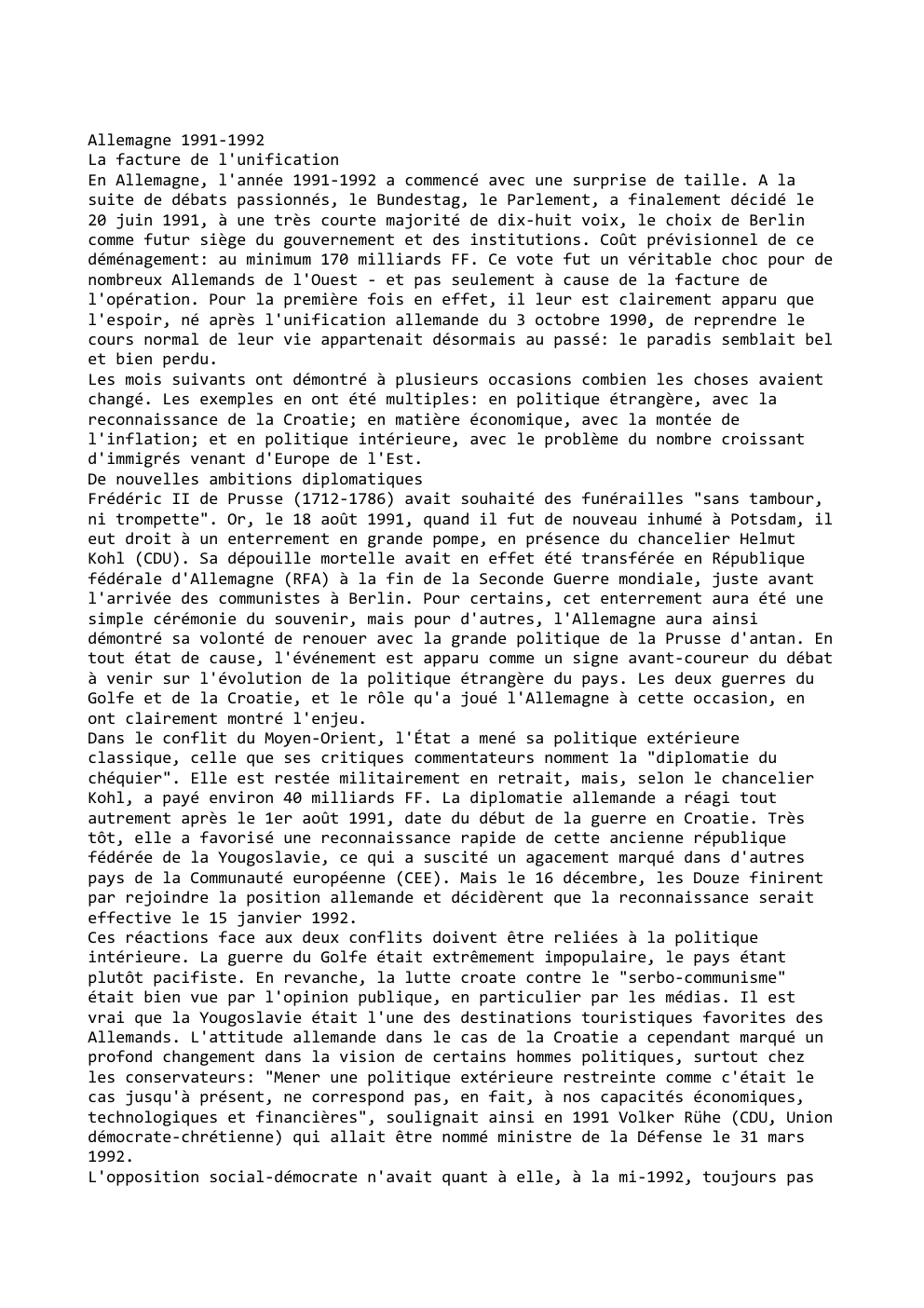Allemagne 1991-1992 La facture de l'unification En Allemagne, l'année 1991-1992 a commencé avec une surprise de taille. A la suite...
Extrait du document
«
Allemagne 1991-1992
La facture de l'unification
En Allemagne, l'année 1991-1992 a commencé avec une surprise de taille.
A la
suite de débats passionnés, le Bundestag, le Parlement, a finalement décidé le
20 juin 1991, à une très courte majorité de dix-huit voix, le choix de Berlin
comme futur siège du gouvernement et des institutions.
Coût prévisionnel de ce
déménagement: au minimum 170 milliards FF.
Ce vote fut un véritable choc pour de
nombreux Allemands de l'Ouest - et pas seulement à cause de la facture de
l'opération.
Pour la première fois en effet, il leur est clairement apparu que
l'espoir, né après l'unification allemande du 3 octobre 1990, de reprendre le
cours normal de leur vie appartenait désormais au passé: le paradis semblait bel
et bien perdu.
Les mois suivants ont démontré à plusieurs occasions combien les choses avaient
changé.
Les exemples en ont été multiples: en politique étrangère, avec la
reconnaissance de la Croatie; en matière économique, avec la montée de
l'inflation; et en politique intérieure, avec le problème du nombre croissant
d'immigrés venant d'Europe de l'Est.
De nouvelles ambitions diplomatiques
Frédéric II de Prusse (1712-1786) avait souhaité des funérailles "sans tambour,
ni trompette".
Or, le 18 août 1991, quand il fut de nouveau inhumé à Potsdam, il
eut droit à un enterrement en grande pompe, en présence du chancelier Helmut
Kohl (CDU).
Sa dépouille mortelle avait en effet été transférée en République
fédérale d'Allemagne (RFA) à la fin de la Seconde Guerre mondiale, juste avant
l'arrivée des communistes à Berlin.
Pour certains, cet enterrement aura été une
simple cérémonie du souvenir, mais pour d'autres, l'Allemagne aura ainsi
démontré sa volonté de renouer avec la grande politique de la Prusse d'antan.
En
tout état de cause, l'événement est apparu comme un signe avant-coureur du débat
à venir sur l'évolution de la politique étrangère du pays.
Les deux guerres du
Golfe et de la Croatie, et le rôle qu'a joué l'Allemagne à cette occasion, en
ont clairement montré l'enjeu.
Dans le conflit du Moyen-Orient, l'État a mené sa politique extérieure
classique, celle que ses critiques commentateurs nomment la "diplomatie du
chéquier".
Elle est restée militairement en retrait, mais, selon le chancelier
Kohl, a payé environ 40 milliards FF.
La diplomatie allemande a réagi tout
autrement après le 1er août 1991, date du début de la guerre en Croatie.
Très
tôt, elle a favorisé une reconnaissance rapide de cette ancienne république
fédérée de la Yougoslavie, ce qui a suscité un agacement marqué dans d'autres
pays de la Communauté européenne (CEE).
Mais le 16 décembre, les Douze finirent
par rejoindre la position allemande et décidèrent que la reconnaissance serait
effective le 15 janvier 1992.
Ces réactions face aux deux conflits doivent être reliées à la politique
intérieure.
La guerre du Golfe était extrêmement impopulaire, le pays étant
plutôt pacifiste.
En revanche, la lutte croate contre le "serbo-communisme"
était bien vue par l'opinion publique, en particulier par les médias.
Il est
vrai que la Yougoslavie était l'une des destinations touristiques favorites des
Allemands.
L'attitude allemande dans le cas de la Croatie a cependant marqué un
profond changement dans la vision de certains hommes politiques, surtout chez
les conservateurs: "Mener une politique extérieure restreinte comme c'était le
cas jusqu'à présent, ne correspond pas, en fait, à nos capacités économiques,
technologiques et financières", soulignait ainsi en 1991 Volker Rühe (CDU, Union
démocrate-chrétienne) qui allait être nommé ministre de la Défense le 31 mars
1992.
L'opposition social-démocrate n'avait quant à elle, à la mi-1992, toujours pas
défini sa propre approche de la politique étrangère depuis l'effondrement du
communisme.
Sa réflexion n'en apparaissait qu'à ses débuts.
Certains
responsables sociaux-démocrates ont ainsi estimé qu'il était temps de mener une
politique étrangère "qui essaie de vivre dans la vérité".
L'année 1992 aura donné un exemple de ce que pourrait être une politique
extérieure "moralisée".
A cause des violations des droits de l'homme en Turquie
dans la répression contre les séparatistes kurdes, le Parlement allemand a gelé
la livraison d'armes à Ankara.
Et parce que ses collaborateurs avaient passé
outre ces consignes, le ministre de la Défense, Gerhard Stoltenberg (CDU), a dû
démissionner le 31 mars 1992.
Pourtant, si la politique étrangère de Bonn évolue
de façon significative, elle le fera sans sa figure de proue.
En effet, le 27
avril 1992, et contre toute attente, Hans Dietrich Genscher (FDP, Parti libéral)
a démissionné après avoir été ministre des Affaires étrangères pendant dix-huit
années consécutives.
Succéder à un homme aussi prestigieux sur la scène internationale que H.
D.
Genscher ne représentait pas l'unique handicap du nouveau ministre des Affaires
étrangères, Klaus Kinkel (FDP).
Nommé pour le remplacer après d'âpres
discussions au sein de son parti, il devait se préparer à assumer de lourds
dossiers tels que la revendication allemande visant à obtenir le statut de
membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU,
l'engagement éventuel de la Bundeswehr en dehors de la zone de l'OTAN
(Organisation du traité de l'Atlantique nord) ou la constitution du corps
d'armée franco-allemand.
Hausse de l'inflation et des taux d'intérêt
En 1991, on n'a pas seulement enterré Frédéric II mais également l'une des
règles fondamentales de la politique monétaire, qui reposait sur le fait que le
mark est une monnaie plus forte que le franc français.
Or, pour la première fois
depuis presque vingt ans, les prix ont augmenté en RFA beaucoup plus vite qu'en
France: 4,8% contre 3,2% entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 1992.
Le
renversement de cet écart entre les deux pays aura été un signe significatif.
A
la mi-1992, la politique économique allemande n'avait en effet pas encore trouvé
de réponse cohérente face aux conséquences de l'unification.
Malgré
l'augmentation des impôts le 1er juillet 1991, les retrouvailles
inter-allemandes sont restées principalement financées par l'endettement.
De
plus, les revendications salariales des syndicats n'ont pu qu'aviver le
problème.
L'opposition social-démocrate a réclamé, à juste titre, un "changement de cap"
dans la politique budgétaire.
En 1991, les administrations publiques ont dû
emprunter quelque 340 milliards FF, soit 3,7% du produit national brut (PNB),
notamment pour financer les transferts (programmes d'investissement, mesures de
créations d'emploi, par exemple) dans les cinq nouveaux Länder (environ 600
milliards FF en 1991).
La dette publique totale devait, selon certaines
estimations, s'élever à 4 500 milliards FF à la fin 1992, soit presque la moitié
du PNB.
De son côté, le gouvernement a dénoncé les revendications salariales,
qu'il a jugées trop élevées.
La quasi-totalité des syndicats demandait des
augmentations d'environ 10% et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓