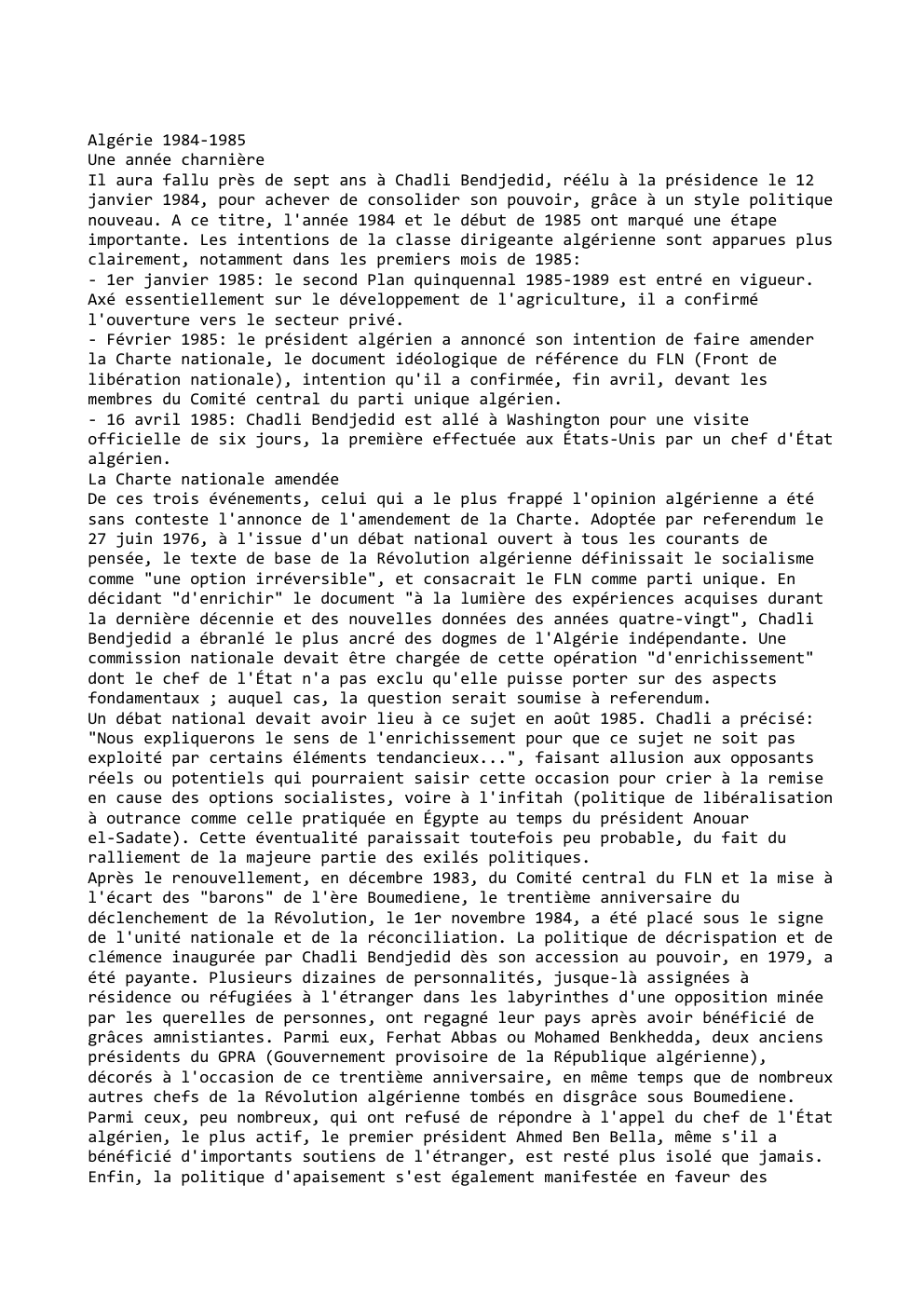Algérie 1984-1985 Une année charnière Il aura fallu près de sept ans à Chadli Bendjedid, réélu à la présidence le...
Extrait du document
«
Algérie 1984-1985
Une année charnière
Il aura fallu près de sept ans à Chadli Bendjedid, réélu à la présidence le 12
janvier 1984, pour achever de consolider son pouvoir, grâce à un style politique
nouveau.
A ce titre, l'année 1984 et le début de 1985 ont marqué une étape
importante.
Les intentions de la classe dirigeante algérienne sont apparues plus
clairement, notamment dans les premiers mois de 1985:
- 1er janvier 1985: le second Plan quinquennal 1985-1989 est entré en vigueur.
Axé essentiellement sur le développement de l'agriculture, il a confirmé
l'ouverture vers le secteur privé.
- Février 1985: le président algérien a annoncé son intention de faire amender
la Charte nationale, le document idéologique de référence du FLN (Front de
libération nationale), intention qu'il a confirmée, fin avril, devant les
membres du Comité central du parti unique algérien.
- 16 avril 1985: Chadli Bendjedid est allé à Washington pour une visite
officielle de six jours, la première effectuée aux États-Unis par un chef d'État
algérien.
La Charte nationale amendée
De ces trois événements, celui qui a le plus frappé l'opinion algérienne a été
sans conteste l'annonce de l'amendement de la Charte.
Adoptée par referendum le
27 juin 1976, à l'issue d'un débat national ouvert à tous les courants de
pensée, le texte de base de la Révolution algérienne définissait le socialisme
comme "une option irréversible", et consacrait le FLN comme parti unique.
En
décidant "d'enrichir" le document "à la lumière des expériences acquises durant
la dernière décennie et des nouvelles données des années quatre-vingt", Chadli
Bendjedid a ébranlé le plus ancré des dogmes de l'Algérie indépendante.
Une
commission nationale devait être chargée de cette opération "d'enrichissement"
dont le chef de l'État n'a pas exclu qu'elle puisse porter sur des aspects
fondamentaux ; auquel cas, la question serait soumise à referendum.
Un débat national devait avoir lieu à ce sujet en août 1985.
Chadli a précisé:
"Nous expliquerons le sens de l'enrichissement pour que ce sujet ne soit pas
exploité par certains éléments tendancieux...", faisant allusion aux opposants
réels ou potentiels qui pourraient saisir cette occasion pour crier à la remise
en cause des options socialistes, voire à l'infitah (politique de libéralisation
à outrance comme celle pratiquée en Égypte au temps du président Anouar
el-Sadate).
Cette éventualité paraissait toutefois peu probable, du fait du
ralliement de la majeure partie des exilés politiques.
Après le renouvellement, en décembre 1983, du Comité central du FLN et la mise à
l'écart des "barons" de l'ère Boumediene, le trentième anniversaire du
déclenchement de la Révolution, le 1er novembre 1984, a été placé sous le signe
de l'unité nationale et de la réconciliation.
La politique de décrispation et de
clémence inaugurée par Chadli Bendjedid dès son accession au pouvoir, en 1979, a
été payante.
Plusieurs dizaines de personnalités, jusque-là assignées à
résidence ou réfugiées à l'étranger dans les labyrinthes d'une opposition minée
par les querelles de personnes, ont regagné leur pays après avoir bénéficié de
grâces amnistiantes.
Parmi eux, Ferhat Abbas ou Mohamed Benkhedda, deux anciens
présidents du GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne),
décorés à l'occasion de ce trentième anniversaire, en même temps que de nombreux
autres chefs de la Révolution algérienne tombés en disgrâce sous Boumediene.
Parmi ceux, peu nombreux, qui ont refusé de répondre à l'appel du chef de l'État
algérien, le plus actif, le premier président Ahmed Ben Bella, même s'il a
bénéficié d'importants soutiens de l'étranger, est resté plus isolé que jamais.
Enfin, la politique d'apaisement s'est également manifestée en faveur des
milieux intégristes dont les troupes de choc ont eu droit, en avril 1985, à un
verdict remarquablement modéré, tout comme les militants berbéristes dont sept
ont été relaxés lors du procès de février 1985.
Cependant, derrière la réconciliation politique et la stratégie de l'apaisement,
un nouvel espace d'affrontement s'est profilé dans les déchirures du tissu
social: les émeutes d'avril 1985 dans la Casbah d'Alger ont illustré assez bien
le malaise grandissant qui s'est emparé des couches citadines les plus
défavorisées.
Au-delà des crises de croissance qui frappent les grandes cités
algériennes, et des effets multiples d'une politique de développement accéléré,
le mécontentement résulte des profondes inégalités sociales.
Certes, les statistiques 1985 de la Banque mondiale révélaient un PNB par
habitant de 2 350 dollars en 1982, plaçant l'Algérie au troisième rang des pays
d'Afrique ; selon les statistiques officielles algériennes, le revenu annuel
moyen par habitant est passé de 3 596 dinars (5 980 francs) en 1979, à 5 493
dinars (9 155 francs) en 1984.
Pourtant, ces chiffres n'effacent pas la dure
réalité d'un taux de chômage officiellement évalué à 16,9%
pour 1984, qui a frappé de plein fouet les citadins (45% de la population).
Le
sous-emploi, la poussée démographique, l'habitat et l'insuffisance de production
agricole ont atteint la cote d'alerte.
Et, lorsque le Premier ministre
Abdelhamid Brahimi s'est félicité, dans une interview à Ech Chaab, en avril
1985, de ce que la production industrielle avait augmenté de 17% entre 1980 et
1984, au même moment, l'organe du FLN, Révolution africaine, publiait un dossier
explosif sur l'inflation (6,5% en 1984) qui soulignait les "inégalités criantes"
du système en s'appuyant sur une enquête de l'Office national des statistiques
menée en 1980.
Ce dossier dénonçait le goût de luxe des couches aisées de la
population et faisait remarquer que ce sont "les jeunes de 25 à 35 ans (60% de
la population) qui pâtissent le plus de la situation en voyant leurs
perspectives d'avenir bouchées".
Priorité à l'agriculture
Le risque de débordement de la génération d'après-guerre n'a en effet jamais été
aussi présent qu'en 1985.
Les dirigeants se sont engagés dans une véritable
course contre la montre destinée à préparer "l'après-pétrole".
Le renversement
des priorités économiques au profit de l'agriculture et des secteurs sociaux,
amorcé avec le premier Plan 1980-1984, s'est accéléré avec le second Plan
1985-1989: 550 milliards de dinars (900 milliards de francs) d'enveloppe
globale, soit 150 milliards....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓