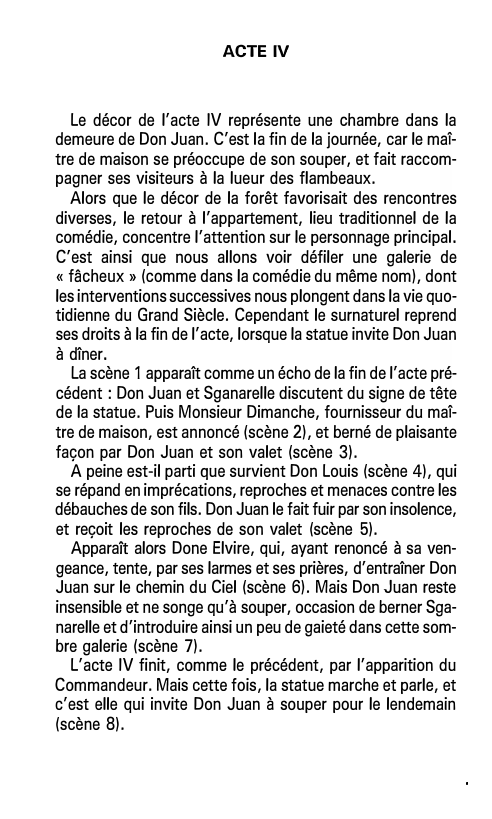ACTE IV Le décor de l'acte IV représente une chambre dans la demeure de Don Juan. C'est la fin de...
Extrait du document
«
ACTE IV
Le décor de l'acte IV représente une chambre dans la
demeure de Don Juan.
C'est la fin de la journée, car le maî
tre de maison se préoccupe de son souper, et fait raccom
pagner ses visiteurs à la lueur des flambeaux.
Alors que le décor de la forêt favorisait des rencontres
diverses, le retour à l'appartement, lieu traditionnel de la
comédie, concentre l'attention sur le personnage principal.
C'est ainsi que nous allons voir défiler une galerie de
« fâcheux » (comme dans la comédie du même nom), dont
les interventions successives nous plongent dans la vie quo
tidienne du Grand Siècle.
Cependant le surnaturel reprend
ses droits à la fin de l'acte, lorsque la statue invite Don Juan
à dîner.
La scène 1 apparaît comme un écho de la fin de l'acte pré
cédent : Don Juan et Sganarelle discutent du signe de tête
de la statue.
Puis Monsieur Dimanche, fournisseur du maî
tre de maison, est annoncé (scène 2), et berné de plaisante
façon par Don Juan et son valet (scène 3).
A peine est-il parti que survient Don Louis (scène 4), qui
se répand en imprécations, reproches et menaces contre les
débauches de son fils.
Don Juan le fait fuir par son insolence,
et reçoit les reproches de son valet (scène 5).
Apparaît alors Done Elvire, qui, ayant renoncé à sa ven
geance, tente, par ses larmes et ses prières, d'entraîner Don
Juan sur le chemin du Ciel (scène 6).
Mais Don Juan reste
insensible et ne songe qu'à souper, occasion de berner Sga
narelle et d'introduire ainsi un peu de gaieté dans cette som
bre galerie (scène 7).
L'acte IV finit, comme le précédent, par l'apparition du
Commandeur.
Mais cette fois, la statue marche et parle, et
c'est elle qui invite Don Juan à souper pour le lendemain
(scène 8).
ACTE IV, SCÈNE 1
(DON JUAN, SGANARELLE)
Si cette scène sert de transition, elle n'en est pas moins
essentielle.
Nous assistons à la fin d'une discussion entre
maître et valet sur la nature de l'apparition.
Don Juan cher
che une explication rationnelle : il peut s'agir d'un « faux
jour» ou d'une« vapeur » qui leur aura troublé la vue.
Sga
narelle, au contraire, est affirmatif : c'est le Ciel, scandalisé
par la vie de son maître, qui a « produit ce miracle» pour
le convaincre (de l'existence de Dieu ?) et l'éloigner (du
vice ?) •..
Sganarelle insiste : Don Juan ne doit point nier ce
qu'ils ont vu, le signe de tête n'est pas une illusion ! A ces
objurgations, Don Juan répond par des menaces brutales :
mille coups de nerf de bœuf sauront bien dissuader son valet
de l'importuner davantage sur ces questions.
Là-dessus, il
commande à dîner « le plus tôt que l'on pourra».
IBIJ?ti�,14�1t·1hJ=i
Don Juan ébranlé
La scène 1 s'ouvre au milieu d'une discussion, conformément à un
usage théâtral répandu au XVII• siècle (cf.
1, 1 ; Il, 1 ).
Secrètement
ébranlé par le signe de tête du Commandeur, Don Juan persiste à nier
ce que sa raison ne comprend pas.
Face à Sganarelle, prompt à voir
partout l'intervention du Ciel, il défend une conception résolument maté
rialiste et rationaliste du monde, et cherche une explication naturelle
au prodige qu'il vient de voir.
Mais son exaspération face aux « ser
mons» et aux« sottes moralités» de Sganarelle n'en traduit pas moins
son ébranlement intérieur, tout autant, d'ailleurs, que son incapacité
à se remettre en question.
En effet, cette attitude de refus systémati
que du surnaturel sera une constante de la fin de la pièce, jusqu'à
l'engloutissement final.
Poésie et coups de bâton
Le style des répliques de cette courte scène est remarquablement
varié.
Les expressions de Don Juan, « trompés par un faux jour, ou
surpris de quelque vapeur», évoquent l'aspect nocturne de l'imagi
naire, tel qu'il se manifeste, par exemple, dans la scène du spectre
au début d' Hamletde Shakespeare.
Or Don Juan est un héros solaire,
comme l'indiquent son habit doré et sa blondeur, pour qui ne comp
tent que les lumières de la raison et du plaisir.
Mais son agnosticisme
bute sur ce qu'il ne comprend pas.
et sa brutalité à l'égard de Sgana
relle est révélatrice du désarroi d'un homme qui ne maîtrise plus un
monde vacillant.
Sganarelle, qui connaît son Don Juan sur le bout du doigt, est passé
maître dans l'art de l'apaiser à force d'humour et de fausse humilité.
Mais il sait bien que c'est lui qui a raison, et que les coups de bâton
n'y peuvent rien.
L'aspect farcesque de cette fin de scène éloigne la
menace qui pèse sur Don Juan, et adoucit ce que l'inexplicable a
d'inquiétant.
La scène se termine sur un détail matériel essentiel : Don Juan sou
haite souper« le plus tôt que l'on pourra».
Mais le souper n'aura lieu
qu'à la scène 7.
ACTE IV, SCÈNES 2 ET 3
(DON JUAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE, PUIS M.
DIMANCHE)
l;J:f.iH,'11=1
La Violette annonce la venue d'un marchand, Monsieur
Dimanche, qui insiste pour parler à Don Juan.
Sganarelle
devine l'un de ses créanciers venu réclamer son dû.
Don-Juan
explique alors sa « politique » : Il a le « secret de les ren
voyer satisfaits sans leur donner » un sou ! Qu'on introduise
Monsieur Dimanche !
Don Juan l'accueille bruyamment : quelle joie de le voir !
L'ordre qu'il a donné de ne pas être dérangé n'est pas pour
lui ; ses laquais sont des « coquins » de ne pas distinguer
le « meilleur de [ses] amis ! » Monsieur Dimanche ne peut
que s'excuser, remercier.
Il tente timidement d'exposer
l'objet de sa visite, Don Juan l'interrompt, réclame à grands
cris un siège pour son visiteur, non point un pliant, mais un
fauteuil comme il le ferait pour une personne de qualité, veut
le faire asseoir« contre [lui] », insiste.
Monsieur Dimanche
élude(« cela n'est point nécessaire»), s'étonne(« Monsieur,
vous vous moquez ...
»), finit par accepter.
Don Juan
s'inquiète alors de sa santé.
Son hôte a un teint admirable !
Mais comment vont sa femme, sa fille, son fils, son chien?
Qu'il soit assuré de l'amitié qu'il lui porte.
Monsieur Diman
che veut-il souper avec lui? Non, il doit s'en retourner tout
de suite.
Eh bien, vite, qu'on apporte un flambeau et que
quatre ou cinq de ses gens l'escortent.
Don Juan se lève,
accable Monsieur Dimanche de compliments : « il est [son]
serviteur et de plus [son] débiteur».
Monsieur Dimanche
pousse une exclamation : va-t-il enfin pouvoir réclamer son
dû ? Mais Don Juan ne lui en laisse pas le temps, lui offre
de le reconduire.
Monsieur Dimanche est confus, proteste.
Don Juan, en dernier témoignage d'amitié, lui donne I'acco
lade...
et sort.
Monsieur Dimanche reste seul avec Sganarelle, qui, à l'imi
tation de son maître, continue sur le même ton.
Mais cette
fois, Monsieur Dimanche l'interrompt.
Il avoue que tant de
politesse l'empêche de réclamer son argent.
Si Sganarelle
pouvait intercéder en sa faveur? Lui aussi, d'ailleurs, lui doit
de l'argent, s'en souvient-il? Mais Sganarelle, reprenant la
tactique de son maître, avec moins d'habileté toutefois,
l'empêche de poursuivre, le prend par le bras, le pousse cava
lièrement dehors.
IB•JWl�d=i�it·1l;J=i
La satire des mœurs
Le grand seigneur mauvais payeur est un personnage fréquent sous
l'Ancien Régime.
L'aisance de Don Juan et la timidité de Monsieur
Dimanche reflètent la différence des conditions entre les deux per
sonnages.
Littéralement subjugué par le grand seigneur qu'est Don
Juan, le tailleur n'ose s'imposer et réclamer son dû.
C'est sur cet écart
des conditions que va jouer Don Juan pour éconduire son créancier
tout en le flattant par l'intérêt qu'il feint de lui porter.
Prestige d'une
noblesse décadente et financièrement dépendante d'un côté, sottise
d'une bourgeoisie fascinée par l'éclat d'une classe qu'elle essaye d'imi
ter,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓