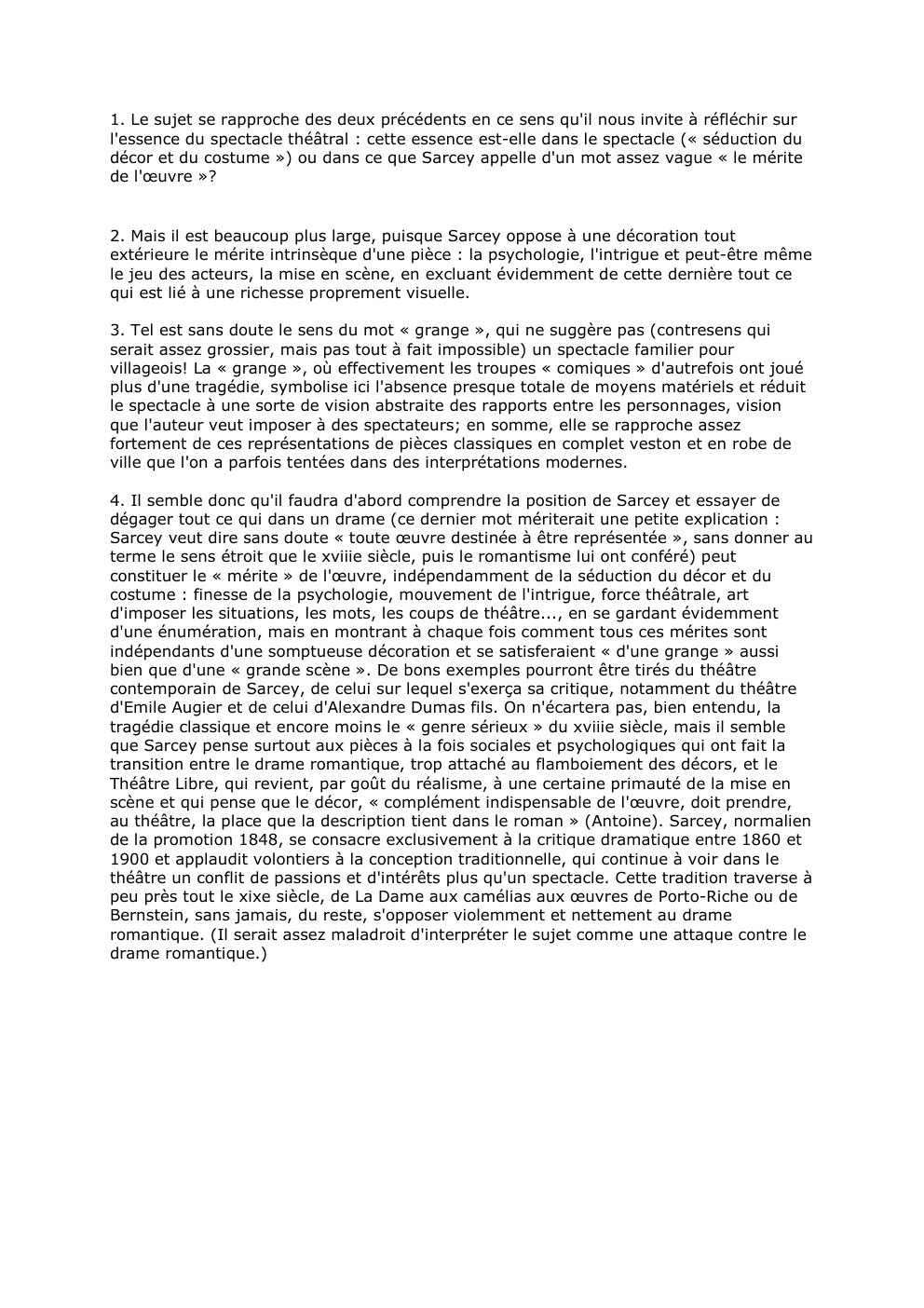1. Le sujet se rapproche des deux précédents en ce sens qu'il nous invite à réfléchir sur l'essence du spectacle...
Extrait du document
«
1.
Le sujet se rapproche des deux précédents en ce sens qu'il nous invite à réfléchir sur
l'essence du spectacle théâtral : cette essence est-elle dans le spectacle (« séduction du
décor et du costume ») ou dans ce que Sarcey appelle d'un mot assez vague « le mérite
de l'œuvre »?
2.
Mais il est beaucoup plus large, puisque Sarcey oppose à une décoration tout
extérieure le mérite intrinsèque d'une pièce : la psychologie, l'intrigue et peut-être même
le jeu des acteurs, la mise en scène, en excluant évidemment de cette dernière tout ce
qui est lié à une richesse proprement visuelle.
3.
Tel est sans doute le sens du mot « grange », qui ne suggère pas (contresens qui
serait assez grossier, mais pas tout à fait impossible) un spectacle familier pour
villageois! La « grange », où effectivement les troupes « comiques » d'autrefois ont joué
plus d'une tragédie, symbolise ici l'absence presque totale de moyens matériels et réduit
le spectacle à une sorte de vision abstraite des rapports entre les personnages, vision
que l'auteur veut imposer à des spectateurs; en somme, elle se rapproche assez
fortement de ces représentations de pièces classiques en complet veston et en robe de
ville que l'on a parfois tentées dans des interprétations modernes.
4.
Il semble donc qu'il faudra d'abord comprendre la position de Sarcey et essayer de
dégager tout ce qui dans un drame (ce dernier mot mériterait une petite explication :
Sarcey veut dire sans doute « toute œuvre destinée à être représentée », sans donner au
terme le sens étroit que le xviiie siècle, puis le romantisme lui ont conféré) peut
constituer le « mérite » de l'œuvre, indépendamment de la séduction du décor et du
costume : finesse de la psychologie, mouvement de l'intrigue, force théâtrale, art
d'imposer les situations, les mots, les coups de théâtre..., en se gardant évidemment
d'une énumération, mais en montrant à chaque fois comment tous ces mérites sont
indépendants d'une somptueuse décoration et se satisferaient « d'une grange » aussi
bien que d'une « grande scène ».
De bons exemples pourront être tirés du théâtre
contemporain de Sarcey, de celui sur lequel s'exerça sa critique, notamment du théâtre
d'Emile Augier et de celui d'Alexandre Dumas fils.
On n'écartera pas, bien entendu, la
tragédie classique et encore moins le « genre sérieux » du xviiie siècle, mais il semble
que Sarcey pense surtout aux pièces à la fois sociales et psychologiques qui ont fait la
transition entre le drame romantique, trop attaché au flamboiement des décors, et le
Théâtre Libre, qui revient, par goût du réalisme, à une certaine primauté de la mise en
scène et qui pense que le décor, « complément indispensable de l'œuvre, doit prendre,
au théâtre, la place que la description tient dans le roman » (Antoine).
Sarcey, normalien
de la promotion 1848, se consacre exclusivement à la critique dramatique entre 1860 et
1900 et applaudit volontiers à la conception traditionnelle, qui continue à voir dans le
théâtre un conflit de passions et d'intérêts plus qu'un spectacle.
Cette tradition traverse à
peu près tout le xixe siècle, de La Dame aux camélias aux œuvres de Porto-Riche ou de
Bernstein, sans jamais, du reste, s'opposer violemment et nettement au drame
romantique.
(Il serait assez maladroit d'interpréter le sujet comme une attaque contre le
drame romantique.)
5.
Ce sujet appelle nécessairement une discussion, car l'opposition établie par Sarcey
entre « le mérite d'une œuvre » et la « séduction du décor et du costume » est assez
difficile à maintenir jusqu'au bout.
En effet, du....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓