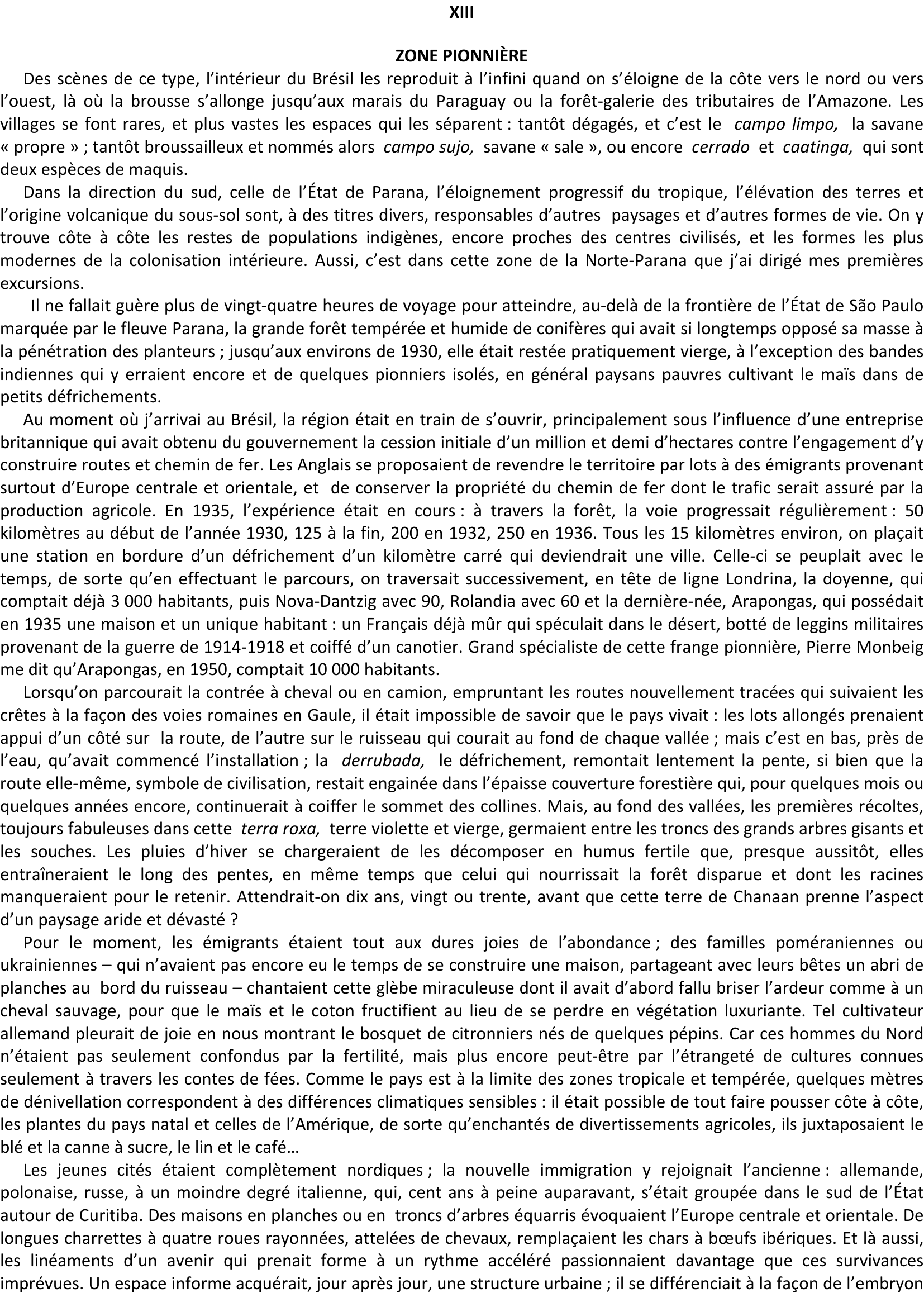visiteurs campent dans les intervalles entre ces blocs cubiques, avec leurs chars à roues pleines, cloutées sur le pourtour.
Publié le 06/01/2014
Extrait du document
«
XIII
ZONE PIONNIÈREDes
scènes decetype, l’intérieur duBrésil lesreproduit àl’infini quand ons’éloigne delacôte verslenord ouvers
l’ouest, làoù labrousse s’allonge jusqu’aux maraisduParaguay oulaforêt-galerie destributaires del’Amazone.
Les
villages sefont rares, etplus vastes lesespaces quilesséparent : tantôtdégagés, etc’est le campo
limpo, la
savane
« propre » ; tantôtbroussailleux etnommés alors campo
sujo, savane
« sale », ouencore cerrado et caatinga, qui
sont
deux espèces demaquis.
Dans ladirection dusud, celle del’État deParana, l’éloignement progressifdutropique, l’élévation desterres et
l’origine volcanique dusous-sol sont,àdes titres divers, responsables d’autrespaysages etd’autres formesdevie.
Ony
trouve côteàcôte lesrestes depopulations indigènes,encoreproches descentres civilisés, etles formes lesplus
modernes delacolonisation intérieure.Aussi,c’estdans cette zonedelaNorte-Parana quej’aidirigé mespremières
excursions.
Ilne fallait guère plusdevingt-quatre heuresdevoyage pouratteindre, au-delàdelafrontière del’État deSão Paulo
marquée parlefleuve Parana, lagrande forêttempérée ethumide deconifères quiavait silongtemps opposésamasse à
la pénétration desplanteurs ; jusqu’auxenvironsde1930, elleétait restée pratiquement vierge,àl’exception desbandes
indiennes quiyerraient encoreetde quelques pionniers isolés,engénéral paysans pauvrescultivant lemaïs dans de
petits défrichements.
Au moment oùj’arrivai auBrésil, larégion étaitentrain des’ouvrir, principalement sousl’influence d’uneentreprise
britannique quiavait obtenu dugouvernement lacession initialed’unmillion etdemi d’hectares contrel’engagement d’y
construire routesetchemin defer.
LesAnglais seproposaient derevendre leterritoire parlots àdes émigrants provenant
surtout d’Europe centraleetorientale, etdeconserver lapropriété duchemin defer dont letrafic serait assuré parla
production agricole.En1935, l’expérience étaitencours : àtravers laforêt, lavoie progressait régulièrement : 50
kilomètres audébut del’année 1930,125àla fin, 200 en1932, 250en1936.
Tousles15kilomètres environ,onplaçait
une station enbordure d’undéfrichement d’unkilomètre carréquideviendrait uneville.
Celle-ci sepeuplait avecle
temps, desorte qu’en effectuant leparcours, ontraversait successivement, entête deligne Londrina, ladoyenne, qui
comptait déjà3 000 habitants, puisNova-Dantzig avec90,Rolandia avec60etladernière-née, Arapongas,quipossédait
en 1935 unemaison etun unique habitant : unFrançais déjàmûrquispéculait dansledésert, bottédeleggins militaires
provenant delaguerre de1914-1918 etcoiffé d’uncanotier.
Grandspécialiste decette frange pionnière, PierreMonbeig
me ditqu’Arapongas, en1950, comptait 10 000habitants.
Lorsqu’on parcourait lacontrée àcheval ouencamion, empruntant lesroutes nouvellement tracéesquisuivaient les
crêtes àla façon desvoies romaines enGaule, ilétait impossible desavoir quelepays vivait : leslots allongés prenaient
appui d’uncôtésurlaroute, del’autre surleruisseau quicourait aufond dechaque vallée ;maisc’estenbas, près de
l’eau, qu’avait commencé l’installation ; la derrubada, le
défrichement, remontaitlentement lapente, sibien quela
route elle-même, symboledecivilisation, restaitengainée dansl’épaisse couverture forestièrequi,pour quelques moisou
quelques annéesencore, continuerait àcoiffer lesommet descollines.
Mais,aufond desvallées, lespremières récoltes,
toujours fabuleuses danscette terra
roxa, terre
violette etvierge, germaient entrelestroncs desgrands arbresgisants et
les souches.
Lespluies d’hiver sechargeraient deles décomposer enhumus fertileque,presque aussitôt, elles
entraneraient lelong despentes, enmême tempsquecelui quinourrissait laforêt disparue etdont lesracines
manqueraient pourleretenir.
Attendrait-on dixans, vingt outrente, avantquecette terredeChanaan prennel’aspect
d’un paysage arideetdévasté ?
Pour lemoment, lesémigrants étaienttoutauxdures joiesdel’abondance ; desfamilles poméraniennes ou
ukrainiennes –qui n’avaient pasencore euletemps deseconstruire unemaison, partageant avecleurs bêtes unabri de
planches aubord duruisseau –chantaient cetteglèbe miraculeuse dontilavait d’abord fallubriser l’ardeur commeàun
cheval sauvage, pourquelemaïs etlecoton fructifient aulieu deseperdre envégétation luxuriante.
Telcultivateur
allemand pleuraitdejoie ennous montrant lebosquet decitronniers nésdequelques pépins.Carceshommes duNord
n’étaient passeulement confondusparlafertilité, maisplusencore peut-être parl’étrangeté decultures connues
seulement àtravers lescontes defées.
Comme lepays estàla limite deszones tropicale ettempérée, quelquesmètres
de dénivellation correspondent àdes différences climatiques sensibles :ilétait possible detout faire pousser côteàcôte,
les plantes dupays natal etcelles del’Amérique, desorte qu’enchantés dedivertissements agricoles,ilsjuxtaposaient le
blé etlacanne àsucre, lelin etlecafé…
Les jeunes citésétaient complètement nordiques ;lanouvelle immigration yrejoignait l’ancienne : allemande,
polonaise, russe,àun moindre degréitalienne, qui,cent ansàpeine auparavant, s’étaitgroupée danslesud del’État
autour deCuritiba.
Desmaisons enplanches ouen troncs d’arbres équarrisévoquaient l’Europecentraleetorientale.
De
longues charrettes àquatre rouesrayonnées, atteléesdechevaux, remplaçaient leschars àbœufs ibériques.
Etlàaussi,
les linéaments d’unavenir quiprenait formeàun rythme accéléré passionnaient davantagequecessurvivances
imprévues.
Unespace informe acquérait, jouraprès jour,unestructure urbaine ;ilse différenciait àla façon del’embryon.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ANONYME: Exposition du mort et défilé de chars (analyse).
- CV et Lettre de motivation : carte de résident - examen médical (salariés, visiteurs, non salariés).
- les culs des charrettes ouverts montraient des chapelles ardentes, des enfoncements de tabernacle, dans les lueurs lambantes de ces chairs régulières et nues ; et, sur le lit de paille, il y avait des boîtes de fer-blanc, pleines du sang des cochons.
- Seconde Cours ensembles et intervalles I.
- James Joyce par Claude-Edmonde Magny Frank Budgen rapporte que Joyce portait d'ordinaire dans sa poche de gilet de petits blocs-notes sur lesquels, seul ou au milieu d'une conversation, il jetait occasionnellement un mot ou deux.