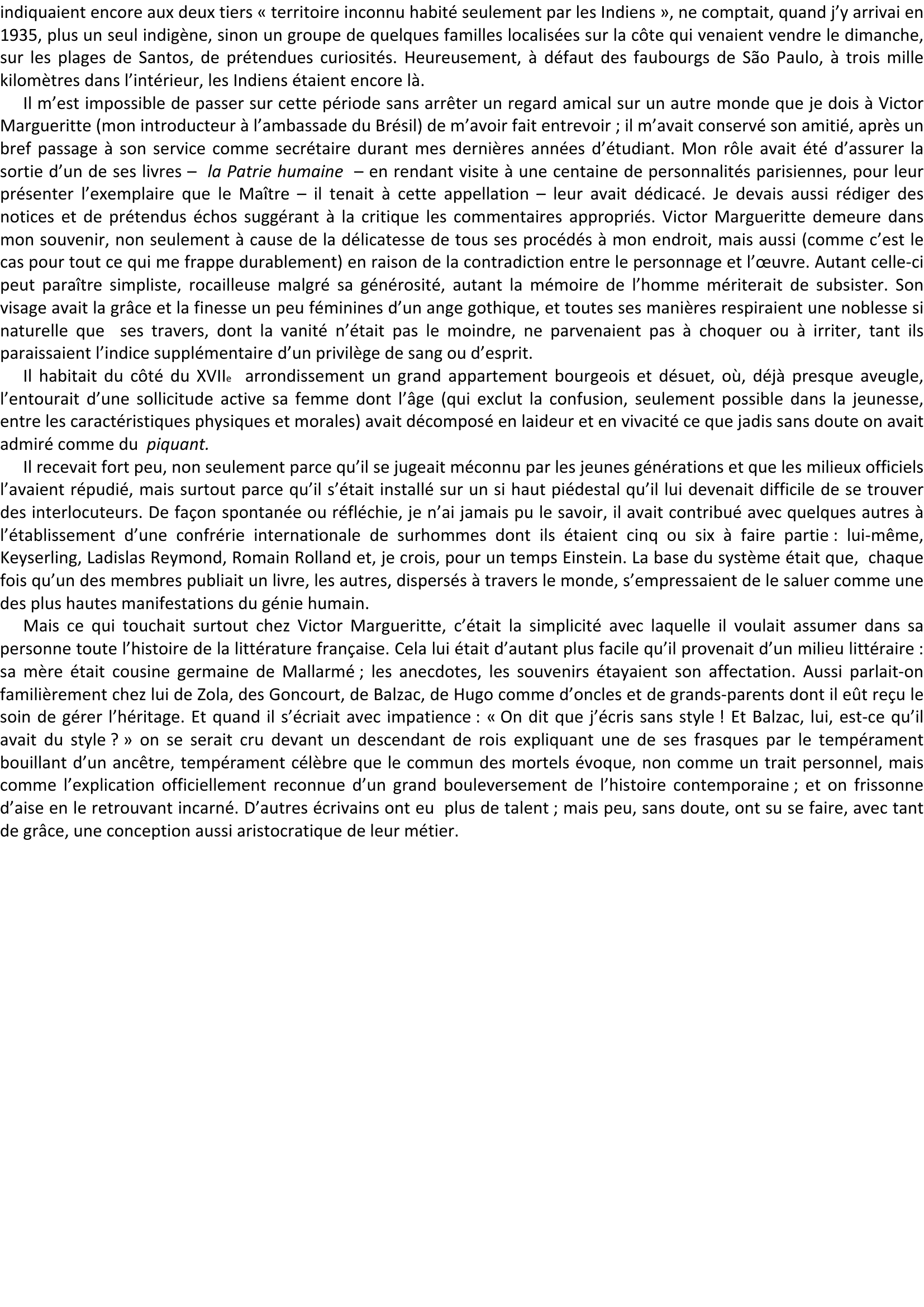V REGARDS EN ARRIÈRE Ma carrière s'est jouée un dimanche de l'automne 1934, à 9 heures du matin, sur un coup de téléphone. C'était Célestin Bouglé, alors directeur de l'École normale supérieure ; il m'accordait depuis quelques années une bienveillance un peu lointaine et réticente : d'abord parce que je n'étais pas un ancien normalien, ensuite et surtout parce que, même si je l'avais été, je n'appartenais pas à son écurie pour laquelle il manifestait des sentiments très exclusifs. Sans doute 'avait-il pas pu faire un meilleur choix, car il me demanda abruptement : « Avez-vous toujours le désir de faire de l'ethnographie ? - Certes ! - Alors, posez votre candidature comme professeur de sociologie à l'Université de São Paulo. Les faubourgs sont remplis d'indiens, vous leur consacrerez vos week-ends. Mais il faut que vous donniez votre réponse définitive à Georges Dumas avant midi. » Le Brésil et l'Amérique du Sud ne signifiaient pas grand-chose pour moi. Néanmoins, je revois encore, avec la plus grande netteté, les images qu'évoqua aussitôt cette proposition imprévue. Les pays exotiques m'apparaissaient comme le contrepied des nôtres, le terme d'antipodes trouvait dans ma pensée un sens plus riche et plus naïf que son contenu littéral. On m'eût fort étonné en disant qu'une espèce animale ou végétale pouvait avoir le même aspect des deux côtés du globe. Chaque animal, chaque arbre, chaque brin d'herbe, devait être radicalement différent, afficher au premier coup d'oeil sa nature tropicale. Le Brésil s'esquissait dans mon imagination comme des gerbes de palmiers contournés, dissimulant des architectures bizarres, le tout baigné dans une odeur de cassolette, détail olfactif introduit subrepticement, semble-t-il, par l'homophonie inconsciemment perçue des mots « Brésil » et « grésiller », mais qui, plus que toute expérience acquise, explique qu'aujourd'hui encore je pense d'abord au Brésil comme à un parfum brûlé. Considérées rétrospectivement, ces images ne me paraissent plus aussi arbitraires. J'ai appris que la vérité d'une situation ne se trouve pas dans son observation journalière, mais dans cette distillation patiente et fractionnée que l'équivoque du parfum m'invitait peut-être déjà à mettre en pratique, sous la forme d'un calembour spontané, véhicule d'une leçon symbolique que je n'étais pas à même de formuler clairement. Moins qu'un parcours, l'exploration est une fouille : une scène fugitive, un coin de paysage, une réflexion saisie au vol permettent seuls de comprendre et d'interpréter des horizons autrement stériles. À ce moment, l'extravagante promesse de Bouglé relative aux Indiens me posait d'autres problèmes. D'où avait-il tiré la croyance que São Paulo était une ville indigène, au moins par sa banlieue ? Sans doute d'une confusion avec Mexico ou Tegucigalpa. Ce philosophe qui avait jadis écrit un ouvrage sur le Régime des castes dans l'Inde, sans se demander un seul instant s'il n'eût pas mieux valu, d'abord, y aller voir (« dans le flux des événements, ce sont les institutions qui urnagent », proclamait-il avec hauteur dans sa préface de 1927), ne pensait pas que la condition des indigènes dût avoir n sérieux retentissement sur l'enquête ethnographique. On sait d'ailleurs qu'il n'était pas le seul, parmi les sociologues fficiels, à témoigner cette indifférence dont des exemples survivent sous nos yeux. Quoi qu'il en soit, j'étais trop ignorant moi-même pour ne pas accueillir des illusions si favorables à mon dessein ; d'autant que Georges Dumas avait sur la question des notions également imprécises : il avait connu le Brésil méridional à une époque où l'extermination des populations indigènes n'était pas encore parvenue à son terme ; et surtout, la société de dictateurs, de féodaux et de mécènes dans laquelle il se plaisait ne lui avait guère fourni de lumières sur ce sujet. Je fus donc bien étonné quand, au cours d'un déjeuner où m'avait amené Victor Margueritte, j'entendis de la bouche de l'ambassadeur du Brésil à Paris le son de cloche officiel : « Des Indiens ? Hélas, mon cher Monsieur, mais voici des lustres qu'ils ont tous disparu. Oh, c'est là une page bien triste, bien honteuse, dans l'histoire de mon pays. Mais les colons portugais du XVIe siècle étaient des hommes avides et brutaux. Comment leur reprocher d'avoir participé à la rudesse générale des moeurs ? Ils se saisissaient des Indiens, les attachaient à la bouche des canons et les déchiquetaient vivants à coups de boulets. C'est ainsi qu'on les a eus, jusqu'au dernier. Vous allez, comme sociologue, découvrir au Brésil es choses passionnantes, mais les Indiens, n'y songez plus, vous n'en trouverez plus un seul... » Quand j'évoque aujourd'hui ces propos, ils me paraissent incroyables, même dans la bouche d'un gran fino de 1934 et me souvenant à quel point l'élite brésilienne d'alors (heureusement, elle a changé depuis) avait horreur de toute allusion aux indigènes et plus généralement aux conditions primitives de l'intérieur, sinon pour admettre - et même uggérer - qu'une arrière-grand-mère indienne était à l'origine d'une physionomie imperceptiblement exotique, et non as ces quelques gouttes, ou litres, de sang noir qu'il devenait déjà de bon ton (à l'inverse des ancêtres de l'époque mpériale) d'essayer de faire oublier. Pourtant, chez Luis de Souza-Dantas, l'ascendance indienne n'était pas douteuse et l eût pu aisément s'en glorifier. Mais, Brésilien d'exportation qui avait depuis l'adolescence adopté la France, il avait erdu jusqu'à la connaissance de l'état réel de son pays, à quoi s'était substitué dans sa mémoire une sorte de poncif fficiel et distingué. Dans la mesure où certains souvenirs lui étaient restés, il préférait aussi, j'imagine, ternir les résiliens du XVIe siècle pour détourner l'attention du passe-temps favori qui avait été celui des hommes de la génération de ses parents, et même encore du temps de sa jeunesse : à savoir, recueillir dans les hôpitaux les vêtements infectés des ictimes de la variole, pour aller les accrocher avec d'autres présents le long des sentiers encore fréquentés par les tribus. râce à quoi fut obtenu ce brillant résultat : l'État de São Paulo, aussi grand que la France, que les cartes de 1918 indiquaient encore aux deux tiers « territoire inconnu habité seulement par les Indiens », ne comptait, quand j'y arrivai en 1935, plus un seul indigène, sinon un groupe de quelques familles localisées sur la côte qui venaient vendre le dimanche, sur les plages de Santos, de prétendues curiosités. Heureusement, à défaut des faubourgs de São Paulo, à trois mille ilomètres dans l'intérieur, les Indiens étaient encore là. Il m'est impossible de passer sur cette période sans arrêter un regard amical sur un autre monde que je dois à Victor argueritte (mon introducteur à l'ambassade du Brésil) de m'avoir fait entrevoir ; il m'avait conservé son amitié, après un ref passage à son service comme secrétaire durant mes dernières années d'étudiant. Mon rôle avait été d'assurer la ortie d'un de ses livres - la Patrie humaine - en rendant visite à une centaine de personnalités parisiennes, pour leur présenter l'exemplaire que le Maître - il tenait à cette appellation - leur avait dédicacé. Je devais aussi rédiger des notices et de prétendus échos suggérant à la critique les commentaires appropriés. Victor Margueritte demeure dans mon souvenir, non seulement à cause de la délicatesse de tous ses procédés à mon endroit, mais aussi (comme c'est le cas pour tout ce qui me frappe durablement) en raison de la contradiction entre le personnage et l'oeuvre. Autant celle-ci peut paraître simpliste, rocailleuse malgré sa générosité, autant la mémoire de l'homme mériterait de subsister. Son visage avait la grâce et la finesse un peu féminines d'un ange gothique, et toutes ses manières respiraient une noblesse si naturelle que ses travers, dont la vanité n'était pas le moindre, ne parvenaient pas à choquer ou à irriter, tant ils paraissaient l'indice supplémentaire d'un privilège de sang ou d'esprit. Il habitait du côté du XVIIe arrondissement un grand appartement bourgeois et désuet, où, déjà presque aveugle, l'entourait d'une sollicitude active sa femme dont l'âge (qui exclut la confusion, seulement possible dans la jeunesse, entre les caractéristiques physiques et morales) avait décomposé en laideur et en vivacité ce que jadis sans doute on avait admiré comme du piquant. Il recevait fort peu, non seulement parce qu'il se jugeait méconnu par les jeunes générations et que les milieux officiels l'avaient répudié, mais surtout parce qu'il s'était installé sur un si haut piédestal qu'il lui devenait difficile de se trouver des interlocuteurs. De façon spontanée ou réfléchie, je n'ai jamais pu le savoir, il avait contribué avec quelques autres à l'établissement d'une confrérie internationale de surhommes dont ils étaient cinq ou six à faire partie : lui-même, Keyserling, Ladislas Reymond, Romain Rolland et, je crois, pour un temps Einstein. La base du système était que, chaque fois qu'un des membres publiait un livre, les autres, dispersés à travers le monde, s'empressaient de le saluer comme une es plus hautes manifestations du génie humain. Mais ce qui touchait surtout chez Victor Margueritte, c'était la simplicité avec laquelle il voulait assumer dans sa ersonne toute l'histoire de la littérature française. Cela lui était d'autant plus facile qu'il provenait d'un milieu littéraire : a mère était cousine germaine de Mallarmé ; les anecdotes, les souvenirs étayaient son affectation. Aussi parlait-on amilièrement chez lui de Zola, des Goncourt, de Balzac, de Hugo comme d'oncles et de grands-parents dont il eût reçu le oin de gérer l'héritage. Et quand il s'écriait avec impatience : « On dit que j'écris sans style ! Et Balzac, lui, est-ce qu'il vait du style ? » on se serait cru devant un descendant de rois expliquant une de ses frasques par le tempérament ouillant d'un ancêtre, tempérament célèbre que le commun des mortels évoque, non comme un trait personnel, mais omme l'explication officiellement reconnue d'un grand bouleversement de l'histoire contemporaine ; et on frissonne 'aise en le retrouvant incarné. D'autres écrivains ont eu plus de talent ; mais peu, sans doute, ont su se faire, avec tant e grâce, une conception aussi aristocratique de leur métier. VI COMMENT ON DEVIENT ETHNOGRAPHE Je préparais l'agrégation de philosophie vers quoi m'avait poussé moins une vocation véritable que la répugnance éprouvée au contact des autres études dont j'avais tâté jusque-là. À l'arrivée en classe de philosophie, j'étais vaguement imbu d'un monisme rationaliste que je m'apprêtais à justifier et fortifier ; j'avais donc fait des pieds et des mains pour entrer dans la division dont le professeur avait la réputation d'être le plus « avancé ». Il est vrai que Gustave Rodrigues était un militant du parti S. F. I. O., mais, sur le plan philosophique, sa doctrine offrait un mélange de bergsonisme et de néo-kantisme qui décevait rudement mon espérance. Au service d'une sécheresse dogmatique, il mettait une ferveur qui se traduisait tout au long de son cours par une gesticulation passionnée. Je n'ai jamais connu autant de conviction candide associée à une réflexion plus maigre. Il s'est suicidé en 1940 lors de l'entrée des Allemands à Paris. Là, j'ai commencé à apprendre que tout problème, grave ou futile, peut être liquidé par l'application d'une méthode, toujours identique, qui consiste à opposer deux vues traditionnelles de la question ; à introduire la première par les justifications du sens commun, puis à les détruire au moyen de la seconde ; enfin à les renvoyer dos à dos grâce à une troisième qui révèle le caractère également partiel des deux autres, ramenées par des artifices de vocabulaire aux aspects complémentaires d'une même réalité : forme et fond, contenant et contenu, être et paraître, continu et discontinu, essence et existence, etc. Ces exercices deviennent vite verbaux, fondés sur un art du calembour qui prend la place de la réflexion ; les assonances entre les termes, les homophonies et les ambiguïtés fournissant progressivement la matière de ces coups de théâtre spéculatifs à l'ingéniosité desquels se reconnaissent les bons travaux philosophiques. Cinq années de Sorbonne se réduisaient à l'apprentissage de cette gymnastique dont les dangers sont pourtant manifestes. D'abord parce que le ressort de ces rétablissements est si simple qu'il n'existe pas de problème qui ne puisse être abordé de cette façon. Pour préparer le concours et cette suprême épreuve, la leçon (qui consiste, après quelques heures de préparation, à traiter une question tirée au sort), mes camarades et moi nous proposions les sujets les plus extravagants. Je me faisais fort de mettre en dix minutes sur pied une conférence d'une heure, à solide charpente dialectique, sur la supériorité respective des autobus et des tramways. Non seulement la méthode fournit un passepartout, mais elle incite à n'apercevoir dans la richesse des thèmes de réflexion qu'une forme unique, toujours semblable, à condition d'y apporter quelques correctifs élémentaires : un peu comme une musique qui se réduirait à une seule mélodie, dès qu'on a compris que celle-ci se lit tantôt en clé de sol et tantôt en clé de fa. De ce point de vue, l'enseignement philosophique exerçait l'intelligence en même temps qu'il desséchait l'esprit. J'aperçois un péril plus grave encore à confondre le progrès de la connaissance avec la complexité croissante des constructions de l'esprit. On nous invitait à pratiquer une synthèse dynamique prenant comme point de départ les théories les moins adéquates pour nous élever jusqu'aux plus subtiles ; mais en même temps (et en raison du souci istorique qui obsédait tous nos maîtres), il fallait expliquer comment celles-ci étaient graduellement nées de celles-là. Au ond, il s'agissait moins de découvrir le vrai et le faux que de comprendre comment les hommes avaient peu à peu urmonté des contradictions. La philosophie n'était pas ancilla scientiarum, la servante et l'auxiliaire de l'exploration scientifique, mais une sorte de contemplation esthétique de la conscience par elle-même. On la voyait, à travers les iècles, élaborer des constructions de plus en plus légères et audacieuses, résoudre des problèmes d'équilibre ou de ortée, inventer des raffinements logiques, et tout cela était d'autant plus méritoire que la perfection technique ou la ohérence interne était plus grande ; l'enseignement philosophique devenait comparable à celui d'une histoire de l'art ui proclamerait le gothique nécessairement supérieur au roman, et, dans l'ordre du premier, le flamboyant plus parfait ue le primitif, mais où personne ne se demanderait ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Le signifiant ne se rapportait à ucun signifié, il n'y avait plus de réfèrent. Le savoir-faire remplaçait le goût de la vérité. Après des années consacrées à es exercices, je me retrouve en tête à tête avec quelques convictions rustiques qui ne sont pas très différentes de celles e ma quinzième année. Peut-être je perçois mieux l'insuffisance de ces outils ; au moins ont-ils une valeur instrumentale qui les rend propres au service que je leur demande ; je ne suis pas en danger d'être dupe de leur complication interne, ni 'oublier leur destination pratique pour me perdre dans la contemplation de leur agencement merveilleux. Toutefois, je devine des causes plus personnelles au dégoût rapide qui m'éloigna de la philosophie et me fit 'accrocher à l'ethnographie comme à une planche de salut. Après avoir passé au lycée de Mont-de-Marsan une année eureuse à élaborer mon cours en même temps que j'enseignais, je découvris avec horreur dès la rentrée suivante, à aon où j'avais été nommé, que tout le reste de ma vie consisterait à le répéter. Or, mon esprit présente cette articularité, qui est sans doute une infirmité, qu'il m'est difficile de le fixer deux fois sur le même objet. D'habitude, le oncours d'agrégation est considéré comme une épreuve inhumaine au terme de laquelle, pour peu qu'on le veuille, on agne définitivement le repos. Pour moi, c'était le contraire. Reçu à mon premier concours, cadet de ma promotion, 'avais sans fatigue remporté ce rallye à travers les doctrines, les théories et les hypothèses. Mais c'est ensuite que mon upplice allait commencer : il me serait impossible d'articuler verbalement mes leçons si je ne m'employais chaque année fabriquer un cours nouveau. Cette incapacité se révélait encore plus gênante quand je me trouvais dans le rôle