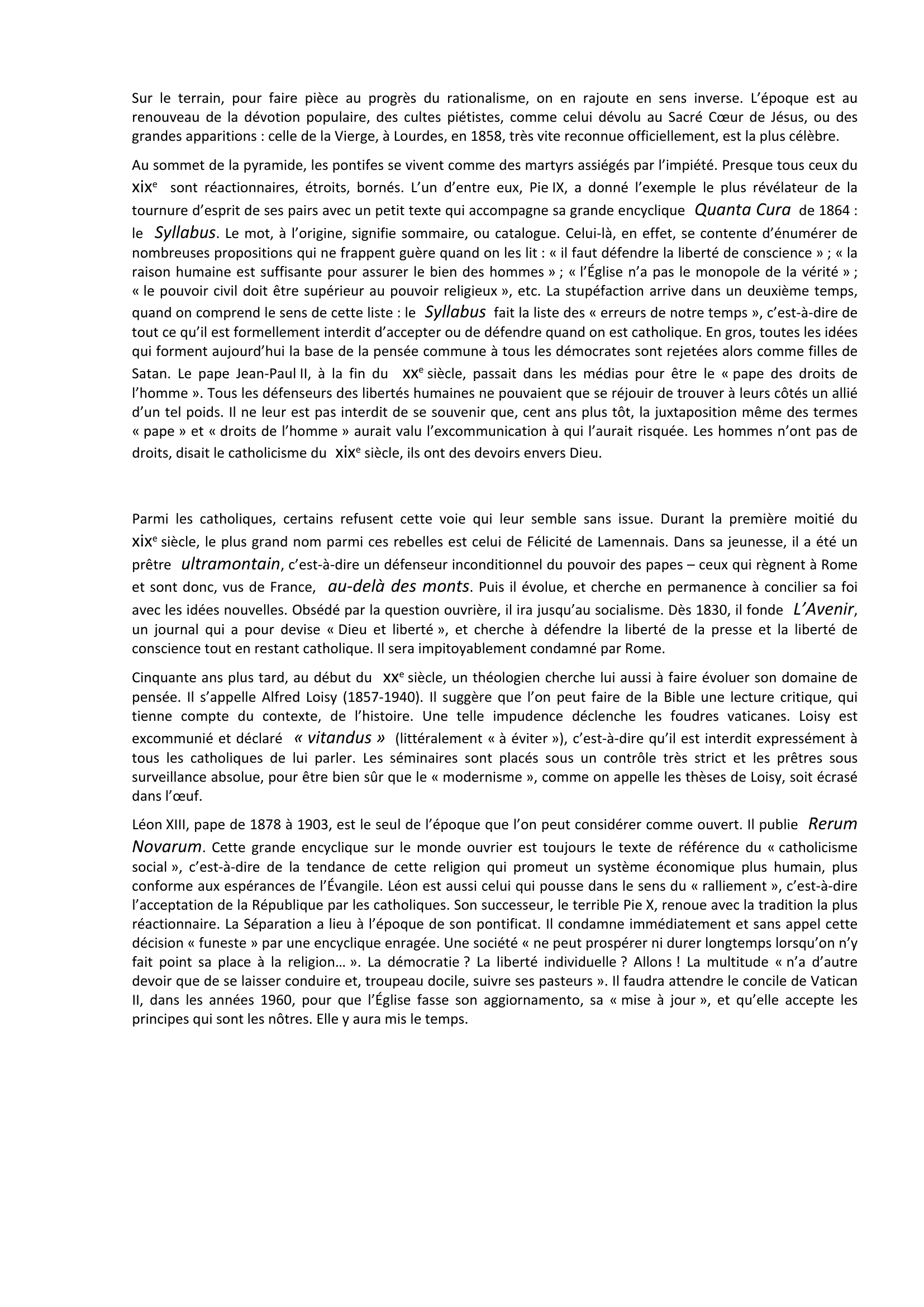s'est fondée au xvie siècle sur la rupture avec Rome et le rejet forcené des papistes puis, au xviie, sur la défaite de la dynastie qui voulait les rétablir au pouvoir (les Stuarts).
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
Sur
leterrain, pourfairepièce auprogrès durationalisme, onenrajoute ensens inverse.
L’époque estau
renouveau deladévotion populaire, descultes piétistes, commeceluidévolu auSacré Cœur deJésus, oudes
grandes apparitions : celledelaVierge, àLourdes, en1858, trèsvitereconnue officiellement, estlaplus célèbre.
Au sommet delapyramide, lespontifes sevivent comme desmartyrs assiégés parl’impiété.
Presquetousceux du
xix e
sont réactionnaires, étroits,bornés.
L’und’entre eux,Pie IX, adonné l’exemple leplus révélateur dela
tournure d’espritdeses pairs avecunpetit texte quiaccompagne sagrande encyclique Quanta
Cura de
1864 :
le Syllabus .
Le mot, àl’origine, signifiesommaire, oucatalogue.
Celui-là,eneffet, secontente d’énumérer de
nombreuses propositions quinefrappent guèrequand onles lit : « ilfaut défendre laliberté deconscience » ; « la
raison humaine estsuffisante pourassurer lebien deshommes » ; « l’Églisen’apas lemonopole delavérité » ;
« le pouvoir civildoit être supérieur aupouvoir religieux », etc.Lastupéfaction arrivedansundeuxième temps,
quand oncomprend lesens decette liste : le Syllabus fait
laliste des« erreurs denotre temps », c’est-à-dire de
tout cequ’il estformellement interditd’accepter oudedéfendre quandonest catholique.
Engros, toutes lesidées
qui forment aujourd’hui labase delapensée commune àtous lesdémocrates sontrejetées alorscomme fillesde
Satan.
Lepape Jean-Paul II, àla fin du xxe
siècle, passait danslesmédias pourêtrele« pape desdroits de
l’homme ».
Touslesdéfenseurs deslibertés humaines nepouvaient queseréjouir detrouver àleurs côtés unallié
d’un telpoids.
Ilne leur estpas interdit desesouvenir que,centansplus tôt,lajuxtaposition mêmedestermes
« pape » et« droits del’homme » auraitvalul’excommunication àqui l’aurait risquée.
Leshommes n’ontpasde
droits, disaitlecatholicisme duxixe
siècle, ilsont des devoirs enversDieu.
Parmi lescatholiques, certainsrefusent cettevoiequileur semble sansissue.
Durant lapremière moitiédu
xix e
siècle, leplus grand nomparmi cesrebelles estcelui deFélicité deLamennais.
Danssajeunesse, ila été un
prêtre ultramontain ,
c’est-à-dire undéfenseur inconditionnel dupouvoir despapes –ceux quirègnent àRome
et sont donc, vusdeFrance, au-delà
desmonts .
Puis ilévolue, etcherche enpermanence àconcilier safoi
avec lesidées nouvelles.
Obsédéparlaquestion ouvrière, ilira jusqu’au socialisme.
Dès1830, ilfonde L’Avenir ,
un journal quiapour devise « Dieu etliberté », etcherche àdéfendre laliberté delapresse etlaliberté de
conscience toutenrestant catholique.
Ilsera impitoyablement condamnéparRome.
Cinquante ansplus tard, audébut duxxe
siècle, unthéologien chercheluiaussi àfaire évoluer sondomaine de
pensée.
Ils’appelle AlfredLoisy(1857-1940).
Ilsuggère quel’onpeut fairedelaBible unelecture critique, qui
tienne compte ducontexte, del’histoire.
Unetelle impudence déclenchelesfoudres vaticanes.
Loisyest
excommunié etdéclaré « vitandus » (littéralement
« àéviter »), c’est-à-dire qu’ilestinterdit expressément à
tous lescatholiques deluiparler.
Lesséminaires sontplacés sousuncontrôle trèsstrict etles prêtres sous
surveillance absolue,pourêtrebien sûrque le« modernisme », commeonappelle lesthèses deLoisy, soitécrasé
dans l’œuf.
Léon XIII, papede1878 à1903, estleseul del’époque quel’onpeut considérer commeouvert.Ilpublie Rerum
Novarum .
Cette grande encyclique surlemonde ouvrier esttoujours letexte deréférence du« catholicisme
social », c’est-à-dire delatendance decette religion quipromeut unsystème économique plushumain, plus
conforme auxespérances del’Évangile.
Léonestaussi celuiquipousse danslesens du« ralliement », c’est-à-dire
l’acceptation delaRépublique parlescatholiques.
Sonsuccesseur, leterrible Pie X,renoue aveclatradition laplus
réactionnaire.
LaSéparation alieu àl’époque deson pontificat.
Ilcondamne immédiatement etsans appel cette
décision « funeste » parune encyclique enragée.Unesociété « nepeut prospérer nidurer longtemps lorsqu’onn’y
fait point saplace àla religion… ».
Ladémocratie ? Laliberté individuelle ? Allons !Lamultitude « n’ad’autre
devoir quedeselaisser conduire et,troupeau docile,suivresespasteurs ».
Ilfaudra attendre leconcile deVatican
II, dans lesannées 1960,pourquel’Église fassesonaggiornamento, sa« mise àjour », etqu’elle accepte les
principes quisont lesnôtres.
Elleyaura misletemps..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- grotesque grotesque, style aérien et plein de fantaisie développé par Raphaël et ses élèves après que l'on eut redécouvert au XVIe siècle les peintures murales de la Domus Aurea de Néron dans les « grottes » du flanc méridional de l'Esquilin à Rome.
- Fondée au XVIIe siècle sur la côte atlantique, symbole de
- La révolte des croquants Plusieurs révoltes de paysans se produisirent à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, surtout dans le Périgord, le Limousin et le Quercy.
- La révolte des croquants : fin du XVIe siècle - début du XVIIe siècle.
- LE COSTUME SOUS L'INFLUENCE ESPAGNOLE (xvie et début du xviie siècle).