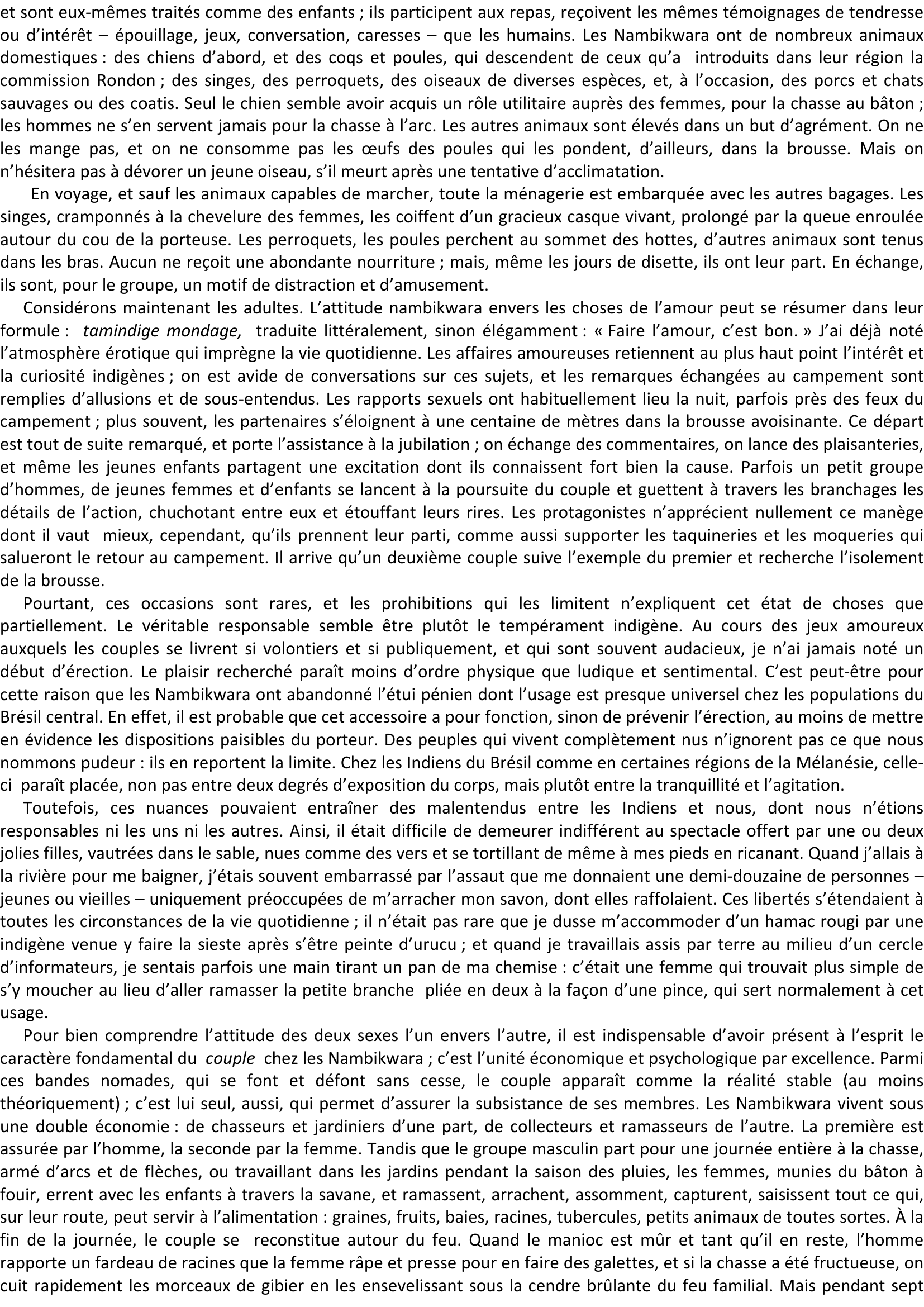pleure parce qu'il s'est fait mal, s'est disputé ou a faim, ou parce qu'il ne veut pas se laisser épouiller.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
et
sont eux-mêmes traitéscomme desenfants ; ilsparticipent auxrepas, reçoivent lesmêmes témoignages detendresse
ou d’intérêt –épouillage, jeux,conversation, caresses–que leshumains.
LesNambikwara ontdenombreux animaux
domestiques : deschiens d’abord, etdes coqs etpoules, quidescendent deceux qu’a introduits dansleurrégion la
commission Rondon ;dessinges, desperroquets, desoiseaux dediverses espèces, et,àl’occasion, desporcs etchats
sauvages oudes coatis.
Seullechien semble avoiracquis unrôle utilitaire auprèsdesfemmes, pourlachasse aubâton ;
les hommes nes’en servent jamaispourlachasse àl’arc.
Lesautres animaux sontélevés dansunbut d’agrément.
Onne
les mange pas,eton neconsomme paslesœufs despoules quilespondent, d’ailleurs, danslabrousse.
Maison
n’hésitera pasàdévorer unjeune oiseau, s’ilmeurt aprèsunetentative d’acclimatation.
En voyage, etsauf lesanimaux capables demarcher, toutelaménagerie estembarquée aveclesautres bagages.
Les
singes, cramponnés àla chevelure desfemmes, lescoiffent d’ungracieux casquevivant,prolongé parlaqueue enroulée
autour ducou delaporteuse.
Lesperroquets, lespoules perchent ausommet deshottes, d’autres animaux sonttenus
dans lesbras.
Aucun nereçoit uneabondante nourriture ; mais,même lesjours dedisette, ilsont leur part.
Enéchange,
ils sont, pourlegroupe, unmotif dedistraction etd’amusement.
Considérons maintenantlesadultes.
L’attitude nambikwara enversleschoses del’amour peutserésumer dansleur
formule : tamindige
mondage, traduite
littéralement, sinonélégamment : « Fairel’amour, c’estbon. » J’aidéjà noté
l’atmosphère érotiquequiimprègne lavie quotidienne.
Lesaffaires amoureuses retiennentauplus haut point l’intérêt et
la curiosité indigènes ; onest avide deconversations surces sujets, etles remarques échangéesaucampement sont
remplies d’allusions etde sous-entendus.
Lesrapports sexuelsonthabituellement lieulanuit, parfois prèsdesfeux du
campement ; plussouvent, lespartenaires s’éloignentàune centaine demètres danslabrousse avoisinante.
Cedépart
est tout desuite remarqué, etporte l’assistance àla jubilation ; onéchange descommentaires, onlance desplaisanteries,
et même lesjeunes enfants partagent uneexcitation dontilsconnaissent fortbien lacause.
Parfois unpetit groupe
d’hommes, dejeunes femmes etd’enfants selancent àla poursuite ducouple etguettent àtravers lesbranchages les
détails del’action, chuchotant entreeuxetétouffant leursrires.
Lesprotagonistes n’apprécientnullementcemanège
dont ilvaut mieux, cependant, qu’ilsprennent leurparti, comme aussisupporter lestaquineries etles moqueries qui
salueront leretour aucampement.
Ilarrive qu’undeuxième couplesuivel’exemple dupremier etrecherche l’isolement
de labrousse.
Pourtant, cesoccasions sontrares, etles prohibitions quileslimitent n’expliquent cetétat dechoses que
partiellement.
Levéritable responsable sembleêtreplutôt letempérament indigène.Aucours desjeux amoureux
auxquels lescouples selivrent sivolontiers etsipubliquement, etqui sont souvent audacieux, jen’ai jamais notéun
début d’érection.
Leplaisir recherché paraîtmoins d’ordre physique queludique etsentimental.
C’estpeut-être pour
cette raison quelesNambikwara ontabandonné l’étuipénien dontl’usage estpresque universel chezlespopulations du
Brésil central.
Eneffet, ilest probable quecetaccessoire apour fonction, sinondeprévenir l’érection, aumoins demettre
en évidence lesdispositions paisiblesduporteur.
Despeuples quivivent complètement nusn’ignorent pasceque nous
nommons pudeur :ilsen reportent lalimite.
ChezlesIndiens duBrésil comme encertaines régionsdelaMélanésie, celle-
ci paraît placée, nonpasentre deuxdegrés d’exposition ducorps, maisplutôt entrelatranquillité etl’agitation.
Toutefois, cesnuances pouvaient entranerdesmalentendus entrelesIndiens etnous, dontnous n’étions
responsables niles uns niles autres.
Ainsi,ilétait difficile dedemeurer indifférent auspectacle offertparune oudeux
jolies filles, vautrées danslesable, nuescomme desvers etse tortillant demême àmes pieds enricanant.
Quandj’allaisà
la rivière pourmebaigner, j’étaissouvent embarrassé parl’assaut quemedonnaient unedemi-douzaine depersonnes –
jeunes ouvieilles –uniquement préoccupées dem’arracher monsavon, dontellesraffolaient.
Ceslibertés s’étendaient à
toutes lescirconstances delavie quotidienne ; iln’était pasrare quejedusse m’accommoder d’unhamac rougiparune
indigène venueyfaire lasieste aprèss’être peinte d’urucu ; etquand jetravaillais assisparterre aumilieu d’uncercle
d’informateurs, jesentais parfoisunemain tirant unpan dema chemise : c’étaitunefemme quitrouvait plussimple de
s’y moucher aulieu d’aller ramasser lapetite branche pliéeendeux àla façon d’une pince, quisert normalement àcet
usage.
Pour biencomprendre l’attitudedesdeux sexes l’unenvers l’autre, ilest indispensable d’avoirprésent àl’esprit le
caractère fondamental du couple chez
lesNambikwara ; c’estl’unité économique etpsychologique parexcellence.
Parmi
ces bandes nomades, quisefont etdéfont sanscesse, lecouple apparaît commelaréalité stable(aumoins
théoriquement) ; c’estluiseul, aussi, quipermet d’assurer lasubsistance deses membres.
LesNambikwara viventsous
une double économie : dechasseurs etjardiniers d’unepart,decollecteurs etramasseurs del’autre.
Lapremière est
assurée parl’homme, laseconde parlafemme.
Tandisquelegroupe masculin partpour unejournée entièreàla chasse,
armé d’arcs etde flèches, outravaillant danslesjardins pendant lasaison despluies, lesfemmes, muniesdubâton à
fouir, errent aveclesenfants àtravers lasavane, etramassent, arrachent,assomment, capturent,saisissenttoutcequi,
sur leur route, peutservir àl’alimentation : graines,fruits,baies,racines, tubercules, petitsanimaux detoutes sortes.
Àla
fin delajournée, lecouple sereconstitue autourdufeu.
Quand lemanioc estmûr ettant qu’il enreste, l’homme
rapporte unfardeau deracines quelafemme râpeetpresse pourenfaire desgalettes, etsila chasse aété fructueuse, on
cuit rapidement lesmorceaux degibier enles ensevelissant souslacendre brûlante dufeu familial.
Maispendant sept.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La poésie pleure bien, chante bien, mais elle décrit mal. (Lamartine.)
- Le mal de gorge Chez un nourrisson, un mal de gorge est soupçonné s'il refuse de manger ou pleure en buvant son biberon, se met les doigts dans la bouche en s'agitant, ou si son cri est modifié.
- Peut-on penser comme Leibniz, que l'on veut parfois un mal pour empêcher de plus grands maux ou pour obtenir de plus grands biens ?
- Peut-on dire avec Leibniz qu'on veut souvent le mal « pour empêcher de plus grands maux ou pour obtenir de plus grands biens » ?
- La poésie pleure bien, chante bien, mais elle décrit mal. (LAMARTINE)