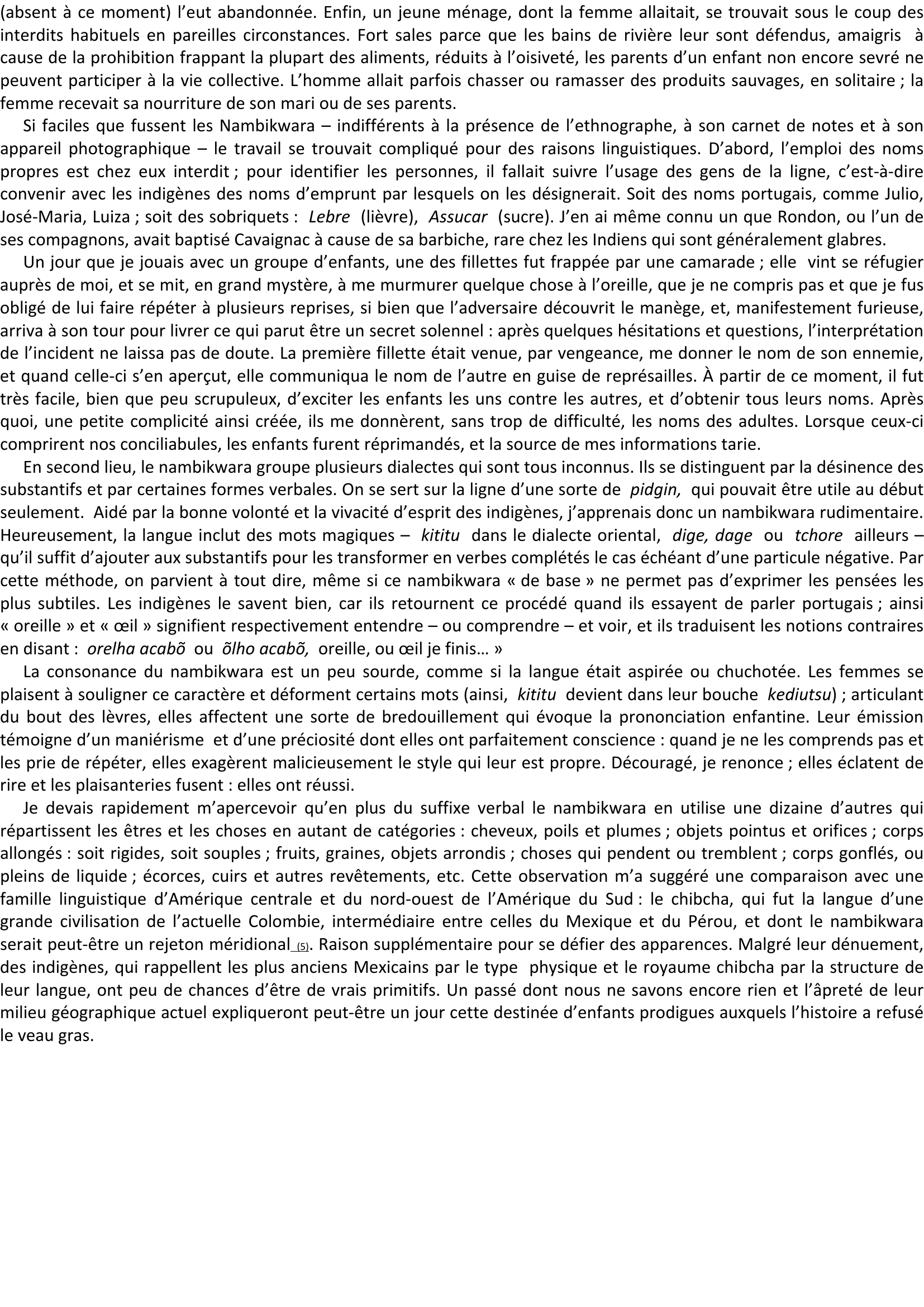physique des Nambikwara nous apparaît moins problématique ; il évoque celui d'une ancienne race dont on connaît les ossements, retrouvés au Brésil dans les grottes de Lagoa Santa qui sont un site de l'État de Minas Gérais.
Publié le 06/01/2014
Extrait du document
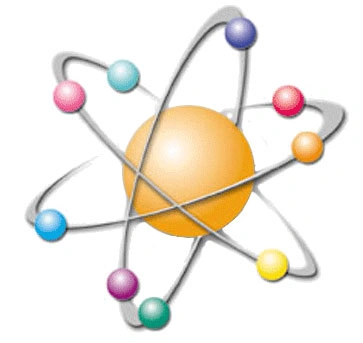
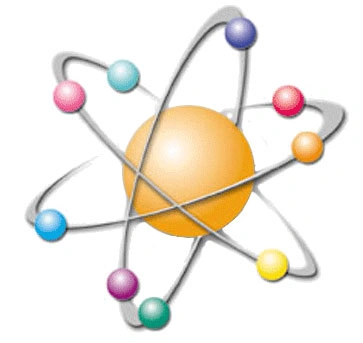
«
(absent
àce moment) l’eutabandonnée.
Enfin,unjeune ménage, dontlafemme allaitait, setrouvait souslecoup des
interdits habituels enpareilles circonstances.
Fortsales parce quelesbains derivière leursont défendus, amaigrisà
cause delaprohibition frappantlaplupart desaliments, réduitsàl’oisiveté, lesparents d’unenfant nonencore sevréne
peuvent participer àla vie collective.
L’hommeallaitparfois chasser ouramasser desproduits sauvages, ensolitaire ; la
femme recevait sanourriture deson mari oudeses parents.
Si faciles quefussent lesNambikwara –indifférents àla présence del’ethnographe, àson carnet denotes etàson
appareil photographique –le travail setrouvait compliqué pourdesraisons linguistiques.
D’abord,l’emploidesnoms
propres estchez euxinterdit ; pouridentifier lespersonnes, ilfallait suivre l’usage desgens delaligne, c’est-à-dire
convenir aveclesindigènes desnoms d’emprunt parlesquels onles désignerait.
Soitdesnoms portugais, commeJulio,
José-Maria, Luiza ;soitdessobriquets : Lebre (lièvre), Assucar (sucre).
J’enaimême connuunque Rondon, oul’un de
ses compagnons, avaitbaptisé Cavaignac àcause desabarbiche, rarechez lesIndiens quisont généralement glabres.
Un jour quejejouais avecungroupe d’enfants, unedesfillettes futfrappée parune camarade ; ellevintseréfugier
auprès demoi, etse mit, engrand mystère, àme murmurer quelquechoseàl’oreille, quejene compris pasetque jefus
obligé deluifaire répéter àplusieurs reprises,sibien quel’adversaire découvritlemanège, et,manifestement furieuse,
arriva àson tour pour livrer cequi parut êtreunsecret solennel : aprèsquelques hésitations etquestions, l’interprétation
de l’incident nelaissa pasdedoute.
Lapremière filletteétaitvenue, parvengeance, medonner lenom deson ennemie,
et quand celle-ci s’enaperçut, ellecommuniqua lenom del’autre enguise dereprésailles.
Àpartir decemoment, ilfut
très facile, bienquepeuscrupuleux, d’exciterlesenfants lesuns contre lesautres, etd’obtenir tousleurs noms.
Après
quoi, unepetite complicité ainsicréée, ilsme donnèrent, sanstropdedifficulté, lesnoms desadultes.
Lorsque ceux-ci
comprirent nosconciliabules, lesenfants furentréprimandés, etlasource demes informations tarie.
En second lieu,lenambikwara groupeplusieurs dialectesquisont tousinconnus.
Ilsse distinguent parladésinence des
substantifs etpar certaines formesverbales.
Onsesert surlaligne d’une sortede pidgin, qui
pouvait êtreutile audébut
seulement.
Aidéparlabonne volonté etlavivacité d’esprit desindigènes, j’apprenais doncunnambikwara rudimentaire.
Heureusement, lalangue inclutdesmots magiques – kititu dans
ledialecte oriental, dige,
dage ou tchore ailleurs
–
qu’il suffit d’ajouter auxsubstantifs pourlestransformer enverbes complétés lecas échéant d’uneparticule négative.
Par
cette méthode, onparvient àtout dire, même sice nambikwara « debase » nepermet pasd’exprimer lespensées les
plus subtiles.
Lesindigènes lesavent bien,carilsretournent ceprocédé quandilsessayent deparler portugais ; ainsi
« oreille » et« œil » signifient respectivement entendre–ou comprendre –et voir, etils traduisent lesnotions contraires
en disant : orelha
acabõ ou õlho
acabõ, oreille,
ouœil jefinis… »
La consonance dunambikwara estunpeu sourde, commesila langue étaitaspirée ouchuchotée.
Lesfemmes se
plaisent àsouligner cecaractère etdéforment certainsmots(ainsi, kititu devient
dansleurbouche kediutsu ) ;
articulant
du bout deslèvres, ellesaffectent unesorte debredouillement quiévoque laprononciation enfantine.Leurémission
témoigne d’unmaniérisme etd’une préciosité dontellesontparfaitement conscience :quandjene les comprends paset
les prie derépéter, ellesexagèrent malicieusement lestyle quileur estpropre.
Découragé, jerenonce ; elleséclatent de
rire etles plaisanteries fusent :ellesontréussi.
Je devais rapidement m’apercevoir qu’enplusdusuffixe verballenambikwara enutilise unedizaine d’autres qui
répartissent lesêtres etles choses enautant decatégories : cheveux,poilsetplumes ; objetspointus etorifices ; corps
allongés : soitrigides, soitsouples ; fruits,graines, objetsarrondis ; chosesquipendent outremblent ; corpsgonflés, ou
pleins deliquide ; écorces, cuirsetautres revêtements, etc.Cette observation m’asuggéré unecomparaison avecune
famille linguistique d’Amérique centraleetdu nord-ouest del’Amérique duSud : lechibcha, quifutlalangue d’une
grande civilisation del’actuelle Colombie, intermédiaire entrecelles duMexique etdu Pérou, etdont lenambikwara
serait peut-être unrejeton méridional (5)
.Raison supplémentaire poursedéfier desapparences.
Malgréleurdénuement,
des indigènes, quirappellent lesplus anciens Mexicains parletype physique etleroyaume chibchaparlastructure de
leur langue, ontpeu dechances d’êtredevrais primitifs.
Unpassé dontnous nesavons encore rienetl’âpreté deleur
milieu géographique actuelexpliqueront peut-êtreunjour cette destinée d’enfants prodigues auxquelsl’histoirearefusé
le veau gras..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ANONYME Saint André Rome, église Santa Francesca Romana (abside) XlIe siècle L'église Santa Francesca Romana est l'ancienne église Santa Maria Nova, construite au IXe siècle sur l'emplacement d'un temple de Vénus.
- Problématique : comment Flaubert, à travers les lectures d’Emma, évoque-t-il le romantisme pour mieux s ‘en démarquer avec ironie ?
- LE BRÉSIL (géographie physique)
- Le principe fondamental de toute morale […] est que l'homme est un être naturellement bon, aimant la justice et l'ordre ; qu'il n'y a point de perversité originelle dans le coeur humain, et que les premiers mouvement de la nature sont toujours droits […]. Dans cet état [de nature] l'homme ne connaît que lui ; il ne voit opposé ni conforme à celui de personne ; il ne hait ni n'aime rien ; borné au seul instinct physique, [l'homme] est nul, il est bête : c'est ce que j'ai fait voir dans
- Oral physique-chimie/maths: l'heure du crime !