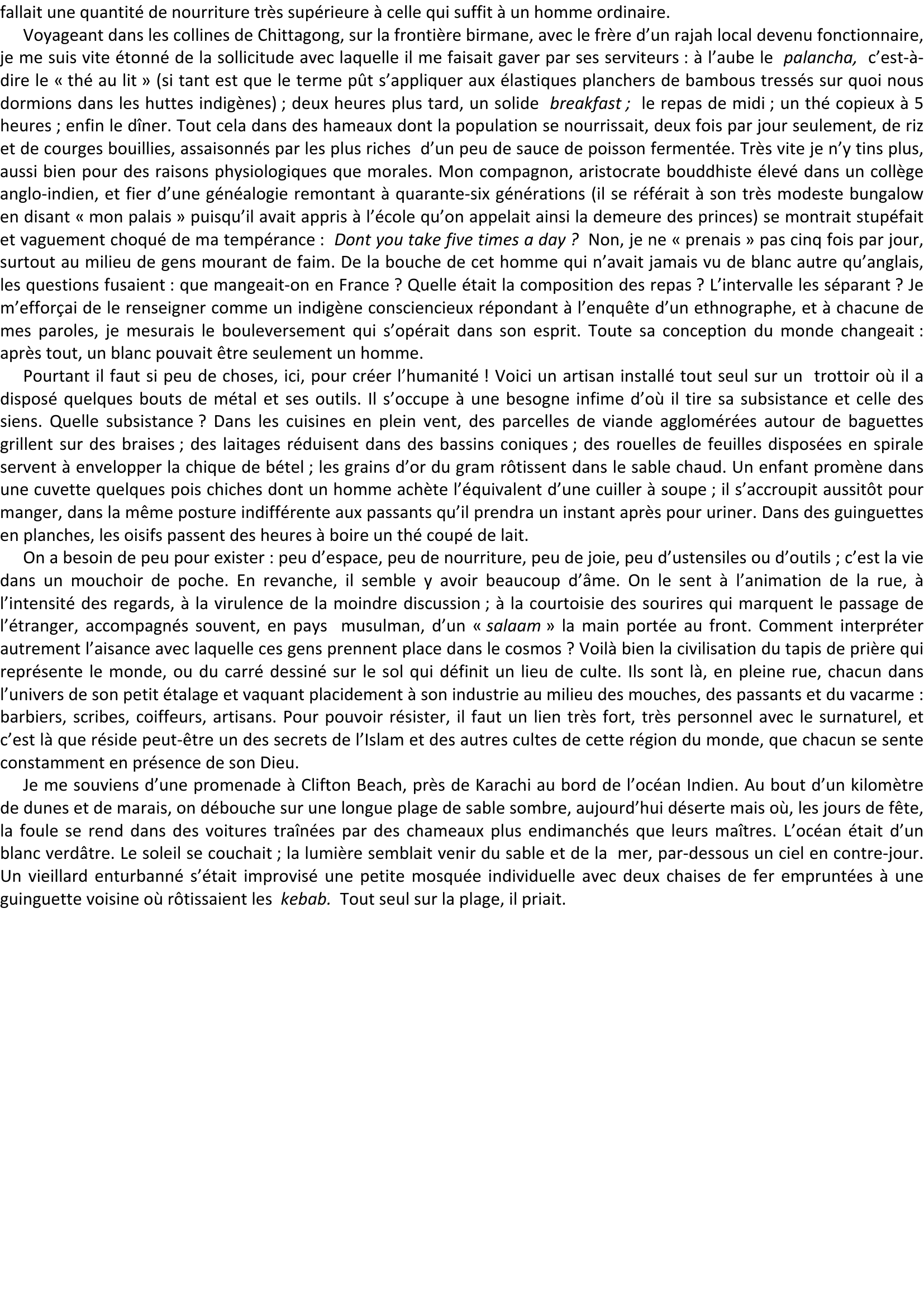mangerai une poire dure comme une pierre, un custard glaireux, puisque je dois payer du sacrifice d'un ananas le auvetage moral d'un être humain. J'ai été pendant quelques jours logé au Circuit House de Chittagong : palais de bois en style de chalet suisse où j'occupais une chambre de neuf mètres sur cinq et six mètres de hauteur. On n'y comptait pas moins de douze commutateurs : plafonnier, vasques murales, éclairage indirect, salle de bains, dressing-room, miroir, ventilateurs, etc. Ce pays n'était-il pas celui des feux de Bengale ? Par cette débauche électrique, quelque maharadjah s'était réservé la délectation d'un feu d'artifice intime et quotidien. Un jour, dans la ville basse, j'arrêtai la voiture mise à ma disposition par le chef de district devant une boutique de onne apparence où je voulus entrer : Royal Hair Dresser, High class cutting, etc. Le chauffeur me regarde horrifié : How can you sit there ! Que deviendrait en effet son propre prestige auprès des siens si le Master se dégradait, et le égradait du même coup, en s'asseyant auprès de ceux de sa race ?... Découragé, je lui laisse le soin d'organiser lui-même le rituel de la coupe de cheveux pour un être d'essence supérieure. Résultat : une heure d'attente dans la voiture jusqu'à ce que le coiffeur ait terminé avec ses clients et rassemblé son matériel ; retour ensemble au Circuit House dans notre hevrolet. À peine arrivés dans ma chambre aux douze commutateurs, le hearer fait couler un bain pour que je puisse, sitôt la coupe terminée, me laver de la souillure de ces mains serves qui ont frôlé mes cheveux. De telles attitudes sont enracinées dans un pays dont la culture traditionnelle inspire à chacun de se faire roi par rapport à quelqu'un d'autre, pour peu qu'il parvienne à se découvrir ou à se créer un inférieur. Comme il souhaiterait que e le traite, le bearer traitera l'homme de peine appartenant aux scheduled castes, c'est-à-dire les plus basses, « inscrites », disait l'administration anglaise, comme ayant droit à sa protection puisque la coutume leur refusait presque la qualité humaine ; et sont-ce bien des hommes, en effet, ces balayeurs et enleveurs de tinettes obligés par cette double fonction à rester accroupis toute la journée soit que, sur le perron des chambres, ils collectent dans leurs mains la oussière à l'aide d'une balayette sans manche, soit que, par-derrière, ils sollicitent, à coups de poing martelant le bas des portes, l'occupant du cabinet de toilette d'en terminer vite avec ce monstrueux ustensile que les Anglais appellent commode », comme si, toujours contractés et courant comme des crabes à travers la cour, eux aussi trouvaient, en avissant au maître sa substance, le moyen d'affirmer une prérogative et d'acquérir un statut. Il faudra bien autre chose que l'indépendance et le temps pour effacer ce pli de servitude. Je m'en rendais compte une uit à Calcutta, sortant du Start Theater où j'étais allé assister à la représentation d'une pièce bengali, inspirée d'un sujet mythologique et appelée Urboshi. Un peu perdu dans ce quartier périphérique d'une ville où j'étais arrivé la veille, je me rouvai devancé, pour arrêter l'unique taxi qui passait, par une famille locale de bonne bourgeoisie. Mais le chauffeur ne l'entendait pas ainsi : au cours d'une conversation animée qui s'engagea entre lui et ses clients, et où le mot Sahib revenait avec insistance, il parut souligner leur inconvenance de se mettre en concurrence avec un blanc. Avec une mauvaise humeur discrète, la famille partit à pied dans la nuit et le taxi me ramena ; peut-être le chauffeur escomptait-il un pourboire plus substantiel ; mais autant que mon bengali sommaire me permît de le comprendre, c'était bien autre chose sur quoi portait la discussion : un ordre traditionnel, qui devait être respecté. J'en fus d'autant plus déconcerté que cette soirée m'avait donné l'illusion de surmonter quelques barrières. Dans cette vaste salle délabrée qui tenait du hangar autant que du théâtre, j'avais beau être seul étranger, j'étais tout de même mêlé à la société locale. Ces boutiquiers, commerçants, employés, fonctionnaires, parfaitement dignes et accompagnés souvent de leurs femmes dont la charmante gravité semblait témoigner qu'elles avaient peu l'habitude de sortir, manifestaient à mon égard une indifférence qui avait quelque chose de bienfaisant après l'expérience de la journée ; si négative que fût leur attitude, et peut-être même pour cette raison, elle instaurait entre nous une discrète fraternité. La pièce, dont je ne comprenais que des bribes, formait un mélange de Broadway, de Châtelet et de Belle Hélène. Il y avait des scènes comiques et ancillaires, des scènes d'amour pathétiques, l'Himalaya, un amant déçu qui y vivait en ermite et un dieu porteur de trident et au regard foudroyant qui le protégeait contre un général à grosses moustaches ; enfin une troupe de chorus girls dont la moitié ressemblaient à des filles de garnison, et l'autre à de précieuses idoles tibétaines. À l'entracte, on servait du thé et de la limonade dans des gobelets en poterie abandonnés après usage - comme cela se faisait il y a quatre mille ans à Harappa où l'on peut toujours ramasser les tessons - pendant que des haut-parleurs diffusaient une musique canaille et pleine de verve, intermédiaire entre des airs chinois et des paso doble. En contemplant les évolutions du jeune premier dont le léger costume dégageait les frisures, le double menton et les formes grassouillettes, je me rappelais une phrase lue quelques jours auparavant dans la page littéraire d'un journal local, et que je transcris ici sans la traduire pour ne pas laisser échapper la saveur indescriptible de l'anglo-indien :... and the young girls who sigh as they gaze into the vast blueness of the sky, of what are they thinking ? Of fat, prosperous suitors... Cette référence aux « gras prétendants » m'avait étonné, mais, considérant le héros avantageux qui faisait onduler sur cène les replis de son estomac et évoquant les mendiants affamés que j'allais retrouver à la porte, je percevais mieux cette valeur poétique de la réplétion pour une société qui vit dans une intimité si lancinante avec la disette. Les Anglais ont compris, d'ailleurs, que le plus sûr moyen de poser ici aux surhommes était de convaincre les indigènes qu'il leur fallait une quantité de nourriture très supérieure à celle qui suffit à un homme ordinaire. Voyageant dans les collines de Chittagong, sur la frontière birmane, avec le frère d'un rajah local devenu fonctionnaire, e me suis vite étonné de la sollicitude avec laquelle il me faisait gaver par ses serviteurs : à l'aube le palancha, c'est-àdire le « thé au lit » (si tant est que le terme pût s'appliquer aux élastiques planchers de bambous tressés sur quoi nous dormions dans les huttes indigènes) ; deux heures plus tard, un solide breakfast ; le repas de midi ; un thé copieux à 5 heures ; enfin le dîner. Tout cela dans des hameaux dont la population se nourrissait, deux fois par jour seulement, de riz et de courges bouillies, assaisonnés par les plus riches d'un peu de sauce de poisson fermentée. Très vite je n'y tins plus, ussi bien pour des raisons physiologiques que morales. Mon compagnon, aristocrate bouddhiste élevé dans un collège nglo-indien, et fier d'une généalogie remontant à quarante-six générations (il se référait à son très modeste bungalow n disant « mon palais » puisqu'il avait appris à l'école qu'on appelait ainsi la demeure des princes) se montrait stupéfait t vaguement choqué de ma tempérance : Dont you take five times a day ? Non, je ne « prenais » pas cinq fois par jour, urtout au milieu de gens mourant de faim. De la bouche de cet homme qui n'avait jamais vu de blanc autre qu'anglais, les questions fusaient : que mangeait-on en France ? Quelle était la composition des repas ? L'intervalle les séparant ? Je m'efforçai de le renseigner comme un indigène consciencieux répondant à l'enquête d'un ethnographe, et à chacune de mes paroles, je mesurais le bouleversement qui s'opérait dans son esprit. Toute sa conception du monde changeait : après tout, un blanc pouvait être seulement un homme. Pourtant il faut si peu de choses, ici, pour créer l'humanité ! Voici un artisan installé tout seul sur un trottoir où il a disposé quelques bouts de métal et ses outils. Il s'occupe à une besogne infime d'où il tire sa subsistance et celle des siens. Quelle subsistance ? Dans les cuisines en plein vent, des parcelles de viande agglomérées autour de baguettes grillent sur des braises ; des laitages réduisent dans des bassins coniques ; des rouelles de feuilles disposées en spirale servent à envelopper la chique de bétel ; les grains d'or du gram rôtissent dans le sable chaud. Un enfant promène dans une cuvette quelques pois chiches dont un homme achète l'équivalent d'une cuiller à soupe ; il s'accroupit aussitôt pour anger, dans la même posture indifférente aux passants qu'il prendra un instant après pour uriner. Dans des guinguettes n planches, les oisifs passent des heures à boire un thé coupé de lait. On a besoin de peu pour exister : peu d'espace, peu de nourriture, peu de joie, peu d'ustensiles ou d'outils ; c'est la vie ans un mouchoir de poche. En revanche, il semble y avoir beaucoup d'âme. On le sent à l'animation de la rue, à 'intensité des regards, à la virulence de la moindre discussion ; à la courtoisie des sourires qui marquent le passage de 'étranger, accompagnés souvent, en pays musulman, d'un « salaam » la main portée au front. Comment interpréter autrement l'aisance avec laquelle ces gens prennent place dans le cosmos ? Voilà bien la civilisation du tapis de prière qui représente le monde, ou du carré dessiné sur le sol qui définit un lieu de culte. Ils sont là, en pleine rue, chacun dans l'univers de son petit étalage et vaquant placidement à son industrie au milieu des mouches, des passants et du vacarme : barbiers, scribes, coiffeurs, artisans. Pour pouvoir résister, il faut un lien très fort, très personnel avec le surnaturel, et c'est là que réside peut-être un des secrets de l'Islam et des autres cultes de cette région du monde, que chacun se sente constamment en présence de son Dieu. Je me souviens d'une promenade à Clifton Beach, près de Karachi au bord de l'océan Indien. Au bout d'un kilomètre de dunes et de marais, on débouche sur une longue plage de sable sombre, aujourd'hui déserte mais où, les jours de fête, la foule se rend dans des voitures traînées par des chameaux plus endimanchés que leurs maîtres. L'océan était d'un blanc verdâtre. Le soleil se couchait ; la lumière semblait venir du sable et de la mer, par-dessous un ciel en contre-jour. Un vieillard enturbanné s'était improvisé une petite mosquée individuelle avec deux chaises de fer empruntées à une guinguette voisine où rôtissaient les kebab. Tout seul sur la plage, il priait. XVI MARCHÉS Sans que j'en aie formé le dessein, une sorte de travelling mental m'a conduit du Brésil central à l'Asie du Sud ; des terres les plus récemment découvertes à celles où la civilisation s'est manifestée en premier ; des plus vides aux plus pleines, s'il est vrai que le Bengale est trois mille fois aussi peuplé que le Mato Grosso ou Goyaz. En me relisant, je perçois que la différence est plus profonde encore. Ce que je considérais en Amérique, c'étaient d'abord des sites naturels ou urbains ; dans les deux cas, objets définis par leurs formes, leurs couleurs, leurs structures particulières, qui leur confèrent une existence indépendante des êtres vivants qui les occupent. Dans l'Inde, ces grands objets ont disparu, ruinés par l'histoire, réduits à une poussière physique ou humaine qui devient l'unique réalité. Là où je voyais d'abord des choses, ici je n'aperçois plus que des êtres. Une sociologie érodée par l'action des millénaires s'effondre, fait place à une multiplicité de rapports entre des personnes, tant la densité humaine s'interpose entre l'observateur et un objet qui se dissout. L'expression, là-bas si courante pour désigner cette partie du monde : le sous-continent, prend alors un sens nouveau. Elle ne signifie plus simplement une partie du continent asiatique, elle paraît s'appliquer à un monde qui mérite à peine le nom de continent, tant une désintégration poussée jusqu'à l'extrême limite de son cycle a détruit la structure qui maintenait jadis dans des cadres organisés quelques centaines de millions de particules : les hommes, aujourd'hui lâchés dans un néant engendré par l'histoire, agités en tous sens par les motivations les plus élémentaires de la peur, de la souffrance et de la faim. Dans l'Amérique tropicale, l'homme est dissimulé d'abord par sa rareté ; mais même là où il s'est groupé en formations plus denses, les individus restent pris, si l'on peut dire, dans le relief encore bien accusé de leur agrégation toute fraîche. Quelle que soit la pauvreté du niveau de vie dans l'intérieur ou même dans les villes, il ne s'abaisse qu'exceptionnellement au point où l'on entend crier les êtres, tant il demeure possible de subsister avec peu de choses sur un sol que l'homme a entrepris de saccager - et encore sur certains points - voici seulement quatre cent cinquante ns. Mais dans l'Inde, agricole et manufacturière depuis cinq mille ou dix mille ans, ce sont les bases mêmes qui se dérobent : les forêts ont disparu ; à défaut de bois, il faut pour cuire la nourriture brûler un engrais dénié aux champs ; la erre arable, lavée par les pluies, fuit vers la mer ; le bétail affamé se reproduit moins vite que les hommes et doit sa urvivance à la défense que font ceux-ci de s'en nourrir. Cette opposition radicale entre les tropiques vacants et les tropiques bondés, rien ne l'illustre mieux qu'une omparaison de leurs foires et de leurs marchés. Au Brésil comme en Bolivie ou au Paraguay, ces grandes occasions de la ie collective font apparaître un régime de production resté encore individuel ; chaque éventaire reflète l'originalité de son titulaire : comme en Afrique, la marchande propose au client les menus excédents de son activité domestique. Deux oeufs, une poignée de piments, une botte de légumes, une autre de fleurs, deux ou trois rangs de perles faites de graines sauvages - « oeils de chèvre » rouges pointillées de noir, « larmes de la Vierge » grises et lustrées - récoltées et enfilées pendant les instants de loisirs ; un panier ou une poterie, ouvrage de la vendeuse, et quelque antique talisman poursuivant là un cycle compliqué de transactions. Ces devantures de poupées, dont chacune est une humble oeuvre d'art, expriment une diversité de goûts et d'activités, un équilibre spécifique pour chacune d'elles, qui témoignent en faveur de la liberté préservée par tous. Et quand le passant est interpellé, ce n'est point pour le secouer du spectacle d'un orps squelettique ou mutilé, l'implorer de sauver quelqu'un de la mort, mais pour lui proposer de tomar a borboleta, prendre le papillon - ou quelque autre bête - dans cette loterie dite du bicho, jeu de l'animal, où les nombres se ombinent avec les figurants d'un bestiaire gracieux. D'un bazar oriental on connaît tout avant de l'avoir visité, hors deux choses : la densité humaine et la saleté. Ni l'une ni l'autre ne sont imaginables, il faut l'expérience pour les éprouver. Car, d'un seul coup, cette expérience restitue une dimension fondamentale. Cet air piqueté de noir par les mouches, ce grouillement, on reconnaît en eux un cadre naturel à l'homme, celui dans lequel, depuis Ur en Chaldée jusqu'au Paris de Philippe le Bel en passant par la Rome impériale, ce que nous nommons civilisation s'est lentement sécrété. J'ai couru tous les marchés à Calcutta, le nouveau et les anciens : Bombay bazar à Karachi ; ceux de Delhi et ceux 'Agra : Sadar et Kunari ; Dacca, qui est une succession de soukhs où vivent des familles, blotties dans les interstices es boutiques et des ateliers ; Riazuddin Bazar et Khatun-ganj à Chittagong ; tous ceux des portes de Lahore : Anarkali Bazar, Delhi, Shah, Almi, Akkari ; et Sadr, Dabgari, Sirki, Bajori, Ganj, Kalan à Peshawar. Dans les foires campagnardes de a passe de Khaïber à la frontière afghane et dans celles de Rangamati, aux portes de la Birmanie, j'ai visité les marchés ux fruits et aux légumes, amoncellements d'aubergines et d'oignons roses, de grenades éclatées dans une odeur ntêtante de goyave ; ceux des fleuristes, qui enguirlandent les roses et le jasmin de clinquant et de cheveux d'ange ; les talages des marchands de fruits secs, tas fauves et bruns sur fond de papier d'argent ; j'ai regardé, j'ai respiré les épices t les currys, pyramides de poudres rouge, orange et jaune ; montagnes de piments, irradiant une odeur suraiguë 'abricot sec et de lavande, à défaillir de volupté ; j'ai vu les rôtisseurs, bouilleurs de lait caillé, fabricants de crêpes : nàn ou chapati ; les vendeurs de thé et de limonade, les marchands en gros de dattes agglomérées en gluants monticules de ulpe et de noyaux évoquant les déjections de quelque dinosaure ; les pâtissiers qu'on prendrait plutôt pour des