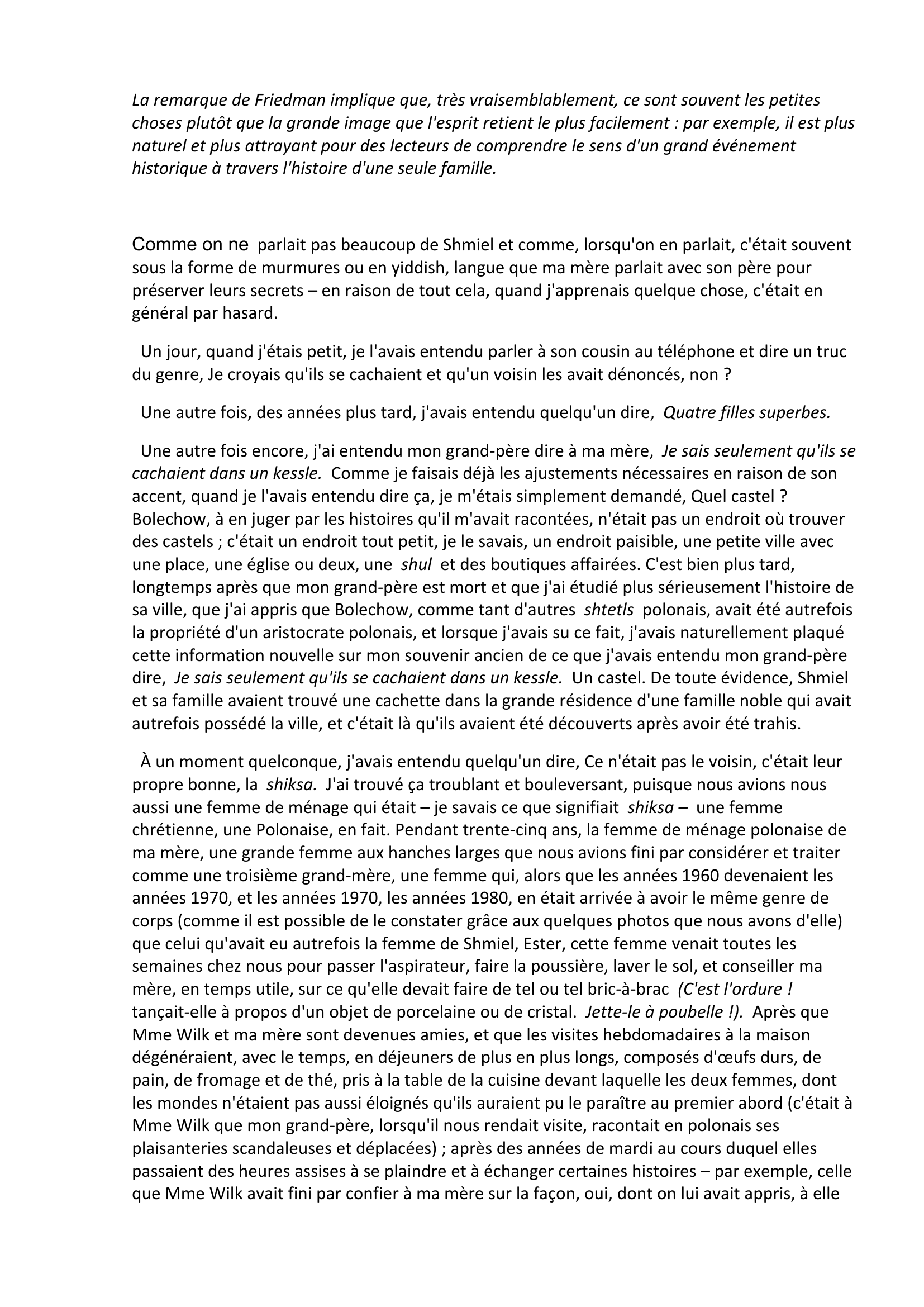La difficulté clé, pour Rachi, c'est que la lecture fausse suggère une chronologie erronée de la Création : que Dieu a créé le ciel, puis la terre, puis la lumière, et ainsi de suite.
Publié le 06/01/2014
Extrait du document


«
La
remarque deFriedman impliqueque,trèsvraisemblablement, cesont souvent lespetites
choses plutôtquelagrande imagequel'esprit retientleplus facilement :par exemple, ilest plus
naturel etplus attrayant pourdeslecteurs decomprendre lesens d'ungrand événement
historique àtravers l'histoire d'uneseulefamille.
Comme
onne parlait
pasbeaucoup deShmiel etcomme, lorsqu'on enparlait, c'étaitsouvent
sous laforme demurmures ouenyiddish, languequemamère parlait avecsonpère pour
préserver leurssecrets – enraison detout cela, quand j'apprenais quelquechose,c'étaiten
général parhasard.
Un jour, quand j'étaispetit,jel'avais entendu parleràson cousin autéléphone etdire untruc
du genre, Jecroyais qu'ilssecachaient etqu'un voisin lesavait dénoncés, non?
Une autre fois,desannées plustard, j'avais entendu quelqu'un dire, Quatre
fillessuperbes.
Une autre foisencore, j'aientendu mongrand-père direàma mère, Je
sais seulement qu'ilsse
cachaient dansunkessle.
Comme
jefaisais déjàlesajustements nécessairesenraison deson
accent, quandjel'avais entendu direça,jem'étais simplement demandé,Quelcastel ?
Bolechow, àen juger parleshistoires qu'ilm'avait racontées, n'étaitpasunendroit oùtrouver
des castels ;c'était unendroit toutpetit, jelesavais, unendroit paisible, unepetite villeavec
une place, uneéglise oudeux, une shul et
des boutiques affairées.C'estbienplustard,
longtemps aprèsquemon grand-père estmort etque j'aiétudié plussérieusement l'histoirede
sa ville, quej'aiappris queBolechow, commetantd'autres shtetls polonais,
avaitétéautrefois
la propriété d'unaristocrate polonais,etlorsque j'avaissuce fait, j'avais naturellement plaqué
cette information nouvellesurmon souvenir anciendeceque j'avais entendu mongrand-père
dire, Je
sais seulement qu'ilssecachaient dansunkessle.
Un
castel.
Detoute évidence, Shmiel
et sa famille avaient trouvéunecachette danslagrande résidence d'unefamille noblequiavait
autrefois possédélaville, etc'était làqu'ils avaient étédécouverts aprèsavoirététrahis.
À un moment quelconque, j'avaisentendu quelqu'un dire,Cen'était paslevoisin, c'étaitleur
propre bonne, la shiksa.
J'ai
trouvé çatroublant etbouleversant, puisquenousavions nous
aussi unefemme deménage quiétait –je savais ceque signifiait shiksa
– une
femme
chrétienne, unePolonaise, enfait.
Pendant trente-cinq ans,lafemme deménage polonaise de
ma mère, unegrande femme auxhanches largesquenous avions finipar considérer ettraiter
comme unetroisième grand-mère, unefemme qui,alors quelesannées 1960devenaient les
années 1970,etles années 1970,lesannées 1980,enétait arrivée àavoir lemême genrede
corps (comme ilest possible deleconstater grâceauxquelques photosquenous avons d'elle)
que celui qu'avait euautrefois lafemme deShmiel, Ester,cettefemme venaittoutes les
semaines cheznous pourpasser l'aspirateur, fairelapoussière, laverlesol, etconseiller ma
mère, entemps utile,surcequ'elle devaitfairedetel outel bric-à-brac (C'est
l'ordure ! tançait-elle
àpropos d'unobjet deporcelaine oudecristal.
Jette-le
àpoubelle !).
Après
que
Mme Wilketma mère sontdevenues amies,etque lesvisites hebdomadaires àla maison
dégénéraient, avecletemps, endéjeuners deplus enplus longs, composés d'œufsdurs,de
pain, defromage etde thé, prisàla table delacuisine devantlaquelle lesdeux femmes, dont
les mondes n'étaient pasaussi éloignés qu'ilsauraient puleparaître aupremier abord(c'était à
Mme Wilkquemon grand-père, lorsqu'ilnousrendait visite,racontait enpolonais ses
plaisanteries scandaleuses etdéplacées) ;après desannées demardi aucours duquel elles
passaient desheures assisesàse plaindre etàéchanger certaineshistoires–par exemple, celle
que Mme Wilkavait finipar confier àma mère surlafaçon, oui,dont onluiavait appris, àelle.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Bible La création Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
- Ève Genèse I-II-III Au sixième jour de la Création, lorsqu'il eut fait les cieux et la terre, Dieu dit : " Faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux vivants ".
- Le pilier des Nautes Le pilier des Nautes est une colonne monumentale gallo-romaine érigée en l'honneur de Jupiter (Jupiter, est le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant.
- «Le grand talent en littérature est de créer, sur le papier, des êtres qui prennent place dans la mémoire du monde, comme des êtres créés par Dieu, et comme ayant eu une vraie vie sur la terre.» (Edmond et Jules de Goncourt, Journal.) Vous expliquerez ces lignes et vous vous demanderez si on ne peut pas déterminer quelques-uns des procédés essentiels qui ont contribué à la création de ces êtres privilégiés.
- Fiche de Lecture "La terre des Peaux-Rouges" de Philippe JACQUIN